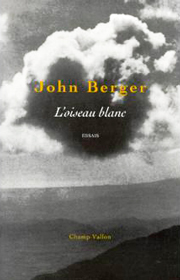Le critique d’art et écrivain John Berger aborde ici les questions fondamentales posées par les arts plastiques.
Lorsqu’il parle du cubisme, il ne parle pas seulement de Braque, de Léger, de Picasso ou de Juan Gris, mais aussi de ce moment, au début du vingtième siècle, où le monde s’est rassemblé autour d’un formidable sentiment de promesses en l’avenir. Quand il étudie l’œuvre de Modigliani, il voit dans l’étirement des formes du modèle l’infini de l’amour humain.
Cheminant librement de la Renaissance à l’explosion atomique de Hiroshima, des rives du
Bosphore aux gratte-ciels de Manhattan, des sculpteurs sur bois d’un village savoyard à Goya, Dürer ou Van Gogh, et embrassant aussi bien le sentiment personnel de l’amour et de la perte que les bouleversements politiques majeurs de notre temps, L’Oiseau blanc démontre une fois de plus la singularité de John Berger.
OUVRAGE ÉPUISÉ
Lire le sommaire
L’oiseau blanc
Le sommaire
1
L’OISEAU BLANC
Autoportrait de Rembrandt
Autoportrait 1914-1918
L’oiseau blanc
2
PARTIR
Le conteur
À la périphérie d’une ville étrangère
Mangeurs et mangés
Dürer : portrait de l’artiste
Une nuit à Strasbourg
Sur les rives de la Save
Quatre poèmes cartes postales
Sur le Bosphore
Manhattan
Le théâtre de l’indifférence
3
DEUX RÊVES
La ville de Sodome
Le déluge
4
L’ABC DE L’AMOUR
Le fichu
Goya : la Maja, vêtue et nue
Bonnard 108
L’abécédaire amoureux de Modigliani
Le mystère Hals
5
DERNIERS CLICHÉS
Dans un cimetière de Moscou
Ernst Fischer : un philosophe et la mort
François, Georges et Amélie: requiem en trois parties
Dessiné pour ce moment
Le non-dit
6
L’ŒUVRE DE L’ART
Sur un bronze de Degas représentant une danseuse
Le moment du cubisme
Les yeux de Claude Monet
L’œuvre de l’art
La peinture et le temps
Le lieu de la peinture
Sur la visibilité
7
LA ROUTE NON FRAYÉE
Plus rouge chaque jour
Maïakovski : sa langue et sa mort
Le chroniqueur de la mort
L’heure de la poésie
L’écran et La Sape
Vies sicilienne
Leopardi
La production du monde
Langue maternelle
8
LE 6 AOÛT 1945
Hiroshima
De toutes les couleurs
Table des illustrations
Lire un extrait
L’oiseau blanc
L’extrait
L’oiseau blanc
Des institutions, le plus souvent américaines, m’invitent de temps en temps à venir leur parler d’esthétique. Une fois que je songeais à accepter une invitation – mais cela ne s’est pas fait –, je me suis dit que j’allais mettre dans mes bagages un oiseau de bois blanc. Le problème, c’est qu’on ne peut pas parler d’esthétique sans parler du principe espérance et de l’existence du mal. Durant les longs hivers, les paysans de certaines régions de la Haute-Savoie avaient coutume de faire des oiseaux en bois pour les suspendre dans leurs cuisines, peut-être aussi dans leurs chapelles. Des amis qui voyagent m’ont dit avoir vu des oiseaux semblables, fabriqués selon le même principe, dans certaines régions de Tchécoslovaquie, de Russie et des Pays baltes. Il se peut que la tradition en soit encore plus répandue.
Le principe présidant au façonnage de ces oiseaux est très simple, même si faire un bel oiseau exige beaucoup d’adresse. On prend deux morceaux de bois de pin, d’environ douze centimètres de long et d’un peu moins de deux centimètres et demi de haut et de large. On les trempe dans l’eau pour assouplir le bois au maximum, puis on les taille. Un des morceaux forme la tête et le corps terminé par une queue en éventail, l’autre représente les ailes. Tout l’art tient au façonnage de la queue et des ailes. On taille chaque extrémité du bloc des ailes de façon à lui donner la forme d’une seule plume. Puis cette extrémité est découpée en treize minces lamelles qui sont alors délicatement ouvertes, l’une après l’autre, en éventail. On procède de même pour la seconde aile et pour les plumes de la queue. On assemble alors en croix les deux morceaux de bois et l’oiseau est terminé. Aucune colle n’est utilisée, mais seulement un clou, là où les deux morceaux se croisent. Très légers – leur poids oscille entre soixante et cent grammes –, ces oiseaux sont d’habitude suspendus à un fil fixé à un surplomb de la cheminée, ou à une poutre, pour qu’ils bougent sous l’effet des courants d’air.
Il n’est pas question de comparer un de ces oiseaux à un autoportrait de Van Gogh ou à une crucifixion de Rembrandt. Il s’agit d’objets simples, fabriqués de façon artisanale et selon un modèle traditionnel. Mais leur simplicité même permet de distinguer les qualités qui font leur agrément et leur mystère aux yeux de tous ceux qui les voient.
Premièrement, on a affaire à une représentation figurative – on regarde un oiseau, plus précisément une colombe, qui est apparemment arrêté en plein vol. L’objet renvoie donc au monde naturel environnant. Deuxièmement, le choix du sujet (un oiseau qui vole) et le contexte dans lequel il est placé (à l’intérieur de la maison où il est peu probable de trouver de vrais oiseaux) rendent cet objet symbolique. Ce symbolisme primaire rejoint alors un symbolisme plus général d’ordre culturel. Un grand nombre de cultures attribuent des significations symboliques aux oiseaux, aux colombes en particulier.
Troisièmement, il y a le respect pour le matériau utilisé. Le bois est façonné selon ses qualités propres de légèreté, de flexibilité et de texture. En le regardant, on est surpris de voir avec quel bonheur le bois devient oiseau. Quatrièmement, il y a unité et économie formelles. En dépit de l’apparente complexité de l’objet, la grammaire qui préside à sa fabrication est d’une simplicité qui frise l’austérité. Sa richesse est le résultat de répétitions qui sont aussi des variations. Cinquièmement, cet objet fabriqué par l’homme suscite une sorte d’étonnement: comment diable a-t-il été fait? J’ai donné plus haut quelques indications grossières, mais celle ou celui qui ne connaît pas cette technique a envie de prendre la colombe dans la main et de l’examiner attentivement pour découvrir le secret de fabrication qu’il recèle.
Ces cinq qualités, quand elles sont perçues comme un tout avant que l’analyse ne les distingue, provoquent le sentiment, à tout le moins momentané, de se trouver devant un mystère. On regarde un morceau de bois qui est devenu oiseau. On regarde un oiseau qui est, d’une certaine manière, plus qu’un oiseau. On regarde quelque chose qui a été façonné avec un savoir-faire mystérieux et une sorte d’amour.
Jusqu’ici j’ai tenté d’isoler les qualités de l’oiseau blanc qui suscitent une émotion esthétique. (Bien qu’il désigne un mouvement du cœur et de l’imagination, le terme «émotion» prête ici à confusion, car ce à quoi nous avons affaire n’a pas grand-chose à voir avec nos autres émotions, surtout parce que le moi est ici davantage en suspens.) Pourtant toutes mes définitions éludent la question essentielle. Elles réduisent l’esthétique à l’art. Elle ne disent rien des rapports entre l’art et la nature, entre l’art et le monde.
Devant une montagne, un désert juste après le coucher du soleil, ou devant un arbre fruitier, on peut aussi éprouver des émotions esthétiques. Il nous faut donc recommencer, mais cette fois non pas à partir d’un objet façonné par l’homme, mais à partir de la nature dans laquelle nous naissons.
Le fait de vivre en ville a toujours eu tendance à engendrer une conception sentimentale de la nature. On pense à elle comme à un jardin, à une vue qu’encadre une fenêtre, ou encore à un cadre où exercer notre liberté. Les paysans, les marins et les nomades ne s’y sont pas laissés prendre. La nature, c’est de l’énergie et de la lutte. C’est ce qui existe sans rien promettre. Si l’homme la considère comme un cadre ou un décor, il la lui faut concevoir comme un décor qui se prête indifféremment au mal et au bien. Son énergie est affreusement indifférente. La première nécessité de la vie, c’est de s’abriter, de s’abriter de la nature. La première prière est demande de protection. Le premier signe de vie est la douleur. Si la Création a un but, il s’agit d’un but caché qui ne peut se découvrir qu’intangiblement au sein des signes, jamais par l’évidence concrète de ce qui arrive.
C’est dans cet âpre contexte naturel que se fait la rencontre avec la beauté et, de par sa nature même, cette rencontre est soudaine et imprévisible. Le coup de vent s’épuise et la mer change de couleur, d’un gris merdeux elle éclate en bleu-vert. Sous le rocher tombé d’une avalanche perce une fleur. Au-dessus du bidonville, la lune se lève. Par ces exemples spectaculaires j’entends insister sur l’âpreté du contexte, mais nous avons tous à l’esprit d’autres exemples quotidiens: de quelque manière qu’elle se fasse, cette rencontre avec la beauté constitue toujours une exception, quelque chose qui se produit toujours malgré. Et c’est pour cela même qu’elle nous émeut.
On peut certes défendre l’idée que c’est la fonction qui est à l’origine de la manière dont la beauté nous émeut. Les fleurs sont promesse de fertilité, le coucher de soleil rappelle la chaleur du foyer, le clair de lune rend la nuit moins obscure, les brillantes couleurs des plumes d’un oiseau constituent (même pour nous et de manière atavique) un stimulant sexuel. Pourtant, une telle conception me paraît bien trop réductrice: la neige ne sert à rien, un papillon n’a pas grand-chose à nous offrir.
Il va de soi que la gamme des choses qu’une communauté donnée trouve belles dans la nature dépend de ses moyens de survie, de son économie et de sa géographie. Il y a peu de chance pour que les Esquimaux trouvent belles les mêmes choses que les Ashanti. Au sein des sociétés de classes modernes, les déterminations idéologiques sont complexes: on sait, par exemple, que la classe dirigeante anglaise au xviiie siècle n’aimait pas voir la mer. De même, l’usage social qu’on peut faire d’une émotion esthétique change avec le moment historique: la silhouette d’une montagne peut représenter la demeure des morts ou un défi à l’initiative des vivants. L’anthropologie, l’étude comparative des religions, l’économie politique et le marxisme l’ont rendu évident.
Et pourtant, il semble y avoir certains éléments constants que toutes les cultures ont trouvés beaux: au nombre de ceux-ci figurent les fleurs, les arbres, des formes de rochers, les oiseaux, les animaux, la lune, l’eau qui coule…
Il faut bien admettre qu’il y a comme une coïncidence ou, peut-être même, une harmonie des points de vue. L’évolution des formes naturelles et l’évolution de la perception humaine ont coïncidé pour produire le phénomène de reconnaissance potentielle: ce qui est et ce que nous pouvons voir (et sentir aussi parce que nous le voyons) se rencontrent parfois en un point d’attestation. Ce point, cette coïncidence, a deux aspects: ce qui a été vu se reconnaît et s’atteste et, en même temps, celui qui voit s’atteste par ce qu’il voit. On se trouve un bref instant – et sans avoir les prétentions d’un créateur – dans la position de Dieu au premier chapitre de la Genèse… Et Il vit que tout cela était bon. L’émotion esthétique devant la nature provient, je pense, de cette double attestation.
Mais nous ne vivons pas au premier chapitre de la Genèse. Pour adopter la chronologie biblique, nous vivons après la Chute. En tout cas, dans un monde de souffrance où le mal est endémique, un monde où les événements ne confirment pas notre Être, un monde auquel il nous faut résister. C’est dans une telle situation que le moment esthétique offre l’espérance. Que nous trouvions beaux un cristal ou un coquelicot signifie que nous sommes moins seuls, que nous sommes plus profondément insérés dans l’existence que le cours d’une seule vie pourrait nous le faire penser. J’essaie de décrire aussi exactement que possible l’expérience en question; mon point de départ est phénoménologique, non pas déductif; sa forme, perçue en tant que telle, devient un message que l’on reçoit, mais qu’on ne peut traduire parce que, en elle, tout est instantané. L’espace d’un instant, l’énergie de notre perception devient inséparable de l’énergie de la création.
L’émotion esthétique que suscite en nous un objet fabriqué par l’homme – comme l’oiseau blanc dont je suis parti – est un dérivé de l’émotion que nous éprouvons devant la nature. L’oiseau blanc est une tentative pour traduire le message reçu d’un oiseau réel. C’est l’effort pour transformer l’instantané en permanent qui a permis à tous les langages de l’art de se développer. L’art suppose que la beauté n’est pas une exception – qu’elle n’existe pas malgré – mais qu’elle est le fondement d’un ordre.
Il y a plusieurs années, j’ai écrit, en considérant la face historique de l’art, que je jugeais d’une œuvre en me demandant si elle aidait ou non les hommes du monde moderne à faire valoir leurs droits sociaux. Je n’ai pas changé d’avis. Mais l’autre face de l’art, sa face transcendantale, pose la question du droit ontologique de l’homme.
L’idée que l’art est le miroir de la nature est de celles qui ne plaisent qu’aux périodes de scepticisme. L’art n’imite pas la nature, il imite une création, parfois pour proposer un monde autre que le monde réel, parfois simplement pour amplifier, pour confirmer, pour faire pénétrer dans la société le bref espoir offert par la nature. L’art est une réponse organisée à ce que la nature nous permet parfois d’entrevoir. Il entreprend de transformer la reconnaissance potentielle en reconnaissance qui ne cesse point. Il proclame l’homme dans l’espoir de recevoir une réponse plus sûre… la face transcendantale de l’art est toujours une forme de prière.
L’oiseau de bois blanc se balance dans l’air chaud qui s’échappe du poêle dans la cuisine où les voisins sont en train de boire. Dehors, par moins 25° centigrades, les vrais oiseaux meurent de froid!
OUVRAGE ÉPUISÉ