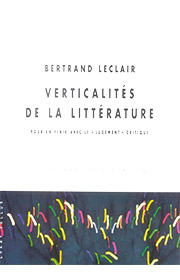«Si l’on veut bien admettre en effet que l’art est ce qui permet de faire respirer l’univers de nos représentations collectives en y faisant jaillir l’oxygène du réel: si l’on veut bien admettre qu’il a une fonction vitale comparable à celle du rêve dans la vie psychique individuelle, qu’il est en somme le rêve du monde (à tous les sens du terme de rêve), alors force est de reconnaître que Gauguin visait juste en disant de la critique qu’elle est non pas la “vigie vigilante” qu’elle devrait être mais “notre censure”.»
Au départ, et confronté au malaise contemporain de la critique littéraire, il s’agissait d’écrire un article prônant une «critique de témoignage» plutôt que de jugement. Encore fallait-il désigner ce dont il s’agit de témoigner. C’est là qu’intervient la notion de «verticalité», qui permet, en s’appuyant sur Bachelard et Mallarmé aussi bien que Proust, Kafka, Artaud ou Barthes, d’évoquer ce qui anime les œuvres, ce qui justifie qu’on s’y consacre (lisant, écrivant), mais qui les excède, que l’on ne peut qu’éprouver, et certainement pas mesurer, juger, cataloguer. Une dimension verticale qu’il est d’autant plus difficile de faire entendre dans l’espace médiatique que l’«univers communicationnaire» qui est le nôtre la récuse chaque jour davantage.
Lire un extrait
Verticalités de la litérature
Extrait
I
DU MALENTENDU À L’ABSURDITÉ
Quand ce que je dis tombe dans l’oreille d’un sourd, ce que je dis est absurde – au sens premier, étymologique, du mot d’ab-surdité. Quand ce que je dis ne tombe pas dans l’oreille d’un sourd, mais dans l’oreille de quelqu’un susceptible de l’entendre, c’est lui qui peut – éventuellement – surseoir à l’absurdité de ce que je dis.
Comme chacun sait, la pire des surdités (la surdité la plus handicapante, la plus mutilante) est la surdité volontaire, celle-ci ne ferait-elle qu’obtempérer aux injonctions stridentes des puissances dominantes.
À lire la presse, certains jours, c’est à croire que l’art et la poésie désormais sont – assourdissants. À moins que l’univers de la communication libérale et marchande ne puisse se déployer qu’à l’instar d’une gigantesque oreille de sourd volontaire, au pavillon gargantuesque duquel viennent se cogner, absurdes, tous les appels à insuffler la vie dans le monde forclos des représentations communes?
*
Ce qui est sûr, c’est qu’il est impossible de réfléchir à la réception des œuvres sans interroger la notion de geste artistique, d’une part, et celle de communication médiatique, d’autre part: sans interroger ce que le geste artistique met en jeu dans l’univers des représentations collectives, quand ce qu’il met en jeu est ce qui le condamne le plus souvent au malentendu, aujourd’hui comme à la fin du xixe siècle, mais pour des raisons différentes.
Sans oublier l’étymologie du mot critique (qui renvoie à la notion de crible, mais aussi à celle de crise), c’est là le point de départ de cet essai, basé sur une conviction qu’il s’agit d’étayer: le malaise contemporain de la critique n’est pas une question de personnes, ni le résultat d’une incapacité subite qu’auraient les critiques à analyser les œuvres dans le but de les valider; ce malaise résulte en amont de la façon dont les œuvres sont reçues et donc considérées dans une société qui les réduit à l’état d’objets (de consommation), niant ainsi tout ce qui en elles excède les œuvres – ce qui les excède et n’en reste pas moins leur véritable raison d’être.
Faute de disposer encore de canons esthétiques valides auxquels se référer (de «modèle» en fonction duquel mesurer la valeur esthétique d’une œuvre d’art), la critique ne pourrait retrouver une capacité à signifier le geste artistique dans l’univers social, une capacité à donner aux œuvres une réalité efficiente au sein des représentations communes, qu’à la condition d’opérer un glissement sur elle-même pour se penser en terme, non plus de jugement, mais de témoignage.
Ce qui est en cause, c’est évidemment l’engagement du critique dans sa lecture en tant qu’il est d’abord un lecteur – si l’on veut bien admettre une leçon essentielle de la modernité, qui est que l’art se fait à deux, qu’il est un échange, et que par conséquent le critique, lorsqu’il évoque une œuvre, évoque autant la réception que lui-même en a faite que les «qualités intrinsèques» de cette œuvre (si l’on veut bien admettre, en somme, que le critique, lorsqu’il parle d’un livre, évoque autant la nécessité et les enjeux de sa propre lecture que la nécessité de l’œuvre dont il parle).
*
Avant même de préciser qu’un témoignage se construit et s’étaie tout autant qu’un jugement, mieux vaut commencer par un exemple précis de ce que je nomme ainsi malentendu, un exemple de cette absurdité liée d’abord à la réception des œuvres – plus exactement: un exemple de cette manière de recevoir les œuvres en position passive et normative qui les renvoie le plus souvent à l’absurdité, et donc au grotesque. Plus d’un siècle après leur surgissement, les textes en prose de Stéphane Mallarmé continuent de paraître absurdes à un grand nombre de leurs lecteurs (qui n’osent plus les trouver ridicules dans la seule mesure de la validation dont ils ont fait l’objet au fil du xxe siècle).
Les virgules de Mallarmé en particulier font problème. Lorsque vous citez dans un article sa conférence sur son ami Villiers de l’Isle Adam1, l’un des plus beaux textes de Mallarmé (c’est ici, à la troisième ligne, qu’il affirme: «Sait-on ce que c’est qu’écrire? Une très ancienne et très vague mais jalouse pratique, dont gît le sens au mystère du cœur. Qui l’accomplit, intégralement, se retranche»), en général les correcteurs s’inquiètent. Lorsque vous en citez les premiers mots, ils s’affolent. Prononcée en février 1890 en Belgique, quelques semaines à peine après la mort pathétique de Villiers que Mallarmé, exemplaire dans l’amitié, a assisté jour après jour, cette conférence s’ouvre en effet sur cette phrase:
«Un homme au rêve habitué, vient ici parler d’un autre, qui est mort.»
Enlever une virgule après «habitué», en rajouter une après «un homme»… les correcteurs hésitent, insatisfaits, mais tendent le plus souvent sans même interroger la portée de leur geste à détruire, par un rappel à l’ordre spontané du discours, le profond sentiment de trouble que porte cette phrase introductive: phrase qui creuse la notion de deuil au point que l’on peut lire tout à la fois le sens premier, évident, qui n’a pas besoin de l’intervention des correcteurs pour apparaître (un homme qui est habitué au rêve vient ici en tant que conférencier parler d’un autre homme qui était lui aussi habitué au rêve, mais qui est mort), et le sens second, souterrain, immédiatement vertical, qu’impose la syntaxe désaxée: «un homme au rêve habitué qui est mort», «vient ici parler d’un autre» – entendez le point d’incandescence du deuil atteint par celui qui parle (mais qui parle ici? qui est parlé?), quand la mort se trouve partagée ou plutôt échangée entre ces deux hommes au rêve habitué, l’un mort, l’autre non, mais lequel?, renversement vertigineux que maintiendra la conférence jusqu’en ses toutes dernières lignes1, et qui veut que celui qui reste est peut-être bien celui qui est mort, qui parle depuis la mort, saisi vif par elle qui le hante; le mort en matière de poésie est rarement celui qu’on croit.
La place du mort en matière de poésie est rarement celle que l’on croit: parce que le temps du rêve n’a rien de commun avec le temps social, parce que tant d’hommes qui arpentent désertés par les rêves le terrain social parlent plus morts que vivants, et qu’il suffit d’ouvrir La Vie de Henry Brulard, de Stendhal, pour être saisi par la vie qui l’habite, le porte, nous emporte au brouillon des songes, là où les mots de Stendhal sont infiniment plus puissants et vivants que ceux des contemporains qui bavardent à nos côtés.
*
Lire Mallarmé, écrivait Paul Valéry, c’est se trouver «insensiblement engagé à réapprendre à lire».
L’œuvre violemment volontariste de Mallarmé est en cela exemplaire de toutes les grandes œuvres, qui toutes portent cette nécessité d’apprendre à lire autrement et les livres et le monde. Mais qui veut apprendre à lire autrement qu’on lit le journal, ce journal qu’on lit justement pour s’y rassurer du défilement des jours vécus comme il était prévu qu’ils le soient?
Quant à Mallarmé, il écrivait on ne peut plus clairement à Edmund Gosse, en 1893: «Non, cher poète, je ne suis pas obscur (mais) le deviens, bien sûr! si l’on se trompe et croit ouvrir le journal»1.
L’inverse peut être vrai. Mais apprendre à lire Mallarmé, c’est aussi, justement, apprendre à lire autrement le journal, à lire sous ce qui s’y dit ce que le journal lui-même n’imagine pas y être. (Mais qui veut que les individus apprennent à lire sous la prose aplanie du journal ce qui excède ou mine le message véhiculé vers son «cœur de cible»?).
*
Sur le chemin des mots que Mallarmé cherche pour trouver la possibilité de parler vivant du plus proche de ses amis mort, pour faire entendre autre chose que la nécrologie morbide et réaliste du journal, cette virgule est comme une petite pierre sur laquelle trébuche le sens au moment où il écrit, qui ouvre à une autre dimension, et du temps, et de la langue, pour y laisser jaillir une émotion réelle.
Cette autre dimension du temps et de la langue (qui n’est nulle part ailleurs que dans le temps et dans la langue) est celle que je veux ici définir comme verticale, par opposition à l’horizontalité à laquelle prétend les réduire la scène sociale, et c’est pourquoi j’y insiste: cette virgule est une façon de hiatus (et par là, comme le précise le dictionnaire, de «solution de continuité» – comment continuer dans le vertige du deuil?), une façon de micro-scandale au fond, au sens étymologique de ce beau mot de scandale1, sur laquelle à son tour le lecteur trébuchera, contraint aussitôt de quitter la route droite du sens commun – s’il veut bien l’entendre, cette virgule, patte de mouche à peine sur la page, plutôt que de la renvoyer à l’absurdité ou la coquetterie stylistique.
Revue de presse
Verticalités de la littérature
Pour en finir avec le jugement critique
Extrait de presse
LE MONDE
(7 octobre 2005)
LITTÉRATURE CRITIQUE
SI LA LITTÉRATURE est bien une démarche de connaissance de soi et du monde, la critique littéraire, y compris journalistique, doit l’être également, à son niveau. Attachée à la littérature qui est en train de se faire, dépendante d’elle, orpheline et sans objet hors d’elle, la critique, du moins en ses meilleurs moments, ne se contente pas d’accomplir une tâche de médiation et de promotion – celle à laquelle on l’incite ordinairement à servir. Elle participe de cette connaissance, la complète. L’adjectif «littéraire» ne devrait pas avoir, ici, un autre sens.
Ses meilleurs moments? Ceux où elle se pense elle-même et s’accorde assez de dignité pour ne pas s’uniformiser et devenir un simple relais dans la bien nommée «chaîne du livre». Ceux où, de la littérature, elle a quelque chose à dire. Bertrand Leclair, qui est écrivain, journaliste et critique littéraire – il prend soin de distinguer ces deus dernières fonctions – à La Quinzaine littéraire, prend justement le risque de penser par lui-même dans Verticalités de la littérature. Pour en finir avec le «jugement» critique
Le partenaire du critique littéraire est moins l’éditeur, ou même l’écrivain, que la littérature elle-même avec laquelle, dans chaque article ou étude, vivant I’«expérience sensible» de la lecture, il entre en dialogue et en résonance. On se fourvoie gravement si l’on ramène ce principe au rang d’une donnée abstraite, bientôt recouverte par des considérations mercantiles ou par «l’inconscience médiatique». C’est pourquoi Bertrand Leclair, avec sagesse et conviction, se refuse à traiter séparément la question de la critique, soit comme cela se voit beaucoup, sur le mode polémique (avec son corollaire, l’invective), soit sur celui du corporatisme. Son propos n’est pas non plus d’avancer une théorie de la critique, mais de tenter de définir en quoi celle‑ci peut, et doit participer pleinement à ce qu’il nomme la «verticalité» de la littérature.
S’appuyant (notamment) sur Bachelard, Proust, Kafka, Artaud, Beckett ou Michon, Bertrand Leclair soutient que la littérature vient, en ses œuvres les plus vives, croiser et contredire l’horizontalité du temps et de la langue ordinaires. L’«instant poétique», qu’il soit de prose ou de poésie, rend alors accessible, sous une forme singulière et Irréductible, le présent et le reel «à la verticale du sens commun».
«On ne sait rien du présent on le connaît.» Leclair distingue soigneusement l’ordre de l’art, qui manifeste une connaissance «sauvage et vitale», de celui du savoir, «domestique» pour ainsi dire, qui «n’est à la connaissance que ce que la culture est à l’art, la réalité au réel, le passé au présent: tout en même temps son irréversible devenir et son horizon.» Pour l’essayiste, cette connaissance n’a aucune vocation à devenir spirituelle ou transcendantale. Objectons que Bernanos, au moins autant que Bataille, a exploré, de bas en haut cette verticalité et qu’il ne s’est pas heurté au vide du ciel…
Lire et écrire ne sont pas des activités étanches l’une par rapport à l’autre. Par son geste, le critique «témoigne de l’expérience littéraire exactement comme la littérature tente de témoigner du réel». Le long détour de Bertrand Leclair n’était donc pas fortuit, mais destiné à aboutir à ce beau mot: «témoignage». A la critique de jugement, ou pire de prescription, à cette «machine à communiquer (à consomme du “culturel”)» qui fonctionne à plein rendement, l’auteur oppose Ia nécessaire experience du témoignage. «Par définition», le témoin est «engagé dans ce qu’il affirme». Jusqu’au plus intime.
Critiquer est, par voie de conséquence, une activité qui ne met pas en jeu une instance extérieure, communicante et surplombante. C’est même, comme le dit pertinemment Leclair, exactement le contraire.
Patrick Kéchichian
ACTION POETIQUE
(mars 2006)
UN LIVRE POUR LA CINQUANTIÈME!
[…] Secousse, stupeur mais aussi force, issues de cette lecture encore récente, celle d’un livre dont son auteur, Bertrand Leclair, avoue qu’en son intention première il ne devait être qu’un article militant «pour une critique de témoignage», c’est-à-dire pour une critique capable de s’enthousiasmer, d’inventer, d’élaborer à partir d’une œuvre, quel qu’en soit le registre, poétique, littéraire, photographique, cinématographique. Une critique qui ne soit pas jugement, mais attestation vivante de la fécondité imprévue, surprenante de l’œuvre en question, de ce qu’elle peut engendrer comme associations créatrices, une critique qui soit poursuite, prolongement inspirés, fût-ce au prix d’un éloignement de l’œuvre et non pas, non plus, compte rendu, recension. A-t-on, justement, jamais mieux qu’avec cet écrit, pris la mesure de la sorte d’emprisonnement, d’étroitesse et de stérilité que véhiculent ces termes, expression récurrente du mesurable; mots d’ordre d’une activité de commentaire consacrée, dévouée à la production standardisée, calibrée, comme on le dit des fruits et légumes. Défense de l’intelligence et de toutes les formes, de toutes les modalités de la pensée, il s’agit là d’un combat, combat sans doute infini, d’une résistance implacable à cette pression commerciale qui ne vise pas seulement à assimiler le résultat de l’activité artistique, intellectuelle à la production alimentaire mais appelle, sollicite, exige du prêt à penser et dont l’objectif est de traiter Le LIVRE par le moyen de la critique «exactement comme l’on traite les hommes dans l’entreprise et partout ailleurs».
Ce sont la quelques-unes des conclusions de ce pamphlet aussi calme et déterminé, récusant tout arrangement, toute forme de tolérance, fuyant le consensus et les codes de la convenance, à même de s’attarder avec délice, parce qu’il en va là d’un trésor de la langue et de l’écriture, sur une virgule mallarméenne que le premier correcteur venu sera tenté d’éliminer ou de déplacer sans même réaliser la portée de son acte, rien moins qu’un assassinat. Mais il faut y insister, le pamphlet en question n’a rien d’un plaidoyer pour le retour à l’on ne sait quel esthétisme. Sa visee et son registre, pour discrets qu’ils soient, et cela participe de la force du propos, sont politiques. Il s’agit bel et bien d’un combat qui n’exclut ni ne condamne l’adversaire mais l’incite à penser, lui donne encore une chance, celle de lire et de créer pour de vrai.
Tout cela n’épuise pas les raisons qui font de cet écrit une date, un moment, un événement. Il faut en quelques mots et pour en situer la portée, en évoquer les fondements.
On pourra me taxer de partialité, d’esprit de chapelle, d’adepte d’une visée réductionniste, peu importe, mon insistance à discerner, à la racine du propos de Bertrand Leclair, les marques d’une lecture achevée, plus encore celles d’une empreinte profonde, je dirais presque de naissance tant elle est exempte de toute forme d’emprunt, de la théorie psychanalytique et plus spécifiquement lacanienne, participe de l’importance de livre. Car dans ce propos, la référence psychanalytique est omniprésente en ces multiples composantes mais cette présence est de l’ordre d’un toujours déjà là n’appelant aucune référence précise, aucune indication bibliographique; elle s’impose en toute sérénité, avec légèreté, produits d’une indiscutable nécesité qui confère, qui rend à la théorie analytique sa dimension de composante incontournable du patrimoine de la pensée et en fait apparaître son articulation structurelle avec une prise de parti philosophique et politique dont la dimension cardinale tient dans le respect de la langue et du langage, partant donc, de l’humain en ce qu’il a de plus subtil et de plus pathétique.
Prise de parti, la démarche se fonde, implique, Jacques Rancièe l’a souligné, une partition première, une division préexistante dont les recouvrements et les déblaiements constituent la matérialité du combat politique. Bertrand Leclair, qui considère comme participant de la possible survie de l’humanité la reconnaissance totale, absolue, de l’expression artitistique, pratique cette partition, exemples littéraires à l’appui, modalité dont les fondements sont inscrits dans ce primat du politique et dans cette prise en compte de la division subjective dont Lacan – l’absence, heureuse, de son nom ne fait que souligner l’importance de son frayage – a fait surgir l’indépassable et l’enjeu. Cela passe par une opposition qui revient tout au long du livre tel un axe conducteur, rappel de la permanence renouvelée de la partition initiale, entre le témoignage, l’attestation agie, marque de l’entame produite par l’œuvre et le jugement, procédure toujours arrimée, à l’idéologie de la mesure, de l’évaluation et du classement. A cette partition initiale, s’articule celle, tout aussi fondamentale, de la verticalité que Bertrand Leclair, dont la franchise de ton n’est pas la moindre des qualités, emprunte à Bachelard et de l’horizontalité, qui délimite les méandres d’un parcours ignorant de ce qui ne peut que lui échapper, l’ordre de ce réel dont le caractère d’impossible est implicitement reconnu dans la méconnaissance même dont il est l’objet.
Verticalité qui implique l’écoute et la lecture autre du texte alors considéré comme partition, au sens musical cette fois, supposant non pas la subordination à une temporalité événementielle mais bien l’interprétation, à la poursuite d’un ombilic inatteignable. Verticalité que tout oppose à cette horizontalité qui intime l’ordre, non d’entendre mais de comprendre – opposition lacanienne s’il en est – et stipule une restitution d’un mot à mot d’où sont exclus l’interstice, la respiration et le silence, soumission réitérée dans ce registre de l’horizontal à une surdité qui n’est pas qu’ inconsciente mais bien plus fréquemment volontaire comme l’est certaine servitude dénoncée dans un texte encore aujourd’hui scandaleux. Avec une patience qui se nourrit de ce qui fut joliment appelé l’amour de la langue, trempé comme le bel acier dans un bain de littérature et de philosophie des plus exigeantes, Bertrand Leelair pose les jalons d’un champ clos, celui où ne cesse de se dérouler cet affrontement entre la connaissance, ordre de la verticalité qui ne connaît pas de fond mais se fonde dans l’intériorité, et le savoir, ordre d’une horizontalité qui pour demeurer collée a l’omniprésence de la réalité rate le réel, l’impossible.
Bertrand Leclair parlant de ce travail, de son travail use des termes livres ou essais. J’ai usé de mon côté de celui de pamphlet mais ce n’est pas récuser de telles appellations que de recourir à celle de Manifeste pour qualifier cet appel tous ceux qui ne renoncent pas à penser, qui refusent de se laisser leurrer par la fausse pensée inscrite dans cette horizontalité médiatique qui ne reconnaît que la fausse monnaie d’une audience aussi fragile qu’éphémère, rançon d’une soumission inconditionnelle à l’actualité.
Michel Plon