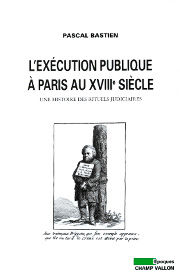Après avoir lu une dernière fois l’arrêt de mort, le greffier s’approche de la croix de Saint-André où le condamné est attaché. Il lui demande si de dernières déclarations restent à faire puis, en réponse à son silence, fait signe au bourreau que le temps est venu. La barre de fer s’abat, le corps est brisé. L’échafaud et le feu qui consumera le corps désarticulé offrent à la foule le spectacle de la justice.
L’exécution publique à l’époque moderne a souvent été décrite par l’historiographie comme un théâtre de peur, de violence et d’obéissance: selon Michel Foucault et les historiens qui s’en sont inspirés, elle réparait sur le corps du condamné la souveraineté divine et humaine blessée par le crime. Pourtant, les rituels judiciaires du châtiment s’inscrivent dans une réflexion plus large, plus complexe sur le droit et la morale: ils constituèrent un dialogue constant, voire une négociation, entre le justiciable et l’homme de loi. L’objet de ce livre est de reconstituer ce dialogue.
Au carrefour des paroles, des écritures et du spectacle, Pascal Bastien entend expliquer les rituels de l’exécution dans le Paris du xviiie siècle: bourreaux, condamnés, greffiers et confesseurs partagèrent et échangèrent, avec la foule et les magistrats, un «savoir-dire» du droit qu’on aurait tort de réduire trop simplement à la potence ou au bûcher. Hors des tribunaux, où la procédure était tenue secrète jusqu’au droit révolutionnaire, l’exécution publique fut un moyen de communiquer le droit par une mise en mots et en images du verdict. Elle fut aussi un instrument dynamique et efficace du lien social entre l’État royal et ses sujets; de fait, la peine devint au XVIIIe siècle l’espace et l’instant d’un nouveau jugement, celui des justiciables à l’égard de leur justice.
Plus que le châtiment à proprement parler, il s’agit ici de reconstituer et d’analyser les différentes articulations du spectacle de la peine à Paris au xviiie siècle. De la circulation des arrêts imprimés à la marche du bourreau dans la ville, et des mots du greffier lancés à la foule à ceux du confesseur consolant le condamné, l’exécution publique se révèle comme un événement capable, malgré ses contradictions internes, d’assurer une profonde cohérence à l’imaginaire judiciaire qu’elle participait à créer. Ce fut dans les rues de la ville que le Parisien attendait, espérait, consentait ou contestait la justice du roi.
Lire un article
L’exécution publique à Paris au XVIIIe siècle
Extraits de presse
LA QUINZAINE LITTÉRAIRE (2 juin 2006)
L’éclat des supplices
Le livre de Pascal Bastien est particulièrement bienvenu pour comprendre, en évacuant tout pathos, l’exécution publique telle qu’elle se pratiquait réellement à Paris au XVIIIe siècle, et pour proposer une remise en perspective des variations d’un rituel du Moyen Age à la Révolution.
A la différence de Michel Foucault qui ouvrait Surveiller et punir (Gallimard, 1975) par la description du supplice de Damiens, Pascal Bastien écarte d’emblée l’anecdote et le spectaculaire pour démythifier le système punitif judiciaire de la monarchie absolue. Avant toute tentative d’interprétation, il commence par évaluer la fréquence des exécutions publiques à Paris au XVIIIe siècle. Le pointage dans les minutes des cours de justice parisiennes indique une augmentation très nette sur le siècle, mais la peine capitale n’y tient qu’une part somme toute restreinte et en diminution. Le spectacle habituel de l’exécution publique n’était donc pas la mort mais l’amende honorable, le fouet, la flétrissure, l’exposition au carcan ou au pilori. La mort par pendaison, ou par la roue, n’était pas, de loin, un spectacle quotidien. Les supplices médiévaux: mutilations, enfouissement, ont complètement disparu, tout comme le bûcher depuis le XVIIe siècle. Quant à l’écartèlement du régicide, les Parisiens ne le virent que deux fois aux XVII et XVIIIe siècles, pour Ravaillac en 1610 et pour Damiens en 1757.
L’exécution publique ramenée à sa juste mesure, l’auteur s’intéresse ensuite aux arrêts imprimés par ordre du Parlement de Paris, de 1711 à 1790, de courts feuillets qui publient le texte du jugement rendu par la cour. Très rares au XVIIe siècle, les arrêts imprimés deviennent tout à fait ordinaires à la fin de l’Ancien Régime. La décennie 1720-1730 forme un premier pic, lié à la multiplication des condamnations de la bande du fameux Cartouche, mais c’est surtout après 1750 que la publication des décisions de justice enfle, trahissant un besoin de communiquer, d’expliquer les châtiments, au moment où leur visibilité diminue dans l’espace parisien. La publication des arrêts répond ainsi à la multiplication des mémoires judiciaires étudiés par Sarah Maza (Vies privées, affaires publiques. Les causes célèbres de la France prérévolutionnaire, Paris, Fayard, 1997), dans une sorte de compétition pour gagner l’opinion publique. Même si la justice royale n’est pas légalement tenue de motiver ses décisions, l’arrêt imprimé, détaillant les circonstances du crime, cherche à convaincre le lecteur de la noirceur du criminel, qui mérite la peine. Un déplacement s’opère, entre le supplice manifestant la puissance de la justice royale vers la démonstration de la responsabilité du condamné.
L’auteur convoque ensuite les sources narratives bien connues des historiens du xviiie
siècle: les journaux de Buvat, Marais et Barbier, ainsi que l’extraordinaire collection du substitut du procureur Thomas-Simon Gueulette, qui accumula et annota placards, arrêts, mémoires judiciaires, estampes et «canards». De ces témoignages ressort surtout l’indifférence des Parisiens au spectacle ordinaire et banal de l’exécution publique. Seules les exécutions capitales des criminels célèbres, ou celles dont le déroulement a été perturbé par un incident quelconque retiennent leur attention. A partir de là peut se construire une réflexion sur le rituel et ses inflexions au XVIIIe siècle.
Pascal Bastien ne se contente pas de nous placer au pied de l’échafaud, il reconstitue minutieusement les étapes du spectacle de la peine pour en comprendre le sens global. Il rend ainsi une importance souvent négligée au parcours du condamné, à pied ou dans le tombereau, un parcours qui s’adapte aux circonstances de la vie urbaine, qui évite les petites rues trop embarrassées. Il montre que le lieu d’exécution – place de Grève et Halles, le plus souvent – n’a rien d’immuable. La volonté pédagogique évidente de l’exécution sur le lieu du crime doit souvent être modulée. Pour l’exécution des serviteurs condamnés à mort pour vol domestique, par exemple, une peine de moins en moins acceptée par l’opinion publique au XVIIIe siècle, le spectacle doit souvent être déplacé au carrefour le plus voisin et non devant la maison du maître qui a denoncé son serviteur indélicat. L’auteur rend aussi leur place aux acteurs négligés du rituel : le greffier criminel qui répète la lecture du jugement, déclenchant la peine, le confesseur à qui revient la tâche bien difficile de faire coïncider l’espoir de la grâce et de la rédemption divine lorsque la justice royale prononce l’anéantissement du condamné. La parole judiciaire ou consolatrice fait écho à la parole du condamné, qui peut à son tour prendre place dans le rituel, par le «testament de mort », à ne pas confondre avec le discours d’échafaud – qui ne se rencontre guère en France –, ultime confession du condamné au pied de la potence, qui suspend l’exécution parfois pendant de longues heures. Le spectacle de l’exécution apparaît donc dans sa souplesse moins comme une liturgie figée du pouvoir, mais comme un ensemble de pratiques obligées et de compromis négociables.
L’auteur s’éloigne alors quelque peu du XVIIIe siècle pour chercher les significations du rituel de l’exécution publique. Sa démonstration savante, appuyée sur une solide bibliographie anthropologique, manque par endroits de clarté, mais est toujours stimulante. Utilisant divers écrits juridiques ou religieux (la relation du confesseur de la Brinvilliers est longuement mise à contribution), Pascal Bastien voit pour l’essentiel, dans l’exécution publique, un rite de passage d’infamie, qui commence dès que le bourreau touche le corps du condamné. Souvent, l’infamie est plus redoutée que le supplice, car elle rend difficile la réinsertion dans la société, même en cas de peine non afflictive. Dès le XVIIe siècle, l’exécution perd toute dimension de sacralité religieuse. Ce n’est plus l’intervention de Dieu ou de la Vierge qui peut sauver in extremis le condamné, mais la grâce royale, qui devient d’ailleurs la seule maniestation du roi. toujours absent de la scène de l’exécution. Les témoignages enfin, comme les rares émeutes d’échafaud repérées par Jean Nicolas (La Rébellion française. Mouvements populaires et conscience sociale, 1661-1789, Seuil. 2002) corrigent la vision d’une foule contestant les supplices. Les Parisiens, assidus aux exécutions capitales, ne remettent pas en cause la justice du roi et ne semblent guère sensibles à un adoucissement des moeurs. La foule proteste quand les maladresses du bourreau dépassent les bornes. sans se révolter cependant. La plupart des exécutions publiques ne nécessitent pas de précautions policières particulières. Le recours aux troupes et l’éloignement de la foule de l’échafaud sont très rares et s’inscrivent dans un contexte particulier, comme en 1775, lors de l’exécution d’émeutiers à la suite de la «guerre des farines». Là seulement, l’exécution publique est insupportable à l’opinion publique qui refuse de considérer ces hommes comme des criminels.
En bout de compte, les déplacements apparemment minimes du rituel de l’exécution publique au cours du XVIIIe siècle ont suffi pour lui épargner les remises en cause de la procédure judiciaire, attaquée par la philosophie des Lumières. La torture judiciaire est désormais jugée inutile et barbare, pas le supplice public. Et Pascal Bastien de souligner, in fine, les continuités dans les rituels de l’exécution publique sous la Révolution – à la guillotine près – avec l’Ancien Régime.
Catherine DENYS