Comment faire une danseuse avec un coquelicot
Les premières pages
Mars
Quand ma grand-mère décidait de s’occuper de ses fleurs, elle laissait ce mot à la porte au cas où une amie passerait. Un neveu, une de ses sœurs, un vieux copain:
Je suis
au jardin.
Sur un bristol usagé.
Ma grand-mère m’a donné un jardin. Je ne lis pas encore, je ne vais pas à l’école comme les autres. Mon grand-père lit le soir les contes d’Andersen. La journée, je peux rester des heures devant les images du livre. Ma grand-mère est au jardin. La petite sirène a un jardin. Elle ne va pas à l’école non plus. Je veux un jardin. Je demande un jardin. Accordé. Un petit carré.
Ma grand-mère regarde beaucoup son jardin. Regarder fait partie du jardinage. Mon grand-père se promène dans les allées en griffonnant sur des bristols usagés qu’il sort de ses poches. Je croyais qu’il écrivait des mots, des phrases, les histoires sans doute qu’il racontait le soir et dans les moments libres ou en voiture. Or, ces histoires qu’il semblait avoir vécues, j’ai découvert très tard qu’il les avait lues chez Conrad, Melville, Stevenson. Des histoires qu’il aimait trop pour en rester là, pour ne pas les raconter encore. Tout commençait entre Binic et les Sept îles, avec une percée vertigineuse dans les territoires de Guingamp ou de Crozon. San Francisco c’était l’Arcouest, le fleuve Congo s’étirait comme chez lui dans le lit du Trieux. Le canal de Suez, de Panama et de Nantes à Brest ne faisaient qu’un.
Les griffonnages du jardin, c’étaient des chiffres. Ma grand-mère ne griffonnait pas. Mais après la mort de grand-père, elle s’y est mise à son tour. Pour moi, ils ont la même écriture. Comme il existe un timbre de voix d’époque. Par exemple, quand on entend un enregistrement de Sartre, de Yourcenar ou de Queneau à la radio, on entend la voix de ceux qui sont nés au début du vingtième siècle. Si bien que, sur le mot à la porte, je vois d’abord le tracé d’une écriture d’époque et presque en même temps le mot jardin.
Ce qui me les rend présents tous les deux en même temps. Elle qui regarde les fleurs, lui qui se promène en griffonnant.
Surtout, ils sont là.
Depuis peu je lis le soir, au petit garçon qui devient grand, l’œuvre féerique en trois tomes que John Ronald Reuel Tolkien, citoyen britannique né en 1892, a composée au cours des années cinquante. Il a bien fallu répondre à la question «Quoi lire après La coupe de feu?» Bien sûr, il y a une vie après Harry Potter. Et même avant. Nous avons lu Moonfleet, L’île au trésor. Nous partirons pour Le merveilleux voyage de Nils Olgerson à travers la Suède. Le libraire passe commande. Et en attendant? Je ne connais pas Le Seigneur des Anneaux. Aïe, mille trois cent pages! Allons-y.
Une initiative louable où je vais perdre cinq mois de ma vie. De lecture du soir. Au troisième jour d’entame d’un ouvrage encore plus compact qu’il n’y paraît, après un quart d’heure de lecture de bonne volonté, je me tourne vers mon jeune Jacob avec la ferme intention de lui dire, On arrête. Mais lui, rose de bonheur, déjà à fond avec Gandalf, Bilbon et autres fripons: C’est bien, hein, maman! Allez, tu lis?
Le moment est venu de lui révéler combien j’en ai sauté, des passages concernant l’histoire des Hobbits, Petites Personnes aux grands pieds poilus, au caractère heureux et à la longévité biblique. Le moment de lui révéler que j’ai à peine survolé le chapitre des documents d’archives de la Comté, le pays de ces Hobbits ou Semi-hommes que je vois assez bien, sans tarder, drapés de l’étoffe des héros à plein temps. Le moment de lui révéler, enfin, que les chansons de Bilbon en vers de mirliton, je ne les chante pas toutes, parce que…
– Allez, maman, tu lis?
L’amour est un grand lecteur. Qui vous embarque vers des mondes dont vous ignoriez tout jusque là, vers des connaissances dont vous auriez parfaitement pu continuer à vous passer. L’amour vous ôte jusqu’à la possibilité de vous plaindre: vous lisez avec ses yeux désormais. Vous vous sentez comme Frodon qui a accepté de se rendre à l’autre bout de la Montagne du Destin sans savoir ce qui l’attend. Et encore, s’il y parvient. Et vous avec, n’est-ce pas, puisque vous êtes du voyage.
*
La cabane
Quand il fait la visite, Jacob commence par «le jardin du rhodo». Rhododendron, un sauvage on ne peut mieux acclimaté, hauteur maximale, confortable embonpoint entre un budléïa bleu et un immense camélia rouge, avec à ses pieds quinze jours par an, le muguet. C’est mon jardin, déclare-t-il. Et négligeant de préciser que Vita, sa grande sœur, le surnomme «mon Rodo», il prend sa part de l’admiration qui va au volumineux arbuste couvert de grappes violettes. Le visiteur conçoit sans peine qu’à bientôt onze ans, ce garçon souriant, disert, soigne les fleurs et compose des bouquets pour les amis. D’ailleurs, sécateur bien en main, il demande, C’est quoi vos fleurs préférées?
Il a peut-être même conçu et dessiné ce coin frais en été, premier à fleurir dans l’hiver. Il explique bien qu’après la floraison du rhodo, il est recommandé d’enlever les centres fanés pour fortifier l’arbre, multiplier les fleurs.
– Mais nous on ne le fait pas, ça fleurit tellement déjà.
Vient ensuite le jardin de papa, le jardin bleu. Papa ne fait pas le jardin, mais il voulait du bleu sous ses fenêtres, alors vas-y que je te centaurée blue boy et lupins gentilhomme! Héliotrope sous les hostas, violettes avec anémones avant les verveines et les iris, le tout se poussant du col au fil des saisons pour ne pas disparaître sous les coussins de myosotis qui se ressèment davantage chaque année. Du bleu, il en veut, il en a. À la demande. Et des fuchsias sky rocket, que j’ai défendus jusqu’à l’idée fixe contre les limaces.
Le reste, très vite, on passe. Ah, enfin, Nous voici à la cabane, dit Jacob avec un grand sourire. J’ai les clés? Vous pouvez sonner la cloche si vous voulez. Au-dessus de votre tête, vous voyez?
Le visiteur fait sonner la cloche. La porte s’ouvre.
C’est un deux-pièces-électricité-chauffage (il suffirait de remettre le poêle en route), aménagé par le premier habitant d’ici, un prof de maths bricoleur raisonnable pendant ses années d’enseignement, collectionneur fou de n’importe quoi après la retraite. Cargaisons de bouchons, collections de flacons et de boîtes vides, fonds de peinture, d’huile de voiture, de produits de jardin et de pharmacie. Également des outils lourds de rouille, des tiroirs de pépites sans nom, d’étonnants fétiches et autres curieux trésors récupérés en vue de grands projets à jamais suspendus dans les limbes.
La première pièce accueille le matériel horticole. Du léger. Le carillon Westminster de mon grand-père a trouvé sa place ultime sur un escabeau trop amoché pour bouger du mur. Le mécanisme d’horloge est cassé. Pas la musique. Le premier geste en entrant dans la cabane: tirer sur la petite ficelle attachée au carillon: «Dingdong-dingdong. Dongdong-dongdong. Dong!»
Derrière la seconde porte -qui «doit» rester fermée à clé, se trouve la pièce intérieure, le cœur de la cabane, le sanctuaire. J’ai été invitée à venir voir ce cabinet autrefois réservé au professeur, royaume actuel de mon écolier, une fois que tout a été arrangé.
Les reliquats d’activités du premier habitant voisinent avec les chantiers plus récents. Bazar d’outils par terre, mécano et clous répandus partout, craies écrasées dans les bouts de ficelle, festival de copeaux de bois, chutes de carton. David, heureux père, a souvent du mal à garder son calme. Et rien ne peut l’irriter autant que la question des clés de la cabane. Tu les as rangées, tu sais où elles sont?
À l’origine déjà, les clés étaient perdues. Premier été, on fait connaissance avec les lieux. Mon frère et sa famille viennent nous voir. Impossible d’entrer dans la cabane.
– Je vous les trouve, ces clés, a dit mon frère. Il est où, le grenier?
– C’est un faux grenier, on ne peut pas y aller, il n’y a pas de plancher.
Mon frère a souri. Enfant, il avait obtenu d’habiter le grenier de la maison où nous sommes nés, un peu comme j’avais obtenu un jardin. Il avait ses quartiers dans le pigeonnier où l’on accédait par une échelle de meunier, là même où ma grand-mère cachait du monde pendant la guerre 39-45 et aussi des faux papiers, un deuxième poste radio, l’ensemble devant se ramasser en cas d’alerte dans les double-fonds qu’elle avait aménagés avec un système de portes coulissantes et beaucoup de gingin. À l’habitant de ce repère-là je disais: Le grenier, on ne peut pas y aller.
Mon frère a poussé la porte, a regardé le vasistas, s’est avancé en équilibre sur les poutres tandis qu’à l’entrée, on lui lançait des mises en garde inutiles ou dangereuses.
Indifférent, après quelques avancées prudentes mais franches, mon frère s’est arrêté, a fixé un point dans le vide du faux plancher, s’est accroupi, a tendu la main et:
– C’est bon, je les ai.
Revenu vers nous, vers les «Bravo bravo, vraiment t’es fort», mon frère a déclaré: C’est pas le tout! Puis il s’est lancé dans l’escalier comme s’il y avait le feu. On dévale derrière lui, les cousins se bousculent. Devant la porte de la cabane, mon frère agite les clés.
– Vous êtes prêt?
Et quand enfin il a ouvert sur le capharnaüm, après qu’il ait posé le premier un pied dans le sanctuaire, on n’a plus entendu que des «Oh», des «Ah», des «Regarde, papa!» «T’as vu, là! Oh et ça!»
Les filles sont restées dehors.
Découverte et bricolage. Fil nylon, mouches, vis et bouts de crayons ont été triés. Au mur, la première boîte à outils de Jacob s’ouvre en triptyque. Sur l’établi nettoyé mais pas trop, il a posé son microscope. D’étranges objets de pêche et de pyrogravure sont demeurés suspendus ça et là. J’ai emporté le plan des arbres fruitiers établi par le créateur du jardin en 1960. Un agrandisseur photo trône à tribord. Il ne sert plus, mais on ne peut pas le jeter – c’est le piège.
Les filles ne se battent pas pour entrer dans le saint des saints. Elles apprécient plutôt «la maisonnette» du dehors, et la vigueur du lierre Marengo qui, guidé en manchon, cache artistiquement la gouttière au-dessus de la réserve d’eau. Les messieurs, eux, tous âges confondus, tombent sous le charme de la cabane au fond du jardin. En sortant on se souvient de choses qu’on n’a pas vécues et qui font parler. On aimerait y retourner seul, pour s’asseoir devant l’établi, toucher les outils, être celui qui ferme à clé à l’envers à cause de la serrure récupérée.
Bien des expériences ont lieu là. Les allumettes sont interdites, mais la boîte de chimie reste à portée de la main. On y forge des armes pour la guerre contre Saroumane, on y distille de puissants poisons auxquels on donne des noms de fleurs à terminaison latine façon Astérix. On y rédige des indices de chasse au trésor comme les déductions d’enquêtes de «Cherlok Homme.» Des camions en chutes de contre-plaqué -Vrrm, Vroum– en sortent avec inscrit à la craie: «Transport pour les gens». On y invite un copain quelquefois, on aime à y «réfléchir». Un soir de long printemps, à force de réfléchir sous la lumière ronde du projo solitaire, Jacob s’est endormi, la tête sur l’établi.
– C’était trop bien d’être là comme au fond des bois avec toutes les énigmes.
*
L’amitié
Dans le prologue de son livre, Tolkien nous apprend que les Hobbits aiment «la tranquillité et une terre bien cultivée». Ils ne pratiquent pas la magie, ils ont «une amitié intime avec la terre».
– Tu vois, dit mon jeune auditeur tandis que je parcours le journal au premier soleil frisquet, Harry Potter il «apprend» la magie, il «fait» de la magie. Mais dans Le Seigneur, ils «sont» magie. Donc. «Donc,» ils n’ont pas besoin d’apprendre.
– Hmm.
– Ils n’ont pas «besoin», tu comprends?
– Hmm!
– Ils «sont»!
Sur quoi mon fin comparatiste va jouer aux pirates (un pluriel, toujours plusieurs pirates): Chw! Ha! À l’abordage! Mais bientôt il lâche la brouette-gallion espagnol pour revenir à la table. Songeur.
– C’est la magie, c’est comme l’amitié.
– Ah bon?
– Comme je t’ai dit, Harry Potter, il apprend la magie. Que dans Le Seigneur ils «sont» magie.
– Ah bon?
– T’as pas compris?
– Redis voir…
– L’amitié, on n’a rien «besoin» de «faire», on est de l’amitié ensemble. Tu comprends, là?
– J’essaie.
– Dans Le Seigneur, ils «sont». Tu les verrais pas apprendre des tours comme moi ou Harry Potter! Ils «sont une amitié» avec le monde entier, ils sont magie. Avec les copains, on joue, on «fait» des jeux, il faut toujours «faire» quelque chose avec un copain. Avec un ami, on n’est pas obligé de jouer. On «est» juste avec son ami. L’amitié quoi, la magie qu’il y a pas besoin d’apprendre, tu comprends?
Il paraît essoufflé.
– Oui, je comprends. Bien sûr, je comprends.
*
Figure de la jonquille
Les premiers dimanches de sa vie, aux beaux jours, quand il allait avec son père dans la forêt de Senlis, jouer aux Indiens, construire des cabanes, il me ramenait des jonquilles sans tige, à la mesure des petites mains. Tiges de plus en plus longues bientôt. Je plaçais les bouquets dans les vases et les vases sur le buffet face au canapé. On s’installait pour admirer les jonquilles, il me racontait la forêt.
Il regardait de travers le bouquet de jonquilles des bois quand j’en achetais un dans la rue. La jonquille rejoint la première joie, la première fois qu’on offre des fleurs à une fille.
Ensuite nous sommes allés vivre sur la côte avec rochers dans le jardin et jonquilles plus précoces que celles des avenues à Paris. Plus grosses qu’en forêt de Senlis. Puis nous avons quitté la côte pour la petite ville où les premiers gestes du jardin ont été pour les jonquilles sauvages découvertes sous les ronces et les branches cassées.
J’en ai pris soin, je les ai mêlées à des bulbes sophistiqués de plusieurs intensités de jaune, excepté au jardin blanc où les narcisses comme du papier parfument autant que du jasmin ou des tubéreuses.
Jacob, trop content d’être invité chez Évariste la première fois, fonce dans le jardin. J’ai suggéré d’apporter un bouquet à la maman. Le temps de trouver le sécateur, la douzaine de premières jonquilles a fait place nette. Il n’y avait que ça, des jonquilles, pour le coup d’œil par la fenêtre de la cuisine. David, comme les Hobbits, déteste ce qu’il appelle «la terre noire» et demande chaque matin quand ce sera «fleuri». Jacob, ravi, tient au poing une assemblée de museaux jaunes, perplexes.
– T’as vu comme il est beau mon bouquet?
Sourire crispé. Calme.
– Tu peux ajouter un peu de verdure.
Il se précipite de nouveau sur les jonquilles.
– Non! Pas de jonquilles, plus de jonquilles. Là, ce sont des boutons. Non, ils ne s’ouvriront pas. On va plutôt prendre quelques camélias.
– J’adore les jonquilles, il dit. Y’a aucune fleur «plus beau» qu’une jonquille.
En réalité il ne voit que la jonquille, se désintéresse complètement de la production du jardin après les jonquilles. Pour lui il y a «la» jonquille et les fleurs. Cette année encore il a de longs Oh d’attendrissement. Jean-Luc au téléphone lui demande, Alors ce jardin, dis-moi? Y’a des jonquilles, il dit. Il les décrit, en donne le nombre exact d’épanouies, redit comme elles sont belles et quand à l’autre bout du fil: Tu es sûr que ce ne sont pas plutôt des narcisses? La jonquille est un narcisse, répond-t-il sans hésiter. De la même famille, tu sais?
Gare de Lyon ce soir, j’attends Jean-Luc. Comme à Montparnasse, à Austerlitz ou Saint Lazare, beaucoup de fleurs descendent avec les bagages en mars. En avril, les lilas, mais en mars, c’est la jonquille qu’on voit danser le long des sacs plastique. En mai, moins de fleurs, alors qu’il en vient bien plus au jardin. En juin, plus rien.
Un couple avance comme un seul homme au pas de charge. Monsieur tient au bout du bras un sac Darty rempli de jonquilles de jardin. Voilà Jean-Luc.
Le pas de charge nous dépasse pour s’arrêter net au milieu de la galerie vers la sortie. Les bagages sont lourds.
– Je peux porter les fleurs, propose Madame.
– Sûrement pas, répond Monsieur. J’ai pas confiance.
– Ce que tu es gamin, dit Madame.
On sonne à la porte. Un garçon d’à peine dix ans. Billets de tombola ou ballon envoyé dans le jardin? Bonjour monsieur, est-ce que je pourrais cueillir des jonquilles, s’il vous plaît? C’est pour ma grand-mère. J’habite le HLM derrière. Attends là, dit David. J’attrape le sécateur. Le soir il nous raconte la visite.
– Tu as bien fait papa, il vaut mieux prendre le sécateur, dit Jacob. Pas facile à cueillir, une jonquille. Ah! C’est pas toujours facile, la jonquille!
L’air coquin qu’il a eu.
Mercredi
Ils vont d’une cabane à l’autre en claquant le portillon. Je bondis à la fenêtre. Évidemment, il n’y a personne. On entend les rires, ils disparaissent vite dans la rue, Xavier habite trois maisons plus loin. Le mercredi, il faudrait travailler dans un bunker étanche pour ne pas être dérangée avant l’heure du goûter. En plus, aujourd’hui, il y a la cabane de Xavier, nouvellement aménagée, à visiter. Les tantes ont fourni du mobilier, un coffre bourré de trésors. Il faut que tu voies, Il faut que vous voyiez.
– Et ça?
Devant la cabane de Xavier arrangée en Q.G. de campagne du club des Cinq, un morceau de bordure de grillage entoure quelques jonquilles écrasées.
– On les protège contre les grands prédateurs.
– Il y a des prédateurs à part vous?
– Oh, maman, on les avait pas vues et…
Alors Xavier, yeux écarquillés, l’air plus déterminé que quand ils jouent à C’est-nous-qui-mène-l’enquête, avance d’un pas.
– Elles ont poussé là sans qu’on sache. Maintenant on sait, alors on les défend! Ma théorie -aux choses sérieuses il faut toujours une théorie-: la jonquille est la tendresse du jardin. La primevère, plus précoce, fait figure d’éclaireuse. On la regarde sans l’emporter, on l’offre en pied, pas en fleur. La jonquille est plus civilisée.
Le soir
– Hein maman, hein?
Jacob me parle tout en faisant un dessin pour Kasaïné, son copain d’Afrique. J’ai entendu passer des lions, des roses. Des tortues menacées de disparition, entendu parler de jonquilles et de jonquilles, qu’est-ce?
– C’est comme tu disais, maman que Vita, c’est la figure de la jonquille.
– Quoi?
– Donc j’ai écrit: Salut Kasaïné, je t’écris de ici où y’a plein de jonquilles dans le jardin et ma sœur vient nous voir samedi et, hein je peux mettre, euh, c’est la figure de la jonquille.
– Je disais ça, tu es sûr? Attends, il va rien comprendre, Kasaïné. Ce n’est pas plutôt la figure de la jeune fille? Attends, on s’emmêle, là.
– Mais c’est quand même bien si on dit «figure de la jonquille»?
Les garçons adorent les jonquilles. La seule théorie qui vaille: Pour les garçons, la jonquille c’est la jeune fille.
*
La vie de l’arbre
Un dimanche, le printemps s’annonce sans prévenir. La texture de l’air est plus fine, on remarque les renflements au bout des tiges, il y a des chatons sur le bois des arbres. De jeunes feuilles fripées. L’après-midi se prête à la taille des arbres qui ont besoin d’air, de lumière. J’ai demandé à David de bien vouloir couper les vieilles branches mortes. Et de rectifier les avancées aberrantes de certaines autres. Je marquerai les emplacements au crayon forestier.
Mon scieur du dimanche arrive à l’aucuba japonais. Les entrelacs d’horizontales exigent un dégagement central, de belles branches étouffent. Il faut aussi en supprimer de vigoureuses, les feuilles entièrement vertes contrarient la panachure jaune de l’ensemble. Si on n’y veille, elle aura bientôt disparu, colonisée par le vert uni d’origine qui essaye sans cesse de revenir.
Le bruit de la scie s’est arrêté. Que fait le travailleur, accoudé à l’avant-bras d’une branche maîtresse complaisamment avancée à sa hauteur? La scie est posée contre le tronc et au lieu du bruit de l’outil en action, j’entends que l’on murmure: Ça sent bon on on on…
Les pieds dans le lierre saupoudré de sciure fraîche, la tête au creux du coude, mon fiancé est tombé en pâmoison dans la vie de l’arbre. Il demeure comme enivré, souriant.
*
Le train regarde les jardins
C’est d’abord une ligne droite, une courte horizontale. Puis une sombre petite surface, un quadrilatère découpé au milieu du vert. Un jardin. L’envie de modifier l’état du monde, de le voir s’épanouir. Il y suffit d’un peu de travail. Le plaisir qu’on y prend éloigne les chagrins et rend content. Longtemps.
Orléans-les-Aubrais: une langue de terre au milieu des champs un peu jaunes. Le vert vient, sans s’être encore imposé, il est jeune. Un grand diable laissé là, les bras levés, achève de donner au lopin fraîchement retourné une aura moyenâgeuse.
Entre Cher et chemin de fer, jardins familiaux en bord de rivière. Petites parcelles, grandes largeurs. Les barrières sont ouvertes, un joli débraillé règne, une effervescence sans rien qui urge. Il y a deux semaines, voile de l’immobilité, tout dormait. Près de la terre préparée, on distingue un seau, une tête de binette, un bac en plastique. Des hommes parlent devant les carrés, deux par deux, droit plantés, copains de jardin prêts à échanger conseils et boutures. Cascades rose froid des groseilliers en fleurs. Un sachet de graines bouchonné sur le tuteur signale le semis. Une couleur suffit à dire l’activité humaine, l’été qu’on anticipe, le projet, l’indécrottable besoin que quelque chose arrive. D’ailleurs un petit garçon court vers les hommes du jardin, une feuille de papier à la main.
*
Perdue dans la terre
– Tu pleures? Qu’est ce…
Il a perdu une de ses «plus belles billes» dans le jardin. Où? Dans quel coin?
Il lève les bras en soufflant, la figure rouge barbouillée de larmes comme dans Poil de carotte. Mon nounours, se mettre dans des états pareils, ça s’est passé où? Parterre, allée?
– Une bille ça roule, tu t’rends pas compte!
– Oui, mais où? Elle a roulé dans quelle direction?
– Dans la terre.
Je soupire. Il dit: Tu vois!
C’est comme découvrir un infini du jardin. Sa véritable nature. Son double fond. C’est comme disparaître dans l’eau, dans la nuit. On croyait se mouvoir en surface et voilà qu’une bille remet le monde à ses dimensions de profondeur invisible, désespérante. Tu as cherché un peu?
– À quoi bon.
Il ouvre les bras, les laisse retomber. Comment espérer s’y retrouver quand le monde est si étendu, si confondant. Si glouton?
Il est parti à la patinoire. En rentrant, il aura oublié.
Lors du grand débroussaillage, on a trouvé des billes. Des billes en terre, des bouts de boîtes en fer, des petites voitures cassées. C’est fragile, une «bille-terre», comme il dit. C’est rapide, un passage d’enfant. Moins de quinze ans. Les billes qui avaient résisté à des années d’enfouissement au jardin, il les a achevées en jouant. Un jour, la terre aura le hoquet, elle rejettera une de ses «plus belles billes». Mais les jardins aussi s’effacent, les ronces recouvrent, l’espace entier a tôt fait de disparaître sous les herbes conquérantes, les entrelacs de branches. Si d’ici là une route ne détruit pas tout. Un jour, un autre enfant viendra. J’ai trouvé une bille, il dira. C’est du verre de couleur. Une bille d’autrefois.
*
La loi du bégonia
Sur le marché, trois frères pépiniéristes, les Dalton de la profession. Je regarde souvent ce qu’ils ont. Le plus jeune des trois se met à énumérer courageusement les coloris de ses petits lupins, plus gêné que s’il commentait un sommet de la poésie érotique. L’aîné vient s’en mêler, pour passer aux choses sérieuses, hélas. Après le produit qui fait les allées nettes, il passe à la pelouse.
– Je ne mettrai pas de pelouse, je dis. Seulement des fleurs.
– Des fleurs partout?
– Et un jardin d’herbes.
– Vous n’aurez que des mauvaises herbes. C’est grand?
– Un petit jardin. Moins de mille mètres carrés.
Il tire sur sa bouffarde, le Dalton en chef. Me regarde derrière ses paupières d’huître. Ventre rebondi sous la blouse, il approche de son étal, me dévisage et lance, d’une voix assez forte pour que chaque passant en prenne de la graine: Moins de mille mètres carrés! Il faut deux jeunes retraités sans rhumatismes pour en venir à bout! Pas une jeune femme qui peut! Pas de pelouse, que des fleurs, vous n’y arriverez pas, Madame. Ah, Madame! Pourquoi vous ne mettez pas de pelouse? Il n’y a pas plus propre, pas plus joli. Une belle pelouse bien entretenue, il n’y a que ça!
Bon, j’accepte la réévaluation de la surface à l’aune des mauvaises herbes. Mais ce qui me confond, ce que je ne comprends pas:
– Vous vendez des fleurs et recommandez de la pelouse?
– Bien sûr! Et au bord de la pelouse, vous allez planter des bégonias! Des pétunias! Nous en aurons d’ici trois semaines. Et aussi des surfinias qui tiennent encore mieux à la pluie.
– Je n’aime pas les bégonias.
– Vous y viendrez. Vous aimerez, s’il n’y a que ça. Et vous ne le regretterez pas. Vous y viendrez au bégonia, ah, ah!
Propos de dealer. Une fois que vous en aurez goûté… Cynisme mercantile, on compte sur le comportement moutonnier qui fait douter Hannah Arendt de la capacité du jardinier à innover. C’est dans Crise de la culture, je crois. Complètement dégoûtée, je vais lire le journal au café. Asseyez-vous, dis-je à ma voisine du bord de mer qui ne sait plus où mettre ses paquets et prendra un chocolat chaud.
– Alors, ce jardin?
Je lui raconte les Dalton ronds en blouse grise, le primat de la pelouse, la loi du bégonia, la guerre chimique qui ravage les allées et les sans-rhumatismes à plein temps lâchés par couple comme les dindons dans tout beau jardin de moins de mille mètres carrés.
– Les mauvaises herbes, dit-elle, il y en aura toujours. Mais en serrant les plants comme vous faites, on empêche l’installation tapissante des indésirables. On couvre le terrain de fleurs choisies au lieu de laisser la place aux orties. En mélangeant les types, les essences, on freine sacrément les maladies du ciel et du sol. Les plantes sont plus fortes ensemble pour lutter. Au jardin, la force est dans la diversité. Vous souriez. Avec une pelouse-produit-bégo, que devient l’échange de plantes? Sans le don de fleurs vous savez bien, sans ce premier geste jardinier, on n’a pas de beau jardin, vivant, dans la durée.»
Et puis le bégonia, franchement! Une annuelle hydropique tassée, qui ramène un jardin de pleine terre à la dimension d’une potée. D’ailleurs «Convient bien en potées» est le leitmotiv qui l’accompagne. Pour Valéry Larbaud, il y a des livres «que c’est pas la peine». Le bégonia est une fleur que c’est pas la peine. Un port relâché, le coloris lavasse. Pas d’odeur. Fragile puisque gorgée d’eau, donc ça casse. Une fleur qui met le pot en valeur. Elle aime l’ombre, d’accord, mais les anémones du Japon aussi.
Le pétunia, je ne dis pas. Plébiscité par les petites villes et les concours, lui au moins fleurit fort. Aussi pimpant que son nom, le petit gars doux à regarder. D’un parfum délicieux, vaguement mentholé, tentation citronnelle, une nostalgie d’île. À ras du sol dans mes plates-bandes, le pétunia est aussi ravissant que dans les hauteurs en cascade des balcons de la bibliothèque ou à la mairie. Car rien ne réussit mieux au pétunia que l’espace public. Certes, il devrait revoir sa palette. On peut déplorer la tendance des petites villes à forcer sur le rose écrasé et le parme saturé. Pas toujours heureux, le côté Andy Warhol revu et interprété par les pages Mon jardin du fanzine municipal. N’importe, tout vaut mieux que les bégos.
*
Une graine de courage
«Brouillard sur les Hauts des Galgals». Au chapitre VIII de La Communauté de l’Anneau, Frodon le Hobbit se trouve pris dans un piège. Une peur terrible, pas un geste. Le jeune héros pense à Bilbon, «à ses histoires et à leurs entretiens sur les routes et les aventures». Va-t-il s’en sortir? Je pense que oui, il nous reste plus de mille pages à lire. Mon jeune auditeur, dénué de mon cynisme de renard, mordille nerveusement le drap tout en cherchant à forcer du doigt l’intervalle des jours Venise. J’interviens pour la défense des jours.
– Allez, maman, Frodon est prisonnier, et toi …
Avançons. «Il y a une graine de courage cachée (souvent profondément, il est vrai) au cœur du plus gras et du plus timide des Hobbits, attendant que quelque danger final et désespéré le fasse germer.»
Bientôt, Frodon est sauvé.
Le lendemain matin
– Une graine de courage, maman, tu te rends compte si tu semais du courage dans le jardin!
– Je sèmerais de la bourrache officinale. Une bonne grosse plante pleine de feuilles poilues, dodues. Et tout en haut, une petite fleur bleue en forme d’étoile.
– C’est ça, du courage?
– Un proverbe anglais dit: A garden without borage is like a heart without courage. Un jardin sans bourrache est comme un cœur sans courage.
Quelques soirs plus tard
Un malheur est arrivé. Gandalf le magicien, l’allié des Hobbits, un père pour Frodon, un mentor et un ami nous a quittés. Dans la Moria, territoire creusé à même les soubassements de la montagne, gardé par d’horribles orques armés de cimeterres, archers habiles aux flèches empoisonnées, la compagnie perd espoir, on n’en sortira pas vivant. Soudain, une ombre, un nuage animé de malveillance, une force ruisselante de feu, plus redoutable que tout ce que nos amis ont eu à affronter jusqu’à présent, menace Gandalf. Ce puissant enchanteur lui barre la route, l’empêchant de fondre sur la compagnie pour l’anéantir. Dans un combat aussi bref qu’inégal, ce Balrog d’épouvante, cette fumée dardant deux points rouges incandescents s’enroule sur Gandalf et l’entraîne dans le vide et le sombre néant. C’en est fini de l’immense protecteur, la pure ténèbre est retombée. La Compagnie reste figée d’horreur. Mon jeune auditeur éclate en sanglots. Ah non, j’arrête si tu pleures!
Alors au milieu des larmes, une plus vive protestation:
– Je sais bien que dans les grands livres on meurt! Les héros meurent pour leur pays, je sais! Pour la liberté! N’empêche qu’ils meurent! Je suis sûr que Frodon va mourir et Sam, oh, mais Frodon, non! Déjà qu’ils ont dû abandonner Bill le poney! Et comment ils vont se débrouiller sans Gandalf si…
– Pense à la graine de courage dans le cœur du plus gras des Hobbits. Ils se sont donné une mission, ils vont l’accomplir. Sois courageux ou je ne pourrai pas continuer. Des choses terribles les attendent. Regarde le nombre de pages. Imagine. Des guerres, des chagrins. Tu ne supportes pas la mort de Gandalf, l’abandon du poney? Alors tu es trop jeune pour cette histoire. Je ne lis pas pour te rendre malheureux. Allons, courage! Regarde: «Aragorn arracha les autres à leur stupeur en criant:
– Venez!»
L’après-midi
Dans la vacance d’esprit à laquelle dispose l’exercice du jardinage, je reviens à cette ombre qui emporte Gandalf. Le mot mort n’a pas été prononcé, ce qui sans trop l’abuser, a laissé une lueur d’espoir au jeune auditeur. Cette fumée, cette terreur comme il est dit plus loin, me fait souvenir du MrPanado des Fruits du Congo d’Alexandre Vialatte. Je crois même que le narrateur devenu grand y reconnaît la paranoïa. C’est quelque chose qui rampe et suit la bande de garçons. Ça se passe dans une province éloignée, une ambiance campagnarde, une ville aux publicités peintes sur les murs. Je pense à l’ami Michka, enfant, se baignant dans le canal de l’Ourcq à Aulnay-sous-bois. Et cette balade en tandem avec Emmanuel un jour d’été des années 80. L’été, Emmanuel était l’été. Quel numéro appeler pour lui demander, Tu as fait quoi, du tandem? As-tu lu Les fruits du Congo que j’étais passée prendre à la Hune la veille de la balade avec toi, en sortant du cinéma?
Les années passent comme un cartouche apparaît sur l’écran d’un film muet. Une éternité. Des lointains. L’actuel auditeur du Seigneur des anneaux est un jeune bébé silencieux au creux d’un fauteuil dans le salon de repos, près de l’écurie où Emmanuel vient d’étriller le cheval après la promenade sur l’île St Germain. Vita, grande sœur du jeune bébé regrette qu’aujourd’hui son cheval se soit montré nerveux. Les deux cavaliers parlent ensemble à l’animal inquiet. Leurs mains à plat sur le col isabelle.
Était-ce cette fois-là. Le cheval d’Emmanuel lâché sur le pré lance des ruades de plaisir, des hennissements, des pets de liberté. Était-ce cette fois où, «devant le pont étroit et la venue de la terreur», J’ai arrêté les médicaments, dit Emmanuel. Je ne fais plus rien, je me soigne au gingembre confit que ta fille m’apporte, je ne serai pas un insupportable squelette pour mes amis, je ne fais plus que vivre, on verra.
Il y a des années où tous les amis sont présents. Il y a des années où c’est différent. La maladie a piégé les corps. Cependant tout ce qui concerne les étés où Emmanuel est vivant demeure présent. Brillant. Malgré le bruit des pas sur le gravillon du Père-Lachaise. En dépit du fait que le Père-Lachaise a cessé d’être seulement un jardin de marronniers et d’art funéraire pour devenir tout à coup un cimetière. Une voix de jeu
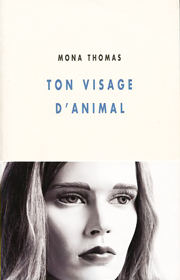
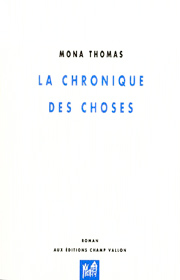


MONA THOMAS Comment faire une danseuse avec un coquelicot
» De mars à juillet, sous la couette et dans l’herbe, je lis Le Seigneur des Anneaux à mon fils qui a dix ans. Très vite il y a le plaisir de la répétition, un suspense. Ensemble on acquiert le goût de ce livre plein d’herbes et de fleurs. On le retrouve, on le cultive. Comme un ami. Par le biais de la lecture à mon jeune auditeur, le jardin révèle sa nature romanesque. Faire un jardin, c’est intervenir sur le monde à ma portée. Inventer une histoire. Transformer une fleur sauvage en petit personnage. Retourner un coquelicot en demoiselle. »
Lire un extrait
Comment faire une danseuse avec un coquelicot
Les premières pages
Mars
Quand ma grand-mère décidait de s’occuper de ses fleurs, elle laissait ce mot à la porte au cas où une amie passerait. Un neveu, une de ses sœurs, un vieux copain:
Je suis
au jardin.
Sur un bristol usagé.
Ma grand-mère m’a donné un jardin. Je ne lis pas encore, je ne vais pas à l’école comme les autres. Mon grand-père lit le soir les contes d’Andersen. La journée, je peux rester des heures devant les images du livre. Ma grand-mère est au jardin. La petite sirène a un jardin. Elle ne va pas à l’école non plus. Je veux un jardin. Je demande un jardin. Accordé. Un petit carré.
Ma grand-mère regarde beaucoup son jardin. Regarder fait partie du jardinage. Mon grand-père se promène dans les allées en griffonnant sur des bristols usagés qu’il sort de ses poches. Je croyais qu’il écrivait des mots, des phrases, les histoires sans doute qu’il racontait le soir et dans les moments libres ou en voiture. Or, ces histoires qu’il semblait avoir vécues, j’ai découvert très tard qu’il les avait lues chez Conrad, Melville, Stevenson. Des histoires qu’il aimait trop pour en rester là, pour ne pas les raconter encore. Tout commençait entre Binic et les Sept îles, avec une percée vertigineuse dans les territoires de Guingamp ou de Crozon. San Francisco c’était l’Arcouest, le fleuve Congo s’étirait comme chez lui dans le lit du Trieux. Le canal de Suez, de Panama et de Nantes à Brest ne faisaient qu’un.
Les griffonnages du jardin, c’étaient des chiffres. Ma grand-mère ne griffonnait pas. Mais après la mort de grand-père, elle s’y est mise à son tour. Pour moi, ils ont la même écriture. Comme il existe un timbre de voix d’époque. Par exemple, quand on entend un enregistrement de Sartre, de Yourcenar ou de Queneau à la radio, on entend la voix de ceux qui sont nés au début du vingtième siècle. Si bien que, sur le mot à la porte, je vois d’abord le tracé d’une écriture d’époque et presque en même temps le mot jardin.
Ce qui me les rend présents tous les deux en même temps. Elle qui regarde les fleurs, lui qui se promène en griffonnant.
Surtout, ils sont là.
Depuis peu je lis le soir, au petit garçon qui devient grand, l’œuvre féerique en trois tomes que John Ronald Reuel Tolkien, citoyen britannique né en 1892, a composée au cours des années cinquante. Il a bien fallu répondre à la question «Quoi lire après La coupe de feu?» Bien sûr, il y a une vie après Harry Potter. Et même avant. Nous avons lu Moonfleet, L’île au trésor. Nous partirons pour Le merveilleux voyage de Nils Olgerson à travers la Suède. Le libraire passe commande. Et en attendant? Je ne connais pas Le Seigneur des Anneaux. Aïe, mille trois cent pages! Allons-y.
Une initiative louable où je vais perdre cinq mois de ma vie. De lecture du soir. Au troisième jour d’entame d’un ouvrage encore plus compact qu’il n’y paraît, après un quart d’heure de lecture de bonne volonté, je me tourne vers mon jeune Jacob avec la ferme intention de lui dire, On arrête. Mais lui, rose de bonheur, déjà à fond avec Gandalf, Bilbon et autres fripons: C’est bien, hein, maman! Allez, tu lis?
Le moment est venu de lui révéler combien j’en ai sauté, des passages concernant l’histoire des Hobbits, Petites Personnes aux grands pieds poilus, au caractère heureux et à la longévité biblique. Le moment de lui révéler que j’ai à peine survolé le chapitre des documents d’archives de la Comté, le pays de ces Hobbits ou Semi-hommes que je vois assez bien, sans tarder, drapés de l’étoffe des héros à plein temps. Le moment de lui révéler, enfin, que les chansons de Bilbon en vers de mirliton, je ne les chante pas toutes, parce que…
– Allez, maman, tu lis?
L’amour est un grand lecteur. Qui vous embarque vers des mondes dont vous ignoriez tout jusque là, vers des connaissances dont vous auriez parfaitement pu continuer à vous passer. L’amour vous ôte jusqu’à la possibilité de vous plaindre: vous lisez avec ses yeux désormais. Vous vous sentez comme Frodon qui a accepté de se rendre à l’autre bout de la Montagne du Destin sans savoir ce qui l’attend. Et encore, s’il y parvient. Et vous avec, n’est-ce pas, puisque vous êtes du voyage.
*
La cabane
Quand il fait la visite, Jacob commence par «le jardin du rhodo». Rhododendron, un sauvage on ne peut mieux acclimaté, hauteur maximale, confortable embonpoint entre un budléïa bleu et un immense camélia rouge, avec à ses pieds quinze jours par an, le muguet. C’est mon jardin, déclare-t-il. Et négligeant de préciser que Vita, sa grande sœur, le surnomme «mon Rodo», il prend sa part de l’admiration qui va au volumineux arbuste couvert de grappes violettes. Le visiteur conçoit sans peine qu’à bientôt onze ans, ce garçon souriant, disert, soigne les fleurs et compose des bouquets pour les amis. D’ailleurs, sécateur bien en main, il demande, C’est quoi vos fleurs préférées?
Il a peut-être même conçu et dessiné ce coin frais en été, premier à fleurir dans l’hiver. Il explique bien qu’après la floraison du rhodo, il est recommandé d’enlever les centres fanés pour fortifier l’arbre, multiplier les fleurs.
– Mais nous on ne le fait pas, ça fleurit tellement déjà.
Vient ensuite le jardin de papa, le jardin bleu. Papa ne fait pas le jardin, mais il voulait du bleu sous ses fenêtres, alors vas-y que je te centaurée blue boy et lupins gentilhomme! Héliotrope sous les hostas, violettes avec anémones avant les verveines et les iris, le tout se poussant du col au fil des saisons pour ne pas disparaître sous les coussins de myosotis qui se ressèment davantage chaque année. Du bleu, il en veut, il en a. À la demande. Et des fuchsias sky rocket, que j’ai défendus jusqu’à l’idée fixe contre les limaces.
Le reste, très vite, on passe. Ah, enfin, Nous voici à la cabane, dit Jacob avec un grand sourire. J’ai les clés? Vous pouvez sonner la cloche si vous voulez. Au-dessus de votre tête, vous voyez?
Le visiteur fait sonner la cloche. La porte s’ouvre.
C’est un deux-pièces-électricité-chauffage (il suffirait de remettre le poêle en route), aménagé par le premier habitant d’ici, un prof de maths bricoleur raisonnable pendant ses années d’enseignement, collectionneur fou de n’importe quoi après la retraite. Cargaisons de bouchons, collections de flacons et de boîtes vides, fonds de peinture, d’huile de voiture, de produits de jardin et de pharmacie. Également des outils lourds de rouille, des tiroirs de pépites sans nom, d’étonnants fétiches et autres curieux trésors récupérés en vue de grands projets à jamais suspendus dans les limbes.
La première pièce accueille le matériel horticole. Du léger. Le carillon Westminster de mon grand-père a trouvé sa place ultime sur un escabeau trop amoché pour bouger du mur. Le mécanisme d’horloge est cassé. Pas la musique. Le premier geste en entrant dans la cabane: tirer sur la petite ficelle attachée au carillon: «Dingdong-dingdong. Dongdong-dongdong. Dong!»
Derrière la seconde porte -qui «doit» rester fermée à clé, se trouve la pièce intérieure, le cœur de la cabane, le sanctuaire. J’ai été invitée à venir voir ce cabinet autrefois réservé au professeur, royaume actuel de mon écolier, une fois que tout a été arrangé.
Les reliquats d’activités du premier habitant voisinent avec les chantiers plus récents. Bazar d’outils par terre, mécano et clous répandus partout, craies écrasées dans les bouts de ficelle, festival de copeaux de bois, chutes de carton. David, heureux père, a souvent du mal à garder son calme. Et rien ne peut l’irriter autant que la question des clés de la cabane. Tu les as rangées, tu sais où elles sont?
À l’origine déjà, les clés étaient perdues. Premier été, on fait connaissance avec les lieux. Mon frère et sa famille viennent nous voir. Impossible d’entrer dans la cabane.
– Je vous les trouve, ces clés, a dit mon frère. Il est où, le grenier?
– C’est un faux grenier, on ne peut pas y aller, il n’y a pas de plancher.
Mon frère a souri. Enfant, il avait obtenu d’habiter le grenier de la maison où nous sommes nés, un peu comme j’avais obtenu un jardin. Il avait ses quartiers dans le pigeonnier où l’on accédait par une échelle de meunier, là même où ma grand-mère cachait du monde pendant la guerre 39-45 et aussi des faux papiers, un deuxième poste radio, l’ensemble devant se ramasser en cas d’alerte dans les double-fonds qu’elle avait aménagés avec un système de portes coulissantes et beaucoup de gingin. À l’habitant de ce repère-là je disais: Le grenier, on ne peut pas y aller.
Mon frère a poussé la porte, a regardé le vasistas, s’est avancé en équilibre sur les poutres tandis qu’à l’entrée, on lui lançait des mises en garde inutiles ou dangereuses.
Indifférent, après quelques avancées prudentes mais franches, mon frère s’est arrêté, a fixé un point dans le vide du faux plancher, s’est accroupi, a tendu la main et:
– C’est bon, je les ai.
Revenu vers nous, vers les «Bravo bravo, vraiment t’es fort», mon frère a déclaré: C’est pas le tout! Puis il s’est lancé dans l’escalier comme s’il y avait le feu. On dévale derrière lui, les cousins se bousculent. Devant la porte de la cabane, mon frère agite les clés.
– Vous êtes prêt?
Et quand enfin il a ouvert sur le capharnaüm, après qu’il ait posé le premier un pied dans le sanctuaire, on n’a plus entendu que des «Oh», des «Ah», des «Regarde, papa!» «T’as vu, là! Oh et ça!»
Les filles sont restées dehors.
Découverte et bricolage. Fil nylon, mouches, vis et bouts de crayons ont été triés. Au mur, la première boîte à outils de Jacob s’ouvre en triptyque. Sur l’établi nettoyé mais pas trop, il a posé son microscope. D’étranges objets de pêche et de pyrogravure sont demeurés suspendus ça et là. J’ai emporté le plan des arbres fruitiers établi par le créateur du jardin en 1960. Un agrandisseur photo trône à tribord. Il ne sert plus, mais on ne peut pas le jeter – c’est le piège.
Les filles ne se battent pas pour entrer dans le saint des saints. Elles apprécient plutôt «la maisonnette» du dehors, et la vigueur du lierre Marengo qui, guidé en manchon, cache artistiquement la gouttière au-dessus de la réserve d’eau. Les messieurs, eux, tous âges confondus, tombent sous le charme de la cabane au fond du jardin. En sortant on se souvient de choses qu’on n’a pas vécues et qui font parler. On aimerait y retourner seul, pour s’asseoir devant l’établi, toucher les outils, être celui qui ferme à clé à l’envers à cause de la serrure récupérée.
Bien des expériences ont lieu là. Les allumettes sont interdites, mais la boîte de chimie reste à portée de la main. On y forge des armes pour la guerre contre Saroumane, on y distille de puissants poisons auxquels on donne des noms de fleurs à terminaison latine façon Astérix. On y rédige des indices de chasse au trésor comme les déductions d’enquêtes de «Cherlok Homme.» Des camions en chutes de contre-plaqué -Vrrm, Vroum– en sortent avec inscrit à la craie: «Transport pour les gens». On y invite un copain quelquefois, on aime à y «réfléchir». Un soir de long printemps, à force de réfléchir sous la lumière ronde du projo solitaire, Jacob s’est endormi, la tête sur l’établi.
– C’était trop bien d’être là comme au fond des bois avec toutes les énigmes.
*
L’amitié
Dans le prologue de son livre, Tolkien nous apprend que les Hobbits aiment «la tranquillité et une terre bien cultivée». Ils ne pratiquent pas la magie, ils ont «une amitié intime avec la terre».
– Tu vois, dit mon jeune auditeur tandis que je parcours le journal au premier soleil frisquet, Harry Potter il «apprend» la magie, il «fait» de la magie. Mais dans Le Seigneur, ils «sont» magie. Donc. «Donc,» ils n’ont pas besoin d’apprendre.
– Hmm.
– Ils n’ont pas «besoin», tu comprends?
– Hmm!
– Ils «sont»!
Sur quoi mon fin comparatiste va jouer aux pirates (un pluriel, toujours plusieurs pirates): Chw! Ha! À l’abordage! Mais bientôt il lâche la brouette-gallion espagnol pour revenir à la table. Songeur.
– C’est la magie, c’est comme l’amitié.
– Ah bon?
– Comme je t’ai dit, Harry Potter, il apprend la magie. Que dans Le Seigneur ils «sont» magie.
– Ah bon?
– T’as pas compris?
– Redis voir…
– L’amitié, on n’a rien «besoin» de «faire», on est de l’amitié ensemble. Tu comprends, là?
– J’essaie.
– Dans Le Seigneur, ils «sont». Tu les verrais pas apprendre des tours comme moi ou Harry Potter! Ils «sont une amitié» avec le monde entier, ils sont magie. Avec les copains, on joue, on «fait» des jeux, il faut toujours «faire» quelque chose avec un copain. Avec un ami, on n’est pas obligé de jouer. On «est» juste avec son ami. L’amitié quoi, la magie qu’il y a pas besoin d’apprendre, tu comprends?
Il paraît essoufflé.
– Oui, je comprends. Bien sûr, je comprends.
*
Figure de la jonquille
Les premiers dimanches de sa vie, aux beaux jours, quand il allait avec son père dans la forêt de Senlis, jouer aux Indiens, construire des cabanes, il me ramenait des jonquilles sans tige, à la mesure des petites mains. Tiges de plus en plus longues bientôt. Je plaçais les bouquets dans les vases et les vases sur le buffet face au canapé. On s’installait pour admirer les jonquilles, il me racontait la forêt.
Il regardait de travers le bouquet de jonquilles des bois quand j’en achetais un dans la rue. La jonquille rejoint la première joie, la première fois qu’on offre des fleurs à une fille.
Ensuite nous sommes allés vivre sur la côte avec rochers dans le jardin et jonquilles plus précoces que celles des avenues à Paris. Plus grosses qu’en forêt de Senlis. Puis nous avons quitté la côte pour la petite ville où les premiers gestes du jardin ont été pour les jonquilles sauvages découvertes sous les ronces et les branches cassées.
J’en ai pris soin, je les ai mêlées à des bulbes sophistiqués de plusieurs intensités de jaune, excepté au jardin blanc où les narcisses comme du papier parfument autant que du jasmin ou des tubéreuses.
Jacob, trop content d’être invité chez Évariste la première fois, fonce dans le jardin. J’ai suggéré d’apporter un bouquet à la maman. Le temps de trouver le sécateur, la douzaine de premières jonquilles a fait place nette. Il n’y avait que ça, des jonquilles, pour le coup d’œil par la fenêtre de la cuisine. David, comme les Hobbits, déteste ce qu’il appelle «la terre noire» et demande chaque matin quand ce sera «fleuri». Jacob, ravi, tient au poing une assemblée de museaux jaunes, perplexes.
– T’as vu comme il est beau mon bouquet?
Sourire crispé. Calme.
– Tu peux ajouter un peu de verdure.
Il se précipite de nouveau sur les jonquilles.
– Non! Pas de jonquilles, plus de jonquilles. Là, ce sont des boutons. Non, ils ne s’ouvriront pas. On va plutôt prendre quelques camélias.
– J’adore les jonquilles, il dit. Y’a aucune fleur «plus beau» qu’une jonquille.
En réalité il ne voit que la jonquille, se désintéresse complètement de la production du jardin après les jonquilles. Pour lui il y a «la» jonquille et les fleurs. Cette année encore il a de longs Oh d’attendrissement. Jean-Luc au téléphone lui demande, Alors ce jardin, dis-moi? Y’a des jonquilles, il dit. Il les décrit, en donne le nombre exact d’épanouies, redit comme elles sont belles et quand à l’autre bout du fil: Tu es sûr que ce ne sont pas plutôt des narcisses? La jonquille est un narcisse, répond-t-il sans hésiter. De la même famille, tu sais?
Gare de Lyon ce soir, j’attends Jean-Luc. Comme à Montparnasse, à Austerlitz ou Saint Lazare, beaucoup de fleurs descendent avec les bagages en mars. En avril, les lilas, mais en mars, c’est la jonquille qu’on voit danser le long des sacs plastique. En mai, moins de fleurs, alors qu’il en vient bien plus au jardin. En juin, plus rien.
Un couple avance comme un seul homme au pas de charge. Monsieur tient au bout du bras un sac Darty rempli de jonquilles de jardin. Voilà Jean-Luc.
Le pas de charge nous dépasse pour s’arrêter net au milieu de la galerie vers la sortie. Les bagages sont lourds.
– Je peux porter les fleurs, propose Madame.
– Sûrement pas, répond Monsieur. J’ai pas confiance.
– Ce que tu es gamin, dit Madame.
On sonne à la porte. Un garçon d’à peine dix ans. Billets de tombola ou ballon envoyé dans le jardin? Bonjour monsieur, est-ce que je pourrais cueillir des jonquilles, s’il vous plaît? C’est pour ma grand-mère. J’habite le HLM derrière. Attends là, dit David. J’attrape le sécateur. Le soir il nous raconte la visite.
– Tu as bien fait papa, il vaut mieux prendre le sécateur, dit Jacob. Pas facile à cueillir, une jonquille. Ah! C’est pas toujours facile, la jonquille!
L’air coquin qu’il a eu.
Mercredi
Ils vont d’une cabane à l’autre en claquant le portillon. Je bondis à la fenêtre. Évidemment, il n’y a personne. On entend les rires, ils disparaissent vite dans la rue, Xavier habite trois maisons plus loin. Le mercredi, il faudrait travailler dans un bunker étanche pour ne pas être dérangée avant l’heure du goûter. En plus, aujourd’hui, il y a la cabane de Xavier, nouvellement aménagée, à visiter. Les tantes ont fourni du mobilier, un coffre bourré de trésors. Il faut que tu voies, Il faut que vous voyiez.
– Et ça?
Devant la cabane de Xavier arrangée en Q.G. de campagne du club des Cinq, un morceau de bordure de grillage entoure quelques jonquilles écrasées.
– On les protège contre les grands prédateurs.
– Il y a des prédateurs à part vous?
– Oh, maman, on les avait pas vues et…
Alors Xavier, yeux écarquillés, l’air plus déterminé que quand ils jouent à C’est-nous-qui-mène-l’enquête, avance d’un pas.
– Elles ont poussé là sans qu’on sache. Maintenant on sait, alors on les défend! Ma théorie -aux choses sérieuses il faut toujours une théorie-: la jonquille est la tendresse du jardin. La primevère, plus précoce, fait figure d’éclaireuse. On la regarde sans l’emporter, on l’offre en pied, pas en fleur. La jonquille est plus civilisée.
Le soir
– Hein maman, hein?
Jacob me parle tout en faisant un dessin pour Kasaïné, son copain d’Afrique. J’ai entendu passer des lions, des roses. Des tortues menacées de disparition, entendu parler de jonquilles et de jonquilles, qu’est-ce?
– C’est comme tu disais, maman que Vita, c’est la figure de la jonquille.
– Quoi?
– Donc j’ai écrit: Salut Kasaïné, je t’écris de ici où y’a plein de jonquilles dans le jardin et ma sœur vient nous voir samedi et, hein je peux mettre, euh, c’est la figure de la jonquille.
– Je disais ça, tu es sûr? Attends, il va rien comprendre, Kasaïné. Ce n’est pas plutôt la figure de la jeune fille? Attends, on s’emmêle, là.
– Mais c’est quand même bien si on dit «figure de la jonquille»?
Les garçons adorent les jonquilles. La seule théorie qui vaille: Pour les garçons, la jonquille c’est la jeune fille.
*
La vie de l’arbre
Un dimanche, le printemps s’annonce sans prévenir. La texture de l’air est plus fine, on remarque les renflements au bout des tiges, il y a des chatons sur le bois des arbres. De jeunes feuilles fripées. L’après-midi se prête à la taille des arbres qui ont besoin d’air, de lumière. J’ai demandé à David de bien vouloir couper les vieilles branches mortes. Et de rectifier les avancées aberrantes de certaines autres. Je marquerai les emplacements au crayon forestier.
Mon scieur du dimanche arrive à l’aucuba japonais. Les entrelacs d’horizontales exigent un dégagement central, de belles branches étouffent. Il faut aussi en supprimer de vigoureuses, les feuilles entièrement vertes contrarient la panachure jaune de l’ensemble. Si on n’y veille, elle aura bientôt disparu, colonisée par le vert uni d’origine qui essaye sans cesse de revenir.
Le bruit de la scie s’est arrêté. Que fait le travailleur, accoudé à l’avant-bras d’une branche maîtresse complaisamment avancée à sa hauteur? La scie est posée contre le tronc et au lieu du bruit de l’outil en action, j’entends que l’on murmure: Ça sent bon on on on…
Les pieds dans le lierre saupoudré de sciure fraîche, la tête au creux du coude, mon fiancé est tombé en pâmoison dans la vie de l’arbre. Il demeure comme enivré, souriant.
*
Le train regarde les jardins
C’est d’abord une ligne droite, une courte horizontale. Puis une sombre petite surface, un quadrilatère découpé au milieu du vert. Un jardin. L’envie de modifier l’état du monde, de le voir s’épanouir. Il y suffit d’un peu de travail. Le plaisir qu’on y prend éloigne les chagrins et rend content. Longtemps.
Orléans-les-Aubrais: une langue de terre au milieu des champs un peu jaunes. Le vert vient, sans s’être encore imposé, il est jeune. Un grand diable laissé là, les bras levés, achève de donner au lopin fraîchement retourné une aura moyenâgeuse.
Entre Cher et chemin de fer, jardins familiaux en bord de rivière. Petites parcelles, grandes largeurs. Les barrières sont ouvertes, un joli débraillé règne, une effervescence sans rien qui urge. Il y a deux semaines, voile de l’immobilité, tout dormait. Près de la terre préparée, on distingue un seau, une tête de binette, un bac en plastique. Des hommes parlent devant les carrés, deux par deux, droit plantés, copains de jardin prêts à échanger conseils et boutures. Cascades rose froid des groseilliers en fleurs. Un sachet de graines bouchonné sur le tuteur signale le semis. Une couleur suffit à dire l’activité humaine, l’été qu’on anticipe, le projet, l’indécrottable besoin que quelque chose arrive. D’ailleurs un petit garçon court vers les hommes du jardin, une feuille de papier à la main.
*
Perdue dans la terre
– Tu pleures? Qu’est ce…
Il a perdu une de ses «plus belles billes» dans le jardin. Où? Dans quel coin?
Il lève les bras en soufflant, la figure rouge barbouillée de larmes comme dans Poil de carotte. Mon nounours, se mettre dans des états pareils, ça s’est passé où? Parterre, allée?
– Une bille ça roule, tu t’rends pas compte!
– Oui, mais où? Elle a roulé dans quelle direction?
– Dans la terre.
Je soupire. Il dit: Tu vois!
C’est comme découvrir un infini du jardin. Sa véritable nature. Son double fond. C’est comme disparaître dans l’eau, dans la nuit. On croyait se mouvoir en surface et voilà qu’une bille remet le monde à ses dimensions de profondeur invisible, désespérante. Tu as cherché un peu?
– À quoi bon.
Il ouvre les bras, les laisse retomber. Comment espérer s’y retrouver quand le monde est si étendu, si confondant. Si glouton?
Il est parti à la patinoire. En rentrant, il aura oublié.
Lors du grand débroussaillage, on a trouvé des billes. Des billes en terre, des bouts de boîtes en fer, des petites voitures cassées. C’est fragile, une «bille-terre», comme il dit. C’est rapide, un passage d’enfant. Moins de quinze ans. Les billes qui avaient résisté à des années d’enfouissement au jardin, il les a achevées en jouant. Un jour, la terre aura le hoquet, elle rejettera une de ses «plus belles billes». Mais les jardins aussi s’effacent, les ronces recouvrent, l’espace entier a tôt fait de disparaître sous les herbes conquérantes, les entrelacs de branches. Si d’ici là une route ne détruit pas tout. Un jour, un autre enfant viendra. J’ai trouvé une bille, il dira. C’est du verre de couleur. Une bille d’autrefois.
*
La loi du bégonia
Sur le marché, trois frères pépiniéristes, les Dalton de la profession. Je regarde souvent ce qu’ils ont. Le plus jeune des trois se met à énumérer courageusement les coloris de ses petits lupins, plus gêné que s’il commentait un sommet de la poésie érotique. L’aîné vient s’en mêler, pour passer aux choses sérieuses, hélas. Après le produit qui fait les allées nettes, il passe à la pelouse.
– Je ne mettrai pas de pelouse, je dis. Seulement des fleurs.
– Des fleurs partout?
– Et un jardin d’herbes.
– Vous n’aurez que des mauvaises herbes. C’est grand?
– Un petit jardin. Moins de mille mètres carrés.
Il tire sur sa bouffarde, le Dalton en chef. Me regarde derrière ses paupières d’huître. Ventre rebondi sous la blouse, il approche de son étal, me dévisage et lance, d’une voix assez forte pour que chaque passant en prenne de la graine: Moins de mille mètres carrés! Il faut deux jeunes retraités sans rhumatismes pour en venir à bout! Pas une jeune femme qui peut! Pas de pelouse, que des fleurs, vous n’y arriverez pas, Madame. Ah, Madame! Pourquoi vous ne mettez pas de pelouse? Il n’y a pas plus propre, pas plus joli. Une belle pelouse bien entretenue, il n’y a que ça!
Bon, j’accepte la réévaluation de la surface à l’aune des mauvaises herbes. Mais ce qui me confond, ce que je ne comprends pas:
– Vous vendez des fleurs et recommandez de la pelouse?
– Bien sûr! Et au bord de la pelouse, vous allez planter des bégonias! Des pétunias! Nous en aurons d’ici trois semaines. Et aussi des surfinias qui tiennent encore mieux à la pluie.
– Je n’aime pas les bégonias.
– Vous y viendrez. Vous aimerez, s’il n’y a que ça. Et vous ne le regretterez pas. Vous y viendrez au bégonia, ah, ah!
Propos de dealer. Une fois que vous en aurez goûté… Cynisme mercantile, on compte sur le comportement moutonnier qui fait douter Hannah Arendt de la capacité du jardinier à innover. C’est dans Crise de la culture, je crois. Complètement dégoûtée, je vais lire le journal au café. Asseyez-vous, dis-je à ma voisine du bord de mer qui ne sait plus où mettre ses paquets et prendra un chocolat chaud.
– Alors, ce jardin?
Je lui raconte les Dalton ronds en blouse grise, le primat de la pelouse, la loi du bégonia, la guerre chimique qui ravage les allées et les sans-rhumatismes à plein temps lâchés par couple comme les dindons dans tout beau jardin de moins de mille mètres carrés.
– Les mauvaises herbes, dit-elle, il y en aura toujours. Mais en serrant les plants comme vous faites, on empêche l’installation tapissante des indésirables. On couvre le terrain de fleurs choisies au lieu de laisser la place aux orties. En mélangeant les types, les essences, on freine sacrément les maladies du ciel et du sol. Les plantes sont plus fortes ensemble pour lutter. Au jardin, la force est dans la diversité. Vous souriez. Avec une pelouse-produit-bégo, que devient l’échange de plantes? Sans le don de fleurs vous savez bien, sans ce premier geste jardinier, on n’a pas de beau jardin, vivant, dans la durée.»
Et puis le bégonia, franchement! Une annuelle hydropique tassée, qui ramène un jardin de pleine terre à la dimension d’une potée. D’ailleurs «Convient bien en potées» est le leitmotiv qui l’accompagne. Pour Valéry Larbaud, il y a des livres «que c’est pas la peine». Le bégonia est une fleur que c’est pas la peine. Un port relâché, le coloris lavasse. Pas d’odeur. Fragile puisque gorgée d’eau, donc ça casse. Une fleur qui met le pot en valeur. Elle aime l’ombre, d’accord, mais les anémones du Japon aussi.
Le pétunia, je ne dis pas. Plébiscité par les petites villes et les concours, lui au moins fleurit fort. Aussi pimpant que son nom, le petit gars doux à regarder. D’un parfum délicieux, vaguement mentholé, tentation citronnelle, une nostalgie d’île. À ras du sol dans mes plates-bandes, le pétunia est aussi ravissant que dans les hauteurs en cascade des balcons de la bibliothèque ou à la mairie. Car rien ne réussit mieux au pétunia que l’espace public. Certes, il devrait revoir sa palette. On peut déplorer la tendance des petites villes à forcer sur le rose écrasé et le parme saturé. Pas toujours heureux, le côté Andy Warhol revu et interprété par les pages Mon jardin du fanzine municipal. N’importe, tout vaut mieux que les bégos.
*
Une graine de courage
«Brouillard sur les Hauts des Galgals». Au chapitre VIII de La Communauté de l’Anneau, Frodon le Hobbit se trouve pris dans un piège. Une peur terrible, pas un geste. Le jeune héros pense à Bilbon, «à ses histoires et à leurs entretiens sur les routes et les aventures». Va-t-il s’en sortir? Je pense que oui, il nous reste plus de mille pages à lire. Mon jeune auditeur, dénué de mon cynisme de renard, mordille nerveusement le drap tout en cherchant à forcer du doigt l’intervalle des jours Venise. J’interviens pour la défense des jours.
– Allez, maman, Frodon est prisonnier, et toi …
Avançons. «Il y a une graine de courage cachée (souvent profondément, il est vrai) au cœur du plus gras et du plus timide des Hobbits, attendant que quelque danger final et désespéré le fasse germer.»
Bientôt, Frodon est sauvé.
Le lendemain matin
– Une graine de courage, maman, tu te rends compte si tu semais du courage dans le jardin!
– Je sèmerais de la bourrache officinale. Une bonne grosse plante pleine de feuilles poilues, dodues. Et tout en haut, une petite fleur bleue en forme d’étoile.
– C’est ça, du courage?
– Un proverbe anglais dit: A garden without borage is like a heart without courage. Un jardin sans bourrache est comme un cœur sans courage.
Quelques soirs plus tard
Un malheur est arrivé. Gandalf le magicien, l’allié des Hobbits, un père pour Frodon, un mentor et un ami nous a quittés. Dans la Moria, territoire creusé à même les soubassements de la montagne, gardé par d’horribles orques armés de cimeterres, archers habiles aux flèches empoisonnées, la compagnie perd espoir, on n’en sortira pas vivant. Soudain, une ombre, un nuage animé de malveillance, une force ruisselante de feu, plus redoutable que tout ce que nos amis ont eu à affronter jusqu’à présent, menace Gandalf. Ce puissant enchanteur lui barre la route, l’empêchant de fondre sur la compagnie pour l’anéantir. Dans un combat aussi bref qu’inégal, ce Balrog d’épouvante, cette fumée dardant deux points rouges incandescents s’enroule sur Gandalf et l’entraîne dans le vide et le sombre néant. C’en est fini de l’immense protecteur, la pure ténèbre est retombée. La Compagnie reste figée d’horreur. Mon jeune auditeur éclate en sanglots. Ah non, j’arrête si tu pleures!
Alors au milieu des larmes, une plus vive protestation:
– Je sais bien que dans les grands livres on meurt! Les héros meurent pour leur pays, je sais! Pour la liberté! N’empêche qu’ils meurent! Je suis sûr que Frodon va mourir et Sam, oh, mais Frodon, non! Déjà qu’ils ont dû abandonner Bill le poney! Et comment ils vont se débrouiller sans Gandalf si…
– Pense à la graine de courage dans le cœur du plus gras des Hobbits. Ils se sont donné une mission, ils vont l’accomplir. Sois courageux ou je ne pourrai pas continuer. Des choses terribles les attendent. Regarde le nombre de pages. Imagine. Des guerres, des chagrins. Tu ne supportes pas la mort de Gandalf, l’abandon du poney? Alors tu es trop jeune pour cette histoire. Je ne lis pas pour te rendre malheureux. Allons, courage! Regarde: «Aragorn arracha les autres à leur stupeur en criant:
– Venez!»
L’après-midi
Dans la vacance d’esprit à laquelle dispose l’exercice du jardinage, je reviens à cette ombre qui emporte Gandalf. Le mot mort n’a pas été prononcé, ce qui sans trop l’abuser, a laissé une lueur d’espoir au jeune auditeur. Cette fumée, cette terreur comme il est dit plus loin, me fait souvenir du MrPanado des Fruits du Congo d’Alexandre Vialatte. Je crois même que le narrateur devenu grand y reconnaît la paranoïa. C’est quelque chose qui rampe et suit la bande de garçons. Ça se passe dans une province éloignée, une ambiance campagnarde, une ville aux publicités peintes sur les murs. Je pense à l’ami Michka, enfant, se baignant dans le canal de l’Ourcq à Aulnay-sous-bois. Et cette balade en tandem avec Emmanuel un jour d’été des années 80. L’été, Emmanuel était l’été. Quel numéro appeler pour lui demander, Tu as fait quoi, du tandem? As-tu lu Les fruits du Congo que j’étais passée prendre à la Hune la veille de la balade avec toi, en sortant du cinéma?
Les années passent comme un cartouche apparaît sur l’écran d’un film muet. Une éternité. Des lointains. L’actuel auditeur du Seigneur des anneaux est un jeune bébé silencieux au creux d’un fauteuil dans le salon de repos, près de l’écurie où Emmanuel vient d’étriller le cheval après la promenade sur l’île St Germain. Vita, grande sœur du jeune bébé regrette qu’aujourd’hui son cheval se soit montré nerveux. Les deux cavaliers parlent ensemble à l’animal inquiet. Leurs mains à plat sur le col isabelle.
Était-ce cette fois-là. Le cheval d’Emmanuel lâché sur le pré lance des ruades de plaisir, des hennissements, des pets de liberté. Était-ce cette fois où, «devant le pont étroit et la venue de la terreur», J’ai arrêté les médicaments, dit Emmanuel. Je ne fais plus rien, je me soigne au gingembre confit que ta fille m’apporte, je ne serai pas un insupportable squelette pour mes amis, je ne fais plus que vivre, on verra.
Il y a des années où tous les amis sont présents. Il y a des années où c’est différent. La maladie a piégé les corps. Cependant tout ce qui concerne les étés où Emmanuel est vivant demeure présent. Brillant. Malgré le bruit des pas sur le gravillon du Père-Lachaise. En dépit du fait que le Père-Lachaise a cessé d’être seulement un jardin de marronniers et d’art funéraire pour devenir tout à coup un cimetière. Une voix de jeu
Revue de presse
Le Figaro Lyon
Nelly Gabriel
Vendredi 12 mars 2004
La succession des mois en toile de fond, et le jardin en motif principal. Comment faire une danseuse avec un coquelicot est une chronique des travaux et des jours. De mars à juillet, s’y égrènent notés par une certaine Mona, mère d’un petit Jacob dévoreur de livres et de tartines de confiture, récits, portraits, contes, réflexions, souvenirs. C’est un journal de bord. Un pêle-mêle. Une manière d’herbier où toutes ces notations d’un temps qui passe, d’un temps passé, trouvent leur place. En son cœur, à sa source, le jardin d’enfance. Au fil des pages, les autres, familiers et étrangers. Le sien comme ceux croisés au hasard des routes. Comment faire une danseuse… est un roman. C’est écrit sur la première de couverture. On n’aurait pas cru. Quelle importance, au fond, sa nature ? Par sa fraîcheur, son tonus, le choix qu’il fait du vivant, ce livre rend heureux. C’est là ce qui compte. Son charme. Sa séduction immédiate. Le plaisir vif et soutenu que sa lecture procure ; Dans la typologie horticole, ce livre serait un jardin de curé : le genre fouillis délicieux où se mêlent en harmonies et dissonances étudiées de multiples espèces, d’infinies couleurs et senteurs. Par-ci par-là, de naguère, parfois de jadis, et surtout de maintenant, lui viennent des rires, des chagrins, des nostalgies, des petits drames, de grandes joies. On y découvre une littérature qui a la main verte, et des jardins comme des livres. Se trament des complicités de générations. Filiation, transmission. Le passé, humus du présent. Le lecteur fait son miel d’histoires de chat qui fugue et qui revient, de lectures à voix haute le soir dans la chambre, de graine de courage. La cause des pavots, la loi du géranium, la jonquille en figure de la jeune fille, la malédiction des limaces… : histoires naturelles et humaines. C’est la leçon des choses. Celle de la vie. La vie qui va, qui farniente, qui court ou qui s’enfuit. Concise, elliptique, Mona Thomas sait l’attraper de ses mots toujours bien choisis, de ses phrases prestement tournées. Jamais elle ne la fige. Cette femme a le secret de la pulsation, du rythme, de la cadence et des ruptures orchestrés. Sa phrase court, rapide elle aussi. Respire, s’arrête, repart de plus belle. Souple, vive. Vivante. On y revient toujours : pour grandir, et pour vivre tout simplement, rien de mieux que des livres, de l’amour et un jardin. Qu’il faut cultiver, bien sûr.
Nelly Gabriel