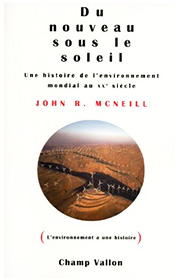Guerres mondiales, essor et chute du communisme, diffusion de la démocratie : voici les événements qui forment l’histoire habituelle du XXe siècle. Mais, durant ce siècle, l’impact des hommes sur l’atmosphère, l’eau, le sol et la biosphère a atteint une intensité sans précédent. Comme l’écrit J.R. McNeill dans ce livre important, avec le recul, le changement environnemental apparaîtra comme le phénomène le plus important de l’histoire du siècle.
À partir d’une présentation passionnante, qui mélange anecdotes, données et analyses éclairantes, McNeill nous propose le premier récit complet de « l’expérience gigantesque et incontrôlée menée sur la terre » par l’espèce humaine au XXe siècle. Ce livre est rien moins qu’une réécriture de la vision de l’histoire communément admise : Thomas Midgley, l’inventeur de l’essence au plomb et du premier gaz CFC, devient un des premiers personnages du siècle, devant les acteurs de deux guerres mondiales.
Revue de presse
Du nouveau sous le soleil:
Dans L’Histoire (février 2011)
Entretien de John McNeill avec Jean-François Mouhot
John McNeill l’affirme dans son dernier livre : le XXe siècle restera d’abord marqué par le désastre écologique.
En ce qui concerne les relations entre les hommes et le reste de la biosphère, le XXe siècle se démarque fondamentalement des siècles précédents. Je partage cette conviction avec Paul Crutzen, qui utilise un néologisme, l’«anthropocène», pour désigner ce qui s’apparente à une nouvelle ère où l’humanité est devenue la force écologique et géologique dominante (les géologues envisagent d’ailleurs sérieusement d’adopter ce terme). J’ai voulu avecmon livre décrire cette révolution, intervenue dans pratiquement tous les domaines, de la croûte terrestre aux couches stratosphériques, en passant par les océans et les zones urbaines. C’est une vue d’ensemble qui bouscule les récits classiques. Les héros de cette histoire sont des hommes peu connus comme Thomas Midgley, l’inventeur de l’essence au plomb et des gaz CFC, ou Fritz Haber, père de la synthèse de l’ammoniac à l’origine des engrais chimiques modernes, dont les inventions ont – sur le long terme – un impact durable pour la planète. Le principal moteur de ces changements a été notre prédilection croissante, au cours du XXe siècle, pour les énergies fossiles (charbon et pétrole notamment). Ensuite, la multiplication par quatre de la population mondiale entre 1900 et 2000. Il y a encore, bien sûr, les innovations technologiques, étroitement liées elles-mêmes aux systèmes énergétiques, ou l’idéologie de l’expansion économique, dans le monde capitaliste comme non capitaliste.
Cet engouement pour les énergies fossile s’explique d’abord par la plus grande facilité d’obtenir du charbon et du pétrole, grâce à l’amélioration des techniques d’extraction et de transport. Très vite, grâce aux chemins de fer, camions citernes, pipelines et tankers, le marché a été abondamment alimenté en énergies fossiles. Le prix de l’énergie est aujourd’hui beaucoup plus bas qu’il ne l’était il y a trois cents ans, avant le charbon et le pétrole.
Par ailleurs, l’accroissement de la population, l’idéologie de la croissance économique et de l’industrialisation et le passage d’un mode de production agraire à un mode de production industriel ont dopé la demande en pétrole et en charbon. Au cours du XXe siècle, la consommation d’énergie a été multipliée par quinze; une expansion qui dépasse l’explosion démographique!
Cette consommation exponentielle d’énergie fossile a eu d’abord pour conséquence l’augmentation de la pollution atmosphérique, en particulier urbaine, résultant de la combustion du charbon et du fioul domestique. Dans le monde occidental au début du XXe siècle, la qualité de l’air urbain était plus mauvaise qu’elle ne l’avait jamais été, et plus mauvaise qu’elle ne l’est maintenant. D’où de graves problèmes de santé publique. A Londres, par exemple, en 1952, entre 4 000 et 12 000 personnes furent tuées par le «smog», cette brume sombre et épaisse constituée de fines particules de pollution et d’ozone. Au cours du XX° siècle, la pollution atmosphérique a causé sans doute autant de morts que la seconde Guerre mondiale (le nombre total de décès causés par la pollution de l’air au cours du XXe siècle est estimé à 40-50 millions, ce qui est comparable au nombre global de morts provoqués par la guerre de 1939-1945).
L’environnement a été aussi transformé plus directement par l’utilisation d’énergie bon marché. La déforestation a été accélérée par l’usage de machines fonctionnant aux énergies fossiles, de la tronçonneuse aux engins colossaux qui peuvent débiter un tronc en quelques secondes. Autre exemple: l’extraction minière. Là encore, seuls des engins très gourmands en énergie peuvent décapiter le sommet d’une montagne ou creuser d’énormes galeries dans la terre pour extraire quelques grammes d’or. De même, les baleiniers n’auraient pas été à deux doigts de faire disparaître plusieurs espèces de cétacés sans l’existence de navires gigantesques propulsés au fioul, comme ces navires soviétiques de la taille de porte-avions qui opéraient clandestinement durant la guerre froide.
Mais il est plausible que c’est le changement climatique qui apparaîtra à long terme comme la principale conséquence de la diffusion des combustibles fossiles. Au cours du XXe siècle, il est resté modeste : entre 1900 et 2000, l’élévation de température est inférieure à 1°C, et l’élévation du niveau des mers limitée à environ 20 cm. Mais le réchauffement de la planète offre un exemple éloquent de la fragilité des systèmes sur lesquels reposent nos sociétés. Espérons qu’au XXIe siècle nous saurons hâter les transitions nécessaires pour éviter de subir de plein fouet les pires méfaits du réchauffent du climat. Il faudra pour cela favoriser à la la transition énergétique vers des systèmes plus propres et la transition démographique.
(Propos recueillis et traduits par Jean-François Mouhot.)
Esprit
(mai 2011)
Nous vivons une époque qui, sur le plan des perturbations de l’environnement, est sans précédents. Pour en prendre la mesure, peu de livres se révèlent aussi instructifs et adoptent une perspective aussi profonde que celui-ci, paru en 2000, et qui vient d’être traduit en français. Les qualités de cet ouvrage le recommandent tant pour des historiens que pour des géographes, des personnes préoccupées d’économie ou de politique de l’environnement, voire des philosophes intéressés par la grandeur et les limites de la condition humaine. C’est que, grâce à un travail de plusieurs années et à de remarquables talents d’écrivain, MeNeill est parvenu à combiner de façon élégante des données précises issues des sciences naturelles avec des réflexions de haute volée, le tout relevé par des citations d’auteurs aussi disparates que Shakespeare, Swift, Machiavel, ou encore l’Ecclésiaste d’où est tiré le titre. « Rien de nouveau sous le soleil? » Et bien si : l’homme a modifié son environnement dans des proportions inédites, avec des conséquences qui continueront à se manifester pour des siècles ou des millénaires.
Le livre est construit en deux parties. La première aborde systématiquement les changements dans la lithosphère et la pédosphère (les sols), l’atmosphère, l’hydrosphère (eaux), puis la biosphère. Les analyses de chaque chapitre sont présentées à travers des cas d’études régionaux choisis dans le monde entier et accompagnées des tableaux de synthèse. Ces cas vont bien au-delà d’études multidisciplinaires au sens environnemental, puisqu’ils incluent également des motivations politiques (le nationalisme par exemple). L’auteur s’attaque ainsi avec méthode aux changements environnementaux sur l’ensemble de la planète durant tout le XXe siècle. Il remonte d’ailleurs souvent à des époques antérieures afin de préciser les spécificités de la période en cours, même si l’on peut discuter de «l’exceptionnalisme» du XXe siècle, qui poursuit et amplifie certaines tendances des âges précédents.
La seconde partie du livre, plus courte, concerne les «moteurs de changements», et compte un chapitre sur les mégapoles, un autre sur les combustibles, l’outillage et l’économie et le dernier sur les idées et la politique. Celui-ci s’ouvre sur le type de sentence que McNeill affectionne:
«L’une des raisons pour lesquelles l’environnement a tellement changé au XXe siècle est que — du point de vue de l’écologie — les idées et les politiques dominantes ont quant à elles si peu changé.»
Le chapitre n’en présente pas moins les évolutions du dernier tiers du XXe siècle dans la pensée environnementale, période à laquelle la plupart des rapports et ouvrages limitent l’objet des questions environnementales modernes.
On songera peut-être, en matière d’histoire de l’environnement et de ses enseignements, à Jared Diamond, auteur notamment de De l’inégalité parmi les sociétés. Essai sur l’homme et l’environnement dans l’histoire (prix Pulitzer, 1998) qui a bénéficié d’un succès que n’a pas eu McNeill à ce jour, amplifié par son livre Effondrements. Comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie (2006). S’il fallait comparer ces deux auteurs, on peut noter que Diamond n’est pas historien, qu’il est plus axé dans le premier livre cité sur les déterminismes biologiques, et dans le second sur les «effondrements» massifs, avec en vue des leçons à tirer (difficilement) pour éviter l’effondrement possible de notre société globale. Pour sa part, l’histoire environnementale du XXe siècle de McNeill recense un grand nombre d’effondrements locaux, mais aussi de dégradations et d’évolutions, dus à des transformations environnementales non intentionnelles. L’un des intérêts du livre est d’aller rechercher quantité de problèmes environnementaux «d’avant l’environnementalisme» (si l’on date celui-ci des années 1960 aux États-Unis, avant de se diffuser dans le reste du monde): l’extraordinaire pollution des villes américaines, par exemple, ou celle des grands lacs dans les pays industrialisés ou de la région de la Ruhr. Toutes ces formes de pollution ont suscité à leur époque des réactions vigoureuses de différents groupes, notamment des femmes, en particulier contre les pollutions locales. Ces dynamiques de contestation, qui rencontraient souvent, en guise de réponse, l’indifférence ou la surdité avant les années 1960, sont reconstituées de façon vivante, de même que sont analysés les facteurs qui ont fait évoluer, depuis, les pratiques et les mentalités. Ce qui permet alors à l’auteur de justifier dans la dernière page de son épilogue, intitulé « Et alors ?», l’apport que peut avoir l’histoire environnementale.
«Si notre durée de vie atteignait 700 ou 7000 ans, nous pourrions comprendre [notre condition actuelle] sur la base de notre expérience et de notre mémoire. Mais pour des créatures dont l’espérance de vie est de plus ou moins 70 ans seulement, il faut procéder à l’étude du passé, tant lointain que récent, pour savoir quelle est la gamme des possibilités et déterminer ce qui va perdurer.»
Edwin Zaccai
La vie des idées
(juin 2011)
L’ouvrage de John McNeill comble en France une lacune : il est de plus en plus difficile de s’orienter dans le flot mondial de publications en provenance des sciences environnementales et des humanités qui traitent du rapport à la nature. Par delà l’anecdote de telle ou telle extinction ou invasion biologique, qui alimentent dans le creux estival les feuillets « sciences » des quotidiens et des magazines, que nous disent ces recherches de l’impact de notre mode de vie sur la planète et de son évolution à travers les âges ? Les coups de projecteur médiatique sur telle ou telle controverse obsidionale et hexagonale, sur telle ou telle catastrophe naturelle, pétrolière ou nucléaire, tendent à brouiller la perception des enjeux globaux de la mise en coupe réglée de la planète. En tout cas, ils ne facilitent pas la perception des tendances et des résultats les plus importants de la recherche et des conclusions qu’on peut en tirer pour notre existence. Il y a dix ans, McNeill, historien américain, auteur d’ouvrages remarqués en histoire environnementale, relevait le défi de produire une synthèse posant clairement les enjeux historiques des découvertes récentes. La version française est enfin disponible, et nous osons croire qu’elle aura l’impact qu’elle mérite.
Le XXe siècle est celui de l’apogée de la formidable croissance démographique et économique de l’humanité commencée au siècle précédent : la population mondiale et le revenu par tête ont été multipliés par quatre et la consommation d’énergie par seize. Cet accroissement s’est construit sur l’abondance des ressources fossiles et de l’eau douce à bon marché. En construisant son mode de vie sur ces prémisses, l’humanité a fait le choix inconscient de l’hyper-spécialisation sur un nombre limité de ressources – la « stratégie du requin », selon McNeill –, et non pas sur la faculté d’adaptation à des ressources diverses – la « stratégie du rat ». Cette stratégie globale de spécialisation, qui représente une bifurcation soudaine dans l’histoire de l’évolution humaine, est un pari reposant sur la foi que les conditions écologiques favorables à ce succès demeureraient les mêmes et qu’une croissance gagée sur elles serait continue. Or l’on s’est aperçu progressivement au cours du siècle que l’abondance de l’eau douce et du combustible est temporaire. En outre, elle se trouve de plus en plus menacée par notre spécialisation elle-même, la surconsommation énergétique. C’est là que le constat de L’Ecclésiaste ne tient plus, affirme McNeill, qui retourne le verset proverbial. L’avènement d’une nouvelle ère géologique, « l’anthropocène » (Paul Crutzen) a modifié ce qu’on croyait immuable, que la « terre demeure ferme pour jamais » et que « la mer ne déborde point » (I, 4, 7). La prévision de McNeill est modérément optimiste. Il rappelle que la destinée de celles des sociétés passées qui ont fondé leur survie sur une spécialisation exclusive (mais à une échelle bien moindre) permet de penser que la mutation de notre système socio-économique, de nos comportements et modes de pensée producteurs et consommateurs – la sortie du fossile – sera un douloureux ajustement.
Une histoire totale
Par rapport à d’autres synthèses classiques en histoire environnementale [1], l’ambition de McNeill n’est rien de moins que de proposer une somme des savoirs scientifiques sur la grande transformation environnementale du XXe siècle : les bouleversements de la planète sous l’action des évolutions humaines et des systèmes techniques, au centre desquels McNeill place les choix énergétiques. Pour organiser un matériau si important, il s’en remet au découpage proposé par les sciences de la planète : lithosphère et pédosphère (terre), atmosphère (air), hydrosphère (eau) et biosphère (faune et flore). À cette taxonomie, il adjoint trois chapitres consacrés à la démographie et à l’urbanisation, à la dépendance vis-à-vis des énergies fossiles et à l’impact politique des idées et mouvements environnementalistes.
Le lecteur tient là la synthèse de centaines de travaux de langues diverses spécialisés dans les sciences de la vie et de la terre : de la limonologie à la géologie en passant par l’épidémiologie. L’horizon intellectuel de l’auteur s’étale sur quarante pages de bibliographie (un millier de références). Il se fait passeur de savoirs depuis les sciences sur les écosystèmes jusqu’aux humanités qui raisonnent sur la « sélection non naturelle » introduite par les développements récents des sociétés humaines. Il embrasse les résultats de toute science, au mépris du cloisonnement des facultés et des peureuses hésitations, dans une étreinte digne d’un érudit de la Renaissance.
McNeill indique ce faisant une voie transdisciplinaire dont il démontre la productivité pour l’histoire. Sa conviction épistémologique est que « l’histoire moderne de l’écologie de la planète et l’histoire socioéconomique de l’humanité ne prennent leur sens véritable qu’une fois considérées globalement » (p. 20). Dès lors, on n’écrit plus la même histoire quand on décrit des événements fondateurs tels que la découverte du Nouveau Monde, la révolution industrielle et leurs ramifications socio-politiques. L’histoire doit prendre en compte l’évolution des « paramètres vitaux de la planète » qui sont le soubassement de toute activité humaine et la mettre en relation avec les transformations culturelles et mentales des sociétés humaines (p. 476).
Une histoire mondiale
L’augmentation de la population mondiale est le facteur le plus évident des modifications anthropiques sur l’environnement. Pourtant, McNeill propose une vision nuancée de cette influence en passant en revue les liens entre accroissement démographique et déforestation, épidémies, pollutions etc. (chap. 9). Sa conclusion est la suivante : la démographie pèse sur la planète moins à travers l’augmentation brute de la population qu’à travers l’urbanisation et les phénomènes migratoires qu’elle engendre dans un monde globalisé.
Du nouveau sous le soleil est une histoire mondiale, empruntant ses études de cas à toutes les latitudes. Outre les épisodes classiques (Dust Bowl, mer d’Aral, déforestation en Amazonie, pêche à la baleine, etc.), McNeill revient sur des histoires peu connues, comme celle de l’érosion au Kenya sous la pression des cultures de rente, de la bioinvasion du tilapia (ou « poulet aquatique ») sous les tropiques, de la pollution atmosphérique à Cubatão (Brésil), et des ravages sociaux et environnementaux de l’exploitation du nickel en Nouvelle Calédonie. La « transition épidémiologique », domaine de prédilection de McNeill, est exposée de manière particulièrement pénétrante (p. 272-279) [2]. Certes l’analyse est européocentrée, l’auteur ne s’en cache pas : c’est l’histoire de l’imposition à l’ensemble de la planète d’un mode de relation à la nature, caractérisé avant tout par l’exploitation à courte vue et ses conséquences imprévues et « dégâts collatéraux ». L’auteur rejette les autres civilisations dans le passé des sociétés pré-modernes, trop vite sans doute, pour se focaliser sur les tendances majeures du XXe siècle que sont la croissance et la consommation, véritable credo mondial.
Une histoire globale
Du nouveau sous le soleil est une histoire globale. Cela est dû à l’objet même : l’empreinte humaine sur la planète est passée d’un niveau local à un niveau régional puis global. McNeill insiste sur les changements d’échelle de la pollution de l’air et de l’eau : d’un problème riverain, local, elle devient un problème régional avec les fumées des cheminées d’usine, la pollution des grands fleuves et des mers ; et un problème global avec les modifications climatiques dues aux gaz traces. Ce qui intéresse McNeill avant tout, ce sont les chaînes de dépendance globale entre les échelles, et entre nature et société, car la transformation des écosystèmes implique toujours des modifications des rapports politiques et sociaux. Globalement, les moyens inventés pour lever certaines contraintes en créent d’autres : sur le Nil, le Pô ou le Colorado, l’irrigation révolutionne l’agriculture par l’augmentation radicale des surfaces cultivables. Mais les barrages coupent l’apport sédimentaire en aval, menaçant les deltas, détruisant les pêcheries et affaiblissant les populations qui en dépendaient. De bonnes terres sont rendues inaptes à la culture par la salinisation et les infiltrations et la pression agraire augmente sur les aires marginales et boisées. Sur le Nil, les infections parasitaires pullulent. L’irrigation pousse à l’utilisation d’engrais (dont la production pompe l’électricité produite par les barrages) et donc à la monoculture qui favorise certains exploitants et circuits économiques au détriment d’autres, et épuise les terres. Enfin, l’évaporation naturelle décuplée dans les réservoirs fait s’évaporer les promesses d’eau infinie et bon marché, entraînant les planificateurs dans une fuite en avant hydraulique.
La globalisation des interactions nature-culture est particulièrement visible dans la pêche, passée en un siècle d’activité locale et traditionnelle à la plus globalisée, uniformisée et moins réglementée des industries extractives (p. 330-338). Soumis à concurrence effrénée, bénéficiant d’innovation techniques capitales (sonar, image satellite, filets dérivants, chalutiers sophistiqués) et souvent du soutien de leur gouvernement, les pêcheurs ont écumé les mers dans un mouvement de balancier entre investissement, expansion, épuisement des ressources halieutiques, et subvention pour limiter la surexploitation. L’exemple du Pérou, le plus gros producteur dans les années 1960, mais ruiné dans les années 1970, est édifiant ; tout comme celui de Terre-Neuve : Ottawa finança la modernisation de la flotte dans les années 1980, mais dut très vite imposer un moratoire qui mit les pêcheurs dans de grandes difficultés. La pisciculture semble un moyen de remédier à la stagnation de la pêche, si ce n’est que les crevettes d’élevage se nourrissent de farine de poisson pêché quelque part.
Du XXe au XXIe siècle
Chacun regrettera que son thème préféré ne reçoive pas assez d’attention dans une synthèse nécessairement concise. Si la biodiversité n’occupe que trois pages, c’est sans doute que notre perception des priorités écologiques a changé depuis la parution de la version originale en 2000 (p. 352-354). Le nucléaire, qui nous préoccupe tant ces jours derniers, est considéré presque uniquement sous ses aspects militaires (p. 450-452). Pourtant, l’extraction de l’uranium – qu’on pense au Niger, ou, bientôt, à la Tanzanie –, la pollution des terres arables aux isotopes dangereux dans l’ex-Union soviétique et le stockage des déchets radioactifs ne sont pas des épiphénomènes du siècle passé, même s’ils n’ont sans doute pas eu jusqu’à présent un impact comparable aux hydrocarbures, étant donné la faible part du nucléaire dans la consommation d’énergie mondiale (6 %).
Dix ans se sont écoulés depuis l’édition originale. Si les analyses d’ensemble de MacNeill n’ont pas pris une ride, il en va autrement des séries statistiques et de l’énorme bibliographie, qui remontent aux années 1990. La préface à l’édition française permet à l’auteur de recontextualiser ses conclusions à dix ans d’écart. L’ascension de la Chine et son choix de fonder sa croissance sur les énergies fossiles (en particulier sur le charbon) en ont fait le principal émetteur de gaz à effet de serre. Cette tendance elle-même vient confirmer à la fois la centralité des systèmes énergétiques dans les transformations anthropiques de la biosphère et la prégnance du modèle industrialiste et consumériste sur les mentalités.
McNeill est étranger à tout catastrophisme et sensationnalisme, dans une matière où les motifs de pessimisme sont pourtant nombreux. Le bilan nuancé tient dans un paradoxe : la levée de contraintes millénaires sur la santé et la population – la médecine publique fait reculer les épidémies, la mise en culture de nouvelles terres permet de nourrir deux milliards d’être humains supplémentaires, la mécanisation met un terme au régime d’énergie somatique etc. – a fait apparaître de nouvelles contraintes, dont certaines sont globales – la saturation de la planète par nos déchets, l’apparition de nouvelles souches virales résistantes, les changements climatiques étant quelques exemples.
Il est regrettable que le copieux index de la version originale n’ait pas été reproduit dans la version française. La navigation dans une somme aussi dense n’en est pas facilitée. Le désintérêt des éditeurs pour les index persiste malheureusement dans l’édition francophone, au mépris des pratiques de lecture et de travail.
Marc ELIE