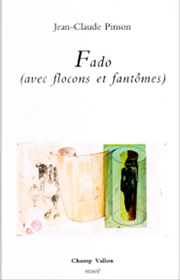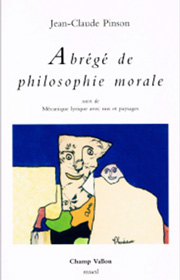Drapeau rouge évoque les années écarlates d’avant et d’après Mai 68, à travers les aventures et déboires d’un narrateur enrôlé, comme l’auteur, dans les rangs de ceux qu’on appelait alors «marxistes-léninistes».
Habit d’Arlequin, Drapeau rouge est un livre où l’on croise pêle-mêle des êtres de fiction et des personnages historiques (de Mao à Mallarmé), des fantômes et des animaux – ou encore des mots qui manifestent.
Une question hante le livre: que faire aujourd’hui dudit drapeau? À défaut d’une réponse, Drapeau rouge, refusant de baisser pavillon, persiste à inventer des fictions et des formes pour poser la question, toujours actuelle, de l’égalité.
Revue de presse
ART PRESS
(mars 2008)
par Philippe Forest
La poésie malgré tout
Certains poètes d’aujourd’hui, nous dit‑on, se plaignent d’Art press, du peu d’attention qu’on y accorde à leurs livres, du scandaleux manque de considération qui va à l’importance pourtant extrême de leur œuvre en cours. Il faut les comprendre et même leur donner raison. C’est vrai la part faite dans les pages de ce magazine à la poésie contemporaine est outrageusement petite; lorsque l’on y chronique pourtant un recueil, on dirait que c’est par exception ou par accident, sous l’effet du hasard ou de la distraction. Et, là où il ne devrait être question que de création d’avant-garde, le vice va même jusqu’à faire parfois l’éloge de ce que la poésie du siècle passé a indiscutablement produit de plus indéfendable et de plus dépassé. On feint ainsi d’ignorer que la poésie connaisse désormais un nouvel «âge d’or» où elle renaît sous le signe de la «performance» ‑ autrement dit: du «spectacle». Sauf erreur de ma part, il faut remonter à 1998 pour trouver dans Art press plusieurs pages de suite où il s’agit – mais de quelle manière ! – de la poésie d’aujourd’hui. Il n’était que temps, on le conçoit, de faire amende honorable. De poésie, il est pourtant souvent question ici, de la manière dont celle‑ci se renouvelle et se perpétue chez certains romanciers, philosophes, artistes, cinéastes, et même parfois chez certains poètes. Afin de participer nous aussi au tout récent «Printemps des poètes», on en a choisi trois parmi ceux qui sont à notre goût.
Ph. F
JEAN-CLAUDE PINSON
Plaidoyer pour le prosaïsme poétique
Drapeau rouge (Editions Champ Vallon)
A Piatigorsk, Sur la Poésie (Editions Cécile Défaut)
Dire d’une poésie qu’elle est prosaïque ne passe pas en principe précisément pour un compliment. Du moins auprès de ceux qui estiment qu’il leur appartient de définir très dogmatiquement ce que la poésie doit être, d’en contrôler le commerce, de fixer pour elle les frontières du «bon gout» et qui conçoivent donc le «prosaïque» comme une intolérable concession de la parole poétique à la vulgarité de «l’universel reportage» dont on sait que, depuis le romantisme et le symbolisme, c’est contre elle que s’est constituée une certaine idée de l’absolu littéraire. Il est donc considéré comme acquis que, dans le poème, la parole parle. Et, de fait, elle parle mais, le plus souvent, comme on ne le sait que trop, c’est très précisément pour ne rien dire. Sans d’ailleurs qu’on puisse le lui reprocher puisque c’est précisément de ne rien dire, de ne dire que ce rien – où, s’abolissant, elle s’accomplit –, que la poésie prétend tirer sa seule et essentielle légitimité. Toute une mythologie de la «parole pure» – historiquement datable, idéologiquement situable – gouverne ainsi le plus souvent la poésie et même – encore qu’ils n’aiment pas trop qu’on le leur rappelle – chez les poètes qui s’estiment aujourd’hui à des années lumières au-delà d’une telle «vieillerie». Qu’une autre conception soit cependant possible, il y a pourtant toute une part de la poésie – et même française: Hugo, Apollinaire, Cendrars, Aragon, pour ne citer que quelques-uns des noms les plus évidents –, qui en témoigne assez manifestement. Et tout ce qui reste un peu lisible dans l’abondante production actuelle relève de cette pratique poétique qui, ne faisant pas d’elle-même sa fin exclusive, accepte de réfléchir cette part «prosaïque» de l’expérience (le désir, le deuil, disons : la vie) qui, gageant le texte sur le réel, seule, justifie l’exercice littéraire.
Prosaïsme
Les deux nouveaux livres de Jean‑Claude Pinson publiés en ce début d’année constituent une belle invitation à réfléchir à ce que l’on peut donc choisir de nommer – afin d’en proposer la défense sans doute inutile – le «prosaïsme» et qui constitue une alternative salutaire au «poétiquement correct» d’aujourd’hui. Du côté de la poésie elle‑même, Drapeau rouge est le sixième «recueil» – encore que le terme soit particulièrement impropre – signé de Jean‑Claude Pinson et fait suite plus spécialement à Fado (avec flocons et fantômes) (2001) et Free Jazz (2004) avec lesquels il constitue une vraie série. Du côté de l’essai, A Piatigorsk reprend la matière théorique développée dans Habiter en poète (1995) et Sentimentale et naïve (2002) matière à laquelle il donne la densité nouvelle d’une sorte de manifeste. La simultanéité de ces deux parutions autorise d’autant mieux à considérer l’ensemble de la démonstration proposée par Pinson depuis une quinzaine d’années qu’il écrit, que chacun des deux titres concernés se caractérise par une dimension rétrospective, par une ambition récapitulative. Il s’agit, en effet, pour l’auteur de faire comme un pas en arrière dans le temps et un pas de côté dans l’espace: avec Drapeau rouge, de s’en revenir vers l’époque révolue de l’engagement marxiste‑léniniste (plus spécifiquement sous la forme du militantisme maoïste) tel qu’il l’a vécue autrefois; avec À Piatigorsk, de s’en aller vers cette lointaine ville du Caucase, où mourut Lermontov, et où le hasard d’un séjour (une cure thermale!) lui donne l’occasion de repenser aujourd’hui la question poétique à la lumière de l’épopée russe dont l’auteur d’Un héros de notre temps – livre adoré de Lénine – fut l’un des acteurs fugitifs. L’enjeu consiste donc bien dans les deux cas à se demander ce qu’est la poésie et ce qu’elle peut encore, une fois refermé le «Grand récit de l’émancipation» duquel elle a été quasi indissociable depuis le Romantisme.
Il est douteux qu’un ancien maoïste apprécie la comparaison avec celui qui fut, en France, le poète officiel de ce que l’on nommait du côté de Tel Quel le «dogmatico‑révisionnisme» stalinien. Et de fait Pinson ne cite jamais Aragon – dont le lyrisme et l’emphase lui sont d’ailleurs très étrangers. On sait pourtant, depuis le Fou d’Elsa, qu’une épopée chantant la fin d’un monde peut commencer par une simple faute de français («La veille où Grenade fut prise…») et qu’une autobiographie en vers conduit parfois à s’enfoncer très profond au sein de ce que le Roman inachevé nommait «la nuit de Moscou». Il n’y a donc pas de raison qu’un autre poème, épique et autobiographique lui aussi, ne puisse procéder d’une rêverie prenant pour objet l’une des bizarreries du vocabulaire russe: «D’une certaine façon tout est venu du russe, de la langue russe. Où rouge (krasnù) et beau (krasivii) sont un même mot (ou presque), et où le premier peut d’ailleurs signifier les deux, le second sens (“beau”) se déduisant du premier (“rouge”).» Il s’agit donc, on l’a compris, à travers le dialogue du «krasnii» et du «krasivii», de poser de nouveau, et à une époque où elle semble devenue particulièrement anachronique, la vieille question des relations entre poésie et politique, entre Beauté et Révolution. Et pour que celle‑ci puisse être reprise sans pourtant retomber dans l’ancienne illusion lyrique, le défi du «prosaïque» exige d’être relevé.
Poétique et prosaïque
L’une des spécificités de l’écriture de Pinson – et notamment depuis son Fado – consiste en effet en ce que la poésie, loin de tourner le dos à la prose, s’engage avec elle dans un jeu où toutes deux alternent et se mêlent. Une telle démarche consiste moins à transformer la prose en poésie (comme le fait le «poème en prose» lorsque, comme c’est le plus souvent le cas, il conduit à redoubler la densité énigmatique du texte) qu’à reconduire la poésie vers la prose en acceptant qu’elle se charge à nouveau de sa dimension narrative et réflexive. Car la poésie, comme le déclare Pinson dans A Piatigorsk, est bien «dans la littérature» et non «en‑dehors» ou ((au‑dessus» d’elle: «Mêlée à d’autres genres, se nourrissant d’une parenté, d’une mitoyenneté retrouvée avec le spectre entier des formes et modalités qu’emprunte la littérature, la poésie peut à nouveau, comme le récit (ou le roman), mais à sa manière, raconter; comme l’essai, mais à sa façon, méditer». Sur un tel principe, un livre comme Drapeau rouge entrelace prose et vers de telle sorte que se constituent une intrigue, une réflexion qui font du recueil, plutôt que l’arrangement formel de ses fragments, le développement d’une histoire à l’intérieur de laquelle tout est susceptible de prendre sa place. Une sorte de roman, donc… Et ainsi s’explique la vraie provocation qui consiste pour un poète d’aujourd’hui (en principe: postmoderne, comme il sied) à remettre à l’ordre du jour le très réaliste et très socialiste Georg Lukacs et sa théorie du roman, découvrant en elle «une façon dans la prose de se souvenir de la poésie, d’y faire passer en contrebande des vers oppositionnels».
Il faut bien que, prosaïquement, le poème brise avec l’exigence exclusive de se dire lui-même et cesse de s’enchanter du prodige solitaire de sa propre production pour qu’il accueille en lui la matière retrouvée du monde dans toute sa triviale et concrète diversité. Drapeau rouge raconte et réfléchit l’expérience dans l’Histoire de celui qui en fut l’auteur et inclut toutes ces scènes bien réelles où un tout jeune homme rompt avec le cours rentable de l’existence estudiantine, passe dans la clandestinité de l’activisme politique, concilie comme il peut l’austérité militante et le commerce amoureux, considère un jour une enfant morte, enterre beaucoup plus tard un écureuil à défaut de cette entant, confie ces deux corps à la bénédiction des grands oiseaux de mer qui planent sur la plage où il se promène, converse avec quelques amis (parmi lesquels figurent les fantômes de Baudelaire et de Pessoa), en leur compagnie écoute du jazz et feuillette quelques livres et de vieux albums de photographies puis s’en retourne enfin à la solitude d’une retraite aménagée à deux pas de l’Océan atlantique.
Poétique et politique
«La page, se demande Pinson, comment s’en contenter, quand on a dès le départ cherché une beauté immense où pouvoir se perdre, s’anéantir et cru trouver l’extase au beau milieu d’une mer de drapeaux rouges.» La solution ne consiste certainement pas à relever l’étendard déchu de la révolution dont le vrai visage est définitivement apparu : «Dieu cruel, assoiffé de sang. Dieu aztèque en adoration duquel cœurs extraits du thorax fendu en deux par le couteau d’obsidienne. Dieu désormais détrôné.» L’ironique roman d’éducation, la perplexe et nostalgique épopée, l’autobiographie mélancolique et cependant amusée que constitue Drapeau rouge n’en appelle à aucun «revival» révolutionnaire mais bien plutôt à la description concrète des «stratégies de non‑renoncement» par lesquelles la poésie, sans consentir encore à la barbarie de l’utopie ancienne, n’abjurerait pas la possibilité de penser le présent.
Ce sont ces «stratégies» que, sous couvert de théorie littéraire, examine A Piatigorsk. Pinson est tout sauf un polémiste. C’est affaire de tempérament ou bien d’expérience – après tout, il est heureux que l’excès de dogmatisme conduise à la tolérance et à la tempérance qui sont deux vertus. D’où l’éclectisme de ses goûts et la modération de ses propos qui font également de Pinson le meilleur – le plus équitable – des analystes de la création poétique française d’aujourd’hui. Il n’empêche qu’une vraie conviction informe le propos de l’essayiste. Elle tient tout entière dans ce terme de «poéthique» dont le manifeste, paru aujourd’hui aux éditions Cécile Défaut, permet d’appréhender davantage la signification. Contre une poésie qui ne se survit à elle-même que sur le mode de l’élégie (la déploration «moderne» assignant au texte la tache exclusive de chanter la «trace des dieux enfuis») ou en décrétant non pertinente toute référence à l’expérience (I’illusionisme «postmoderne» déclarant que le texte doit faire sa seule matière de la fiction, du simulacre puisque ceux‑ci seraient devenus notre unique horizon), contre une telle doxa qui arbitrairement considère deux fois révolue la question du réel, le «poéthique» tel que le conçoit Pinson cherche d’autres possibles. Il repose sur le pari très simple – et cependant assez peu souvent relevé – qu’un lien n’est pas tout à fait inconcevable entre l’écriture et la vie puisque «la poésie n’est pas que la poésie qui s’écrit (ou se «performe»), mais aussi ce qui d’elle existe et vaut hors d’elle‑même.» Le dilemme n’est certes pas nouveau, mais la proposition «poéthique» consiste à se refuser à en sortir de façon radicale soit en renonçant à l’écriture pour la vie, soit en renonçant à la vie pour l’écriture – selon les postulations contraires du «rimbaldisme» et du «mallarméisme» tels que la poésie moderne les a constitués en véritables mythologies jumelles. L’enjeu est indissociablement poétique et politique car «multiplier les points de tangence entre formes verbales et formes de vie» relève d’une «éthique de soi» dont, se fondant notamment sur le dernier Foucault, Pinson montre comment elle peut constituer une réplique à l’hégémonie aliénante du «biopouvoir» d’aujourd’hui.
Il faudrait être plus long (je l’ai été assez) pour rendre compte de la façon dont une telle conception – qui envisage les textes «non comme des monuments mais comme réservoirs de possibles modèles d’existence» rend pensable un exercice de l’écriture qui rompe avec l’aristocratisme fatigant du dix-neuviémisme poétique et se trouve enfin compatible avec une vision vraiment démocratique de la littérature. Cela n’est pas rien, pourtant. Mais cela passera sans doute pour peu aux yeux de ceux qui considèrent de telles préoccupations comme trop prosaïques pour concerner le sacerdoce sublime de la pure parole poétique.
Philippe FOREST