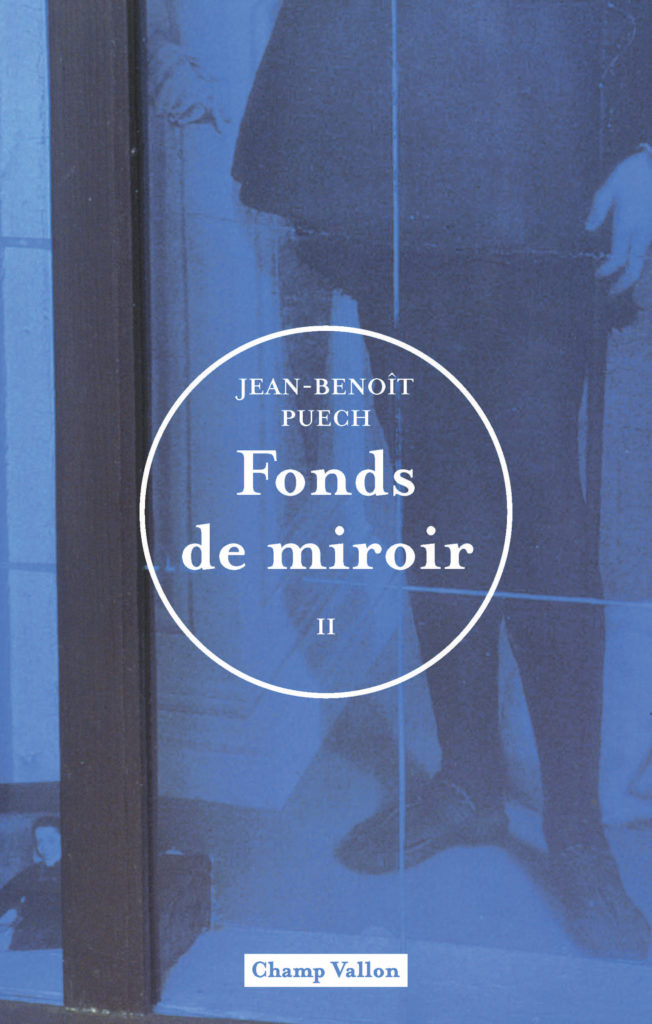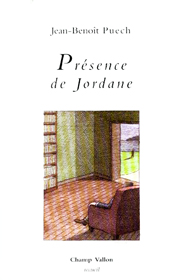Présence de Jordane
Jordane et moi (pp. 11-34)
Présence de Jordane: tel était le titre du livre que je préparais depuis quelques années, en marge de mon activité professionnelle. J’ai quelque part dans mon bureau d’Olivet, où j’écris ce matin (Agnès vient de partir pour la fac, à vélo malgré la brume et le froid), de nombreux papiers destinés à cet ensemble hypothétique. J’avais déjà décrit ce projet dans une nouvelle, l’attribuant alors à son personnage principal. Plus tard, dans le prière d’insérer de Toute ressemblance…, je l’avais annoncé «en préparation».
Je rêvais de réaliser une imitation des hommages que l’on consacre aux grands écrivains, et qui rassemblent des inédits, des études, une biographie et une bibliographie, une iconographie et surtout des témoignages sur l’auteur ou sur l’homme. Ceux de la NRF sont célèbres, mais il y en a bien d’autres et ils se sont multipliés depuis le regain d’intérêt du monde littéraire et des universitaires pour l’auteur en personne ou en personnage. J’ai bien dit: une imitation, puisque cette fois l’ensemble devait être consacré à un écrivain imaginaire.
J’avais parfois envisagé aussi d’imiter un de ces attachants Cahiers qu’une «Association d’amis» d’un auteur crée pour perpétuer la présence du cher disparu et pour rassembler autour de livraisons régulières la société d’intimes et d’inconnus épris de ses œuvres complètes, dont feront partie certains témoignages, la biographie autorisée, le catalogue de la maison-musée, la maison elle-même… et quelques visiteurs.
Écrivant ceci je pense aux maisons d’écrivains que j’ai découvertes avec émotion, en France et à l’étranger. Je n’oublie pas les auteurs qui préféraient les grottes et les greniers, les hôtels anonymes, les voyages en voilier ou les jolies voitures de l’Harmonika-Zug. Je pense aux dernières demeures de granit gravé, de japon nacré, de légendes livresques; bien sûr à Valery Larbaud et aux premiers Cahiers de ses amis, à leurs couvertures jaune, blanc, bleu de Paul Devaux; à une nouvelle de Henry James; au dessin qu’Agnès m’a envoyé de Berlin et qui est là près de moi, «Grünewaldstrasse 13»; au bureau de mon père, rue de Vaucouleurs, et à sa tombe à Marcilly, près de la tombe de Jean Loiseleur.
Mon écrivain imaginaire se nommait donc Jordane, Benjamin Jordane. J’ai publié ses notes de lecture dans La Bibliothèque d’un amateur. Puis j’ai publié, sous le titre de L’Apprentissage du roman, des extraits de son Journal consacrés à son maître en littérature, Pierre-Alain Delancourt. Dans Toute ressemblance…, enfin, j’ai publié quelques-unes de ses nouvelles inédites, suivies de leur commentaire critique un peu contourné, parfois trop, que j’ai attribué à un universitaire nommé Stefan Prager.
À travers ces textes, on peut se faire une idée de la vie de Benjamin Jordane, dont je n’ai jamais vraiment écrit la biographie. Elle ressemble parfois à la mienne, et elle est placée sous les signes simples (simples?) de la différence et de la contradiction.
Différence, par exemple, entre les origines de ses parents: géographiques, sociales, culturelles… Je ne peux pas développer ici comme je l’ai fait plusieurs fois, pour moi, en m’inspirant de mon père, de ma mère, et de leurs familles dont dès mon enfance j’ai perçu les différences vraiment impressionnantes dans tous les domaines. Que de fois j’ai dû faire, passant d’un monde à l’autre, ce qu’un ami plus tard, à qui je me confiai, nomma «le grand écart»!
Et maintenant, quel temps verbal vais-je employer pour raconter, en bref, la vie de ce Jordane? Le passé des histoires imaginaires? Le présent des résumés d’œuvres littéraires ou cinématographiques? Vais-je me laisser entraîner par mon propos jusqu’à parler de mon personnage comme s’il existait?
Le père de Jordane se nomme Henri. Il a grandi dans le monde rural très pauvre et très sauvage de la Haute-Auvergne du début du siècle dernier; puis il est devenu officier d’artillerie après des études dans une École Nationale Professionnelle, par exemple à Nantes. Il aime les uniformes de prestige, l’Empereur et ses maréchaux, les abbayes romanes, mais aussi les burons, les landes de bruyère et les profonds foyers de granit du Cantal. La mère de Jordane se nomme Solange. Elle a grandi aux antipodes, c’est-à-dire à Paris, et l’été près de Tours, dans les allées rêveuses du Jardin de la France ou d’un roman de Boylesve. Elle est la fille d’un pharmacien parisien qui ressemble à Jules Verne et qui a fait fortune grâce à ses laboratoires, ses spécialités paramédicales, sa passion de pionnier pour la publicité. Elle aime les sagas anglo-saxonnes de l’entre-deux-guerres, les chats, les mésanges et les pivoines (mettons). Solange et Henri se sont rencontrés un soir de l’automne 1946 à Baden-Baden, dans les salons illuminés du Kurhaus, le foyer des officiers du Quartier Général des troupes d’occupation en Allemagne. Solange accompagnait son père, venu en personne conseiller aux trois états-majors les nouveaux produits de ses laboratoires. Henri préparait dans l’ombre, sous la direction du père Jean du Rivau, la réconciliation avec un peuple qu’il connaissait bien pour avoir servi, avant guerre, dans l’Armée du Rhin et pour avoir connu, grâce à la Résistance, des Allemands fidèles à la démocratie. Benjamin fut conçu dans l’année qui suivit, précisément à Stein-am-Rhein, lors du voyage de noces de ses parents autour du lac de Constance.
Autre différence à considérer, celle qui distingue les deux pères culturels de Jordane. D’un côté, Pierre-Alain Delancourt, l’auteur de Manuel, de L’Indiscret, de Longs Courriers, de Cavalier seul, l’écrivain qui s’est retiré vingt ans dans le silence des Charmes (sa maison de campagne sur les bords de la Loire) et qui n’a pas publié sans réticences son dernier chef-d’œuvre, une autobiographie romancée curieusement intitulée Mirage des sources. Le jeune Jordane voit en Pierre-Alain un sage détaché des vulgaires vanités de la vie et qui préfère aux lointains illusoires l’inconnu que le cœur pressent dans le plus proche. Idéalisation puérile et dangereuse! En Delancourt, le Jordane de la maturité ne voit plus qu’un membre déférent de la société littéraire la plus policée, et surtout un despote exigeant du disciple, sous peine de disgrâce, qu’il sacrifie sa vie à l’œuvre de son maître. De l’autre côté, Frédéric Lestrade, le directeur de sa thèse à l’École des Hautes Études, un grand théoricien, poéticien et historien de l’art, rigoureux formaliste à l’humour bienveillant, mais aussi fin maître zen dans l’exercice spirituel du contre-transfert, du dépassement des vanités communes et d’une transmission désintéressée de la recherche pure (ou appliquée).
À ces contradictions, qui relèvent de la vie et de la personne mêmes de Jordane, j’en ajouterai ici deux ou trois autres, un peu plus abstraites.
La première concerne les livres qu’il lit et qu’il collectionne. Il apprécie toujours les récits de voyages ou d’explorations de son jeune âge, les mémoires, les journaux intimes et les correspondances; malgré cela, il affirme régulièrement qu’une œuvre n’«acquiert sa vraie nature et toute sa valeur que lorsqu’elle se détache de sa référence et ne dépend plus que de sa cohérence». De même, il se passionne en théoricien pour la recherche littéraire la plus stimulante, Gérard Genette ou Stanley Fish; mais il collectionne en bibliophile les livres illustrés de son enfance et de son adolescence, James M. Barrie, Kenneth Grahame, Rudyard Kipling… et toutes sortes de romans d’aventures, populaires ou raffinés: Paul d’Ivoi, Pierre Mac Orlan, Albert t’Serstevens, Louis Chadourne.
La seconde contradiction concerne les livres que Jordane aime (ou qu’il n’aime pas?) écrire. Il soutient dans son journal qu’il n’écrit jamais pour se souvenir, mais pour oublier: n’est-ce pas un emploi étrange de la trace? La déclaration est plus curieuse encore si l’on connaît un peu sa manie de la conservation, sélective il est vrai. L’écriture, toutefois, ne se réduit peut-être nullement à la trace, effaçable d’ailleurs, qu’elle laisse derrière elle.
La brume s’est levée. Devant moi, dans le parc, Panache l’écureuil descend du plus proche des grands pins parasols, traverse la pelouse en bondissant, sort d’une illustration de Rojankovsky et monte sur le balcon. Mais il ne me voit pas et je n’ai pas le courage de me lever pour aller à la cuisine lui chercher les noix que j’avais rapportées pour lui du jardin de François. Il faudrait aussi que je descende donner du pain aux canards. J’irai tout à l’heure, et me refaire un Darjeeling. Je pense souvent à me servir de la bouteille thermos, mais jamais au bon moment.
Fin du couplet énonciatif. Suite de la vie de Jordane. Je rapporte quelques informations supplémentaires, dans l’espoir de donner un autre tour de clé à ses fictions, publiées ou inédites. Je me laisse emporter par ma mémoire et mon imagination sans consulter mes notes qui dorment dans le placard.
L’enfance protégée. La maison et le jardin d’Étampes. Le père autoritaire mais attentionné, la mère inquiète mais rêveuse, le grand frère affectueux mais comme emmuré dans un monde inaccessible et ne sortant de son mutisme que pour parler aux animaux (il deviendra garagiste, grand amateur de sports hippiques). Les vacances dans la propriété de la famille maternelle, les cousins et les cousines, le petit pavillon à l’âcre odeur de lierre. Je n’aimerais pas développer des clichés si attendus. L’adolescence révoltée. Le vol du revolver dans le coffre du père, le juge des enfants, le collège du Mont-d’Arbois, la fugue dans la neige, le refuge en Touraine chez son oncle hôtelier. Odile Passigny. Le rêve d’une relation vraie, qui réduit au silence, à l’immobilité, et s’inverse à la fin en dissimulation et en simulation. Roger Leroy. La jeunesse dorée. Le retour du fils prodigue, Fontainebleau et la base américaine, les rallyes, la Triumph Herald et les costumes en lin, Phillimore Gardens le long de Holland Park. La gravité longtemps cachée derrière un enjouement de comédie. La dénégation de moins en moins forte de la fascination pour l’art et pour les livres.
Je me souviens maintenant d’un épisode plus amusant. Conversation avec un spectateur d’une trentaine d’années sur les gradins de bois de la patinoire de Villard-de-Lans. Ils remontent ensemble vers le village. L’inconnu propose à l’adolescent des hypothèses sur sa personne et sur sa vie qui témoignent d’une profonde perspicacité. Il cite Edgar Poe, Conan Doyle, Champollion. Il remarque en passant, dans la vitrine d’un marchand de chaussures (Romans n’est pas loin), de belles bottes fourrées. Trois paires sont disposées en triangle, «comme les livres de Bergotte dans la devanture du libraire de la Recherche». Le détective encyclopédique enchaîne des propos inspirés sur les Contes du temps passé de Perrault, l’ascension de l’Arpenteur et On a marché sur la lune. Jordane ne comprend pas très bien mais il pressent, à travers l’intelligence pétillante et la douce assurance de son interlocuteur, l’importance de cette promenade pour sa propre progression. Pour lui, jusqu’alors, les bottes, c’était son père, l’artilleur à cheval, l’ogre de Kaltipa. Enfin l’étrange compagnon très timide et très bavard lui dit qu’il se prénomme Georges et qu’à la montagne comme à la ville «il enquête sur les choses». Il ne fut pas question d’Étampes ni des bords de la Juine.
Autres rencontres importantes? Au lycée, François-Xavier Beaurégent et Philippe Leveneur. Le premier s’est suicidé à 33 ans dans les toilettes de la clinique psychiatrique où il avait été hospitalisé après son arrestation à l’aéroport de Tel Aviv. Il y réclamait une rencontre avec le ministre israélien des Affaires étrangères afin de lui remettre, en échange de son intégration dans une ferme expérimentale de la vallée du Jourdain comme spécialiste des engrais céréaliers, la valeur en pierres précieuses des biens de toute nature volés pendant la guerre aux Juifs de l’Essonne. Il avait découvert «le trésor de la honte» dans le coffre-fort de ses parents, riches exploitants agricoles en Beauce.
Le second élève des chevaux dans le Saumurois et Jordane délaisse régulièrement ses activités au fin fond de l’Auvergne pour passer quelques jours près de son ami dont il a toujours apprécié l’élégance physique, l’indépendance d’esprit, l’intelligence sans détours et la sensibilité sans phrases. Il n’est pas impossible qu’il lui rappelle Henri.
Puis Pierre-Alain Delancourt et Frédéric Lestrade, dont j’ai déjà parlé, Borges (l’œuvre réelle) et Bourbaki (l’auteur virtuel), dont je parlerai une autre fois.
Débuts plutôt réussis en littérature et dans la recherche. Son premier roman, La Galerie des glaces. Son mémoire sur La Vie grave et enjouée de Maurice Sand et surtout sa thèse sur les relations de la science et de la fiction dans l’œuvre excentrique de Raymond Sandé, l’ennemi intime de P.-J. Hetzel. Mais ce qui m’intéresse évidemment le plus, c’est le dérapage de carrière, comme disent mes collègues, à peine dix ans plus tard. Jordane demande son détachement du C.N.R.S. dans un Institut Universitaire de Technologie à Clermont-Ferrand. Cinq ans après, il fait valoir une réorientation de sa recherche vers la didactique et obtient un poste à mi-temps dans l’enseignement secondaire à Aurillac, Cantal. Il s’installe dans la vallée sauvage dont il porte le nom. Dès son intégration officielle, il ne se consacre plus, par écrit, qu’à son courrier et à son journal intime. Mais il se passionne pour les activités du club qu’il a créé et qu’il anime dans son collège: modélisme, philatélie, construction de cerfs-volants d’abord; maquettes ou plans-reliefs, ensuite, d’une planète de fantaisie dont il imagine l’histoire, la géographie, la vie économique, sociale et culturelle avec la participation de ses élèves enthousiasmés. L’un d’entre eux, quelques années plus tard, étudiant à l’École Nationale Supérieure de l’Aéronautique et de l’Espace de Toulouse, consacre à son maître une étude intitulée «Space Opera», alourdie de références à Gilles Deleuze mais agrémentée de souvenirs romanesques. En quelques pages enthousiastes, il montre que ces multiples et singulières inventions ne sont pas, pour Jordane, une régression vers les refuges utopiques de l’enfance: Nouvelle-Palombie, Réaltie ou Volkhanie, mais au contraire une ingénieuse pédagogie d’un monde à venir, qui recycle dans ses productions des «prises de réel» effectuées lors de lectures, de promenades, de visites, d’enquêtes dans les villes et les vallées du «pays vert», le pays perdu et retrouvé, ou au-delà.
Ce goût de Benjamin pour le jeu et pour la jeunesse est peut-être la sublimation ou le dépassement, par renversement des rôles, de sa relation avec son frère aîné.
Je ne peux m’empêcher de trouver une nouvelle contradiction entre la «déterritorialisation» chantée par l’apprenti ingénieur ou le futur astronaute et le retour de son ancien professeur à la terre de ses ancêtres, à la prairie qui borde la rivière homonyme, aux rochers de la rive vernis par le courant, aux racines qui lient les aulnes tourmentés et les eaux limpides. Toutefois, comme nous y invite cette curieuse (et un peu malicieuse) étude sur le dernier Jordane, si l’on s’interroge sur les causes de son «dérapage», il faut se détourner du détachement négatif qui le manifeste, et s’intéresser plutôt à l’intégration active qui lui succède. L’explication par le double deuil qui suit l’«accident» de Pauline et la maladie mortelle de Florence, par la trahison de Jean Boisnel et la brouille avec son «faux frère», par l’évolution de la maladie chronique enfin, est une réduction de sa décision à une réaction presque suicidaire. Il faut voir plutôt, dans cette décision, l’énergique affranchissement de la maturité et la réponse à sa vraie vocation: moins le retrait d’un monde que l’avancée dans un autre, ou dans la création d’un autre, le nôtre.
Dois-je affirmer que cette dernière période est plus vraie que les précédentes? L’est-elle? Elle m’est moins antipathique, en tout cas, que la plupart des épisodes antérieurs. Comme on l’a compris, ce personnage et son parcours me sont un peu redevables. Je m’en veux parfois d’un tel «vol de vie». Je comprends ceux qui sont privés par la malchance du pouvoir d’expression, qui servent malgré eux de modèles à un écrivain, et qui intentent un procès au prétentieux prédateur convaincu de changer la boue des faits réels en l’or de ses fictions (ou plus modestement, ou plus habilement, de découvrir au cœur de la vie minuscule les grandeurs qu’elle recèle). Le respect du proche ne l’emportera-t-il jamais, pour un petit maître du symbolique, sur l’appel du lointain, ou plutôt sur l’amour de son œuvre? Je me fais à moi-même ce procès pour atteinte à ma vie privée. Mais y a-t-il atteinte, puisque le plus intime est précisément l’incapacité de me présenter ou de me raconter sans devenir un autre?
Cependant pour ma part, je me suis marié, ce que Benjamin n’aurait jamais pu faire. «Pourquoi un homme se marierait-il quand il peut faire tournoyer un sabre d’abordage ou chercher un trésor caché?» demandaient James et Barrie. Mais Kafka leur répond: «Le mariage fournit assurément la garantie de l’indépendance et de la plus grande libération de soi-même», et il nous faut entendre: par rapport à nos parents, et plus mystérieusement, ou plus simplement: par rapport à «soi-même».
Je sais bien qu’il n’est pas nécessaire d’avoir des enfants pour donner la vie, pourtant je regrette que nous n’en ayons pas. C’était un pas de plus vers la normalité. Ma vie est moins une tentative de sortie hors de la sphère paternelle qu’un combat (presque) sans fin pour devenir comme les autres. En revanche, contrairement à Jordane, je n’ai jamais quitté la ville où j’ai grandi, sinon pour Olivet, ici même, au Clos, à cinq kilomètres de la maison familiale où j’ai passé mon enfance et mon adolescence, à cinq minutes de la fac où j’enseigne avec joie depuis plus de dix ans et où Agnès est ma collègue.
J’aurais dû noter plus tôt qu’une seule fois dans son Journal, à ma connaissance, Jordane envisage d’écrire sous un pseudonyme, Vincent Vallières. Ce serait, dit-il, pour raconter publiquement un court séjour qu’il fit lorsqu’il avait 15 ou 16 ans, à Londres, chez une amie de sa mère, Régine A., âgée de 35 ans, directrice des ventes dans un luxueux magasin d’articles et vêtements de sport. Par discrétion, et probablement aussi par goût des noms propres significatifs, il situerait cet épisode à Ixelles près de Bruxelles. Il se remémore dans ses moindres détails cette première rencontre avec l’autre sexe. Le contenu de cette aventure me semble trop intime pour que je le rapporte ici. J’ai écarté plus haut, pour les mêmes raisons, l’évocation de la vie sentimentale et sexuelle de mon personnage: Florence Maluynes, Pauline de Réalcan, Valérie Desvosges. Je précise simplement que le fragment «Ixelles» remet en question les analyses psychologiques de Prager concluant à une homosexualité secrète et sublimée de Jordane (à moins qu’il n’ait effectivement trouvé dans la fermeté suave de sa séductrice un modèle identificatoire plus puissant que celui du père ou de ses suppléants). N’est-on pas en effet tenté d’y substituer d’éventuelles recherches du côté du sadomasochisme, fort sensible d’ailleurs dès Toute ressemblance…, ou du voyeurisme, ou du fétichisme? Cette dernière perversion, on le sait, évite l’affrontement de la différence primordiale mais tout en la déniant elle ne refuse pas l’accès à l’autre sexe – que Jordane a aimé.
En définitive, Jordane n’a rien raconté publiquement, sous un pseudonyme, de l’aventure ci-dessus, somme toute assez commune. Il préférait transposer en conservant son nom que dévoiler sous celui d’un autre: presque le contraire de ce que je fais ici.
Midi. Le facteur doit être passé. Par quel miracle le téléphone n’a-t-il pas sonné ce matin, quatre ou cinq fois par souci de ne pas insister, c’est-à-dire juste assez pour déranger, mais pas assez pour laisser le temps d’aller répondre? Le temps s’est écoulé et je ne suis pas descendu au garage à bateaux pour nourrir les canards, ni même retourné me faire une tasse de thé. Jordane et la publication. Tantôt je pensais faire de lui l’auteur d’une œuvre posthume dont j’aurais été l’éditeur, moi, ou un collègue imaginaire, par exemple Stefan Prager. Tantôt au contraire, je pensais faire de lui l’auteur d’une œuvre promue et reconnue de son vivant. C’est toute la différence entre être publié (par des tiers et malgré soi: rêverie romantique ou valéryenne de la toute-puissance) et publier (se soumettre pour dominer: réalisme de l’homme de lettres comme de tout homme de pouvoir). Quoi qu’il en soit, Jordane est l’auteur supposé d’une douzaine de titres: des romans estimés, Fumées sans feu, La Galerie des glaces, Par quatre chemins, Déviation sentimentale, Hollande bel envoi, L’Inimitable, Le Deuil du biographe, et plusieurs essais trop spécialisés, dont une importante étude sur Raymond Sandé, l’auteur de Monsieur Martineau et les Éternels, le maître méconnu de Jules Verne, d’André Laurie et de Raymond Roussel. Je n’oublie pas Ma tasse de thé, recueil d’articles consacrés à ses formes ou thèmes de prédilection plutôt qu’à ses auteurs préférés. Tout de même, très présents: Kipling mais aussi Kierkegaard, Kafka, Klossowski ou, pour le cinéma, le Lang hollywoodien, Mankiewicz, Naruse, Preminger, tous réalisateurs de films de fantômes, et plus proche de nous, Alain Cavalier.
Je n’en dis pas plus sur les ouvrages ci-dessus, suffisamment évoqués dans L’Apprentissage du roman et Toute ressemblance… Je passe rapidement sur les Fonds de miroirs, qui sont ses Idées et germes de nouvelles et où figurent les résumés de plusieurs dizaines d’histoires projetées, notamment le dernier chapitre de Toute ressemblance…, histoire d’une jeune fille du meilleur monde qui devient call-girl rue Mornay à Paris et qui veut venger sa mère suicidée en punissant un narrateur presque coupable. Mais je tiens à mentionner, parmi quelques autres inédits, la réécriture d’«Aux armes de Réaltie» du point de vue du petit garçon devenu grand.
Je n’ai pas encore abordé la question de savoir quel aurait été, dans Présence de Jordane, le statut de ma relation avec mon pseudo-écrivain. L’aurais-je connu? Dans mon premier livre, je dis que oui: à la Chambre de commerce d’Orléans. Mais ensuite? Je n’y ai pas vraiment réfléchi. Ai-je été son collègue au collège, à l’époque où il prétendait que l’enseignement était une activité infiniment plus noble que la littérature? Suis-je allé le voir en Haute-Auvergne, par exemple, chez lui, dans sa belle maison de granit, près de Saint-Simon, au bord de la Jordanne? Il est plus que l’heure d’aller à la cuisine pour y déjeuner seul en écoutant de la musique. Aujourd’hui Charles Ives ou Benjamin Britten, en hommage à mon hétéronyme auquel ils ressemblent, chacun à sa manière. Je verrai mon courrier par la même occasion.
Je reviens au dossier Jordane. J’y avais réuni trois catégories de textes: des fictions «inédites» de l’écrivain, des témoignages de ses proches sur l’auteur et sur l’homme, des essais sur son œuvre littéraire ou intime, attribués à des critiques fictifs. Le «Cahier» se serait achevé sur une bibliographie scientifique des écrits de et sur l’écrivain.
Je voulais présenter, en l’état, le dossier préparatoire de son roman inédit, Province profonde, et les deux premiers chapitres rédigés: «Le Manège», «Un beau parleur». J’aurais indiqué notamment que le scénario de l’ensemble avait été publié par Stefan Prager, sous le titre d’«Ami du prévenu», dans Toute ressemblance…, j’aurais proposé une ligne de démarcation entre la réalité et la fiction, puis j’aurais suggéré que cette différence, comme les passerelles tendues entre ces deux domaines également autobiographiques en vérité, avait moins d’importance, de mon point de vue peu formaliste, que la morale de son histoire.
J’ai déjà parlé des souvenirs hagiographiques d’un ancien élève du collège Saint-Gerbert, «Space Opera». Le plus long des autres témoignages, «Une île en France», était signé par le meilleur ami de Jordane, un double de Jacky alias Abdel Kourath, le bon tyran de Libanie. Il est resté inachevé. C’est une sorte de confession dont le narrateur se sert pour se cacher que Benjamin l’aimait, ou inversement.
Des études consacrées à l’œuvre de Jordane, deux ont été publiées en revue: la première concerne sa correspondance, pendant vingt ans, avec Pierre-Alain Delancourt; la deuxième concerne l’une de ses nouvelles, «Frère-des-Loups» (je la republierai peut-être en guise de conclusion au présent recueil dont elle constituerait une sorte de mode d’emploi). Il en existe beaucoup d’autres. La plus longue est une tentative de périodisation de son activité littéraire en fonction de trois grandes oppositions successives sensibles dans ses publications: d’abord entre silence et langage; puis à l’intérieur du langage, entre l’écriture pour soi (ou un proche), à «exemplaire unique», dit-il, et l’écriture «multipliée», pour un public plus ou moins indéterminé; enfin, à l’intérieur de cette écriture proprement littéraire, entre celle qui stylise ou imite jusqu’à la confusion la parole intime et celle qui se conforme aux lois des genres institués. Le tout est suivi de réfutations des oppositions, et c’est aussi aride que ce paragraphe. Les autres études sont heureusement plus courtes mais malheureusement trop denses. Bien sûr, il ne serait pas difficile de les présenter comme des extraits d’essais, des traductions par exemple, dans une bibliographie raisonnée.
En fait, ce projet envisageait une nouvelle performance dans le genre que j’ai étudié autrefois, non sans plaisir, sous la direction de Gérard Genette: la supposition d’auteur. Peu après la publication de mon premier livre, La Bibliothèque d’un amateur, j’avais découvert que mes résumés et commentaires de récits inexistants s’inscrivaient dans cette longue tradition dont je ne savais presque rien et dont je voulais connaître quelques caractéristiques thématiques et, surtout, formelles.
Bien distinguer pseudonyme et hétéronyme. Dans le second cas, on le sait, il ne s’agit pas seulement de changer de nom, même si pour certains le nom à lui seul engendre un personnage, mais de donner à un double son véritable volume, son épaisseur propre dans les domaines physique, psychologique, biographique, bibliographique, et même stylistique.
Là encore, Valery Larbaud. Mais aussi Pessoa bien sûr, Borges et Nabokov, des auteurs plus secrets auxquels je suis resté plus attaché, comme Fernand Fleuret. Le Nerval d’Angélique et de Perceforest, Nodier, Mérimée, Schwob, France et le Flâneur des deux rives, accompagné de son mystérieux ami l’amateur de bibliothèques publiques lointaines ou endormies, lecteur de Dumas père dans le wagon-promenoir du Transsibérien, ou en compagnie d’Edmond Guénoud, rédacteur facétieux d’un catalogue de livres qui n’existent pas. L’érudition fabuleuse et l’imagination savante. Toute une bibliothèque de livres qui évoquent des livres et des bibliothèques imaginaires. Pastiches de styles, pastiches de genres, postiches, imitations de la réalité seconde (ou première au contraire, fondatrice et programmatique), celle des livres et des auteurs. On connaît à ce propos les travaux de Jean-François Jeandillou. Connaît-on ceux de Jean Wirtz, tout aussi inventif et méticuleux? L’essai de Sylvain Jouty, «Modeste proposition pour achever la littérature», atteint dans le même domaine des sommets de malice et d’érudition. L’anthologie de Jacques Geoffroy, Mille et un livres imaginaires, devrait figurer sur les rayons de tous les amateurs du genre. La valeur esthétique de la biographie est l’un des thèmes récurrents de l’œuvre de Patrick Mauriès. Hélas, désormais, ce sujet n’est plus aussi original. À quand le retour au Texte? Nous y sommes, en fait, depuis qu’à la vraie vie vécue on a substitué la vie racontée ou représentée: le «biographique».
Mais peu importe. Pour moi, inventeur de Jordane, de son œuvre et de son commentaire, le procédé était une sorte d’équivalent littéraire de mon impression que ma vie est un roman réaliste dont je suis l’un des lecteurs les moins avertis. Je m’observais comme si je n’étais qu’un personnage embryonnaire dans les brouillons d’un inconnu. J’essayais de comprendre ce qui était écrit, ce qui arrivait ou n’arrivait pas, pourquoi le principal protagoniste faisait ceci et disait cela, quelles étaient les intentions de l’auteur, qui était cet auteur, etc.
La création d’un auteur supposé était aussi, comme me l’ont bien expliqué Dominique et Jan, une «formation de compromis»: le moyen de résoudre fictivement la pénible contradiction entre le désir de me faire entendre et celui de ne dépendre de personne (ni du langage). Afin de publier sous mon nom tout en préservant le désir de griffonner pour moi seul et de ne pas me faire remarquer comme écrivain, il fallait faire de mes textes les affabulations d’un psychopathe, le journal d’un misanthrope, les ratures et la littérature d’un ennemi du verbe dont je ne serais que l’éditeur posthume et scientifique.
Adjonction en recopiant. À l’origine, je ne pensais pas que Jordane incarnerait la contradiction entre le créateur et le critique. Je pensais même, au contraire, qu’il représenterait uniquement le créateur et que je garderais le rôle du critique. Je voulais attribuer à Jordane mon goût pour le récit et pour ses images, et rester dans mon rôle d’analyste, de médiateur, d’universitaire. Mais progressivement les deux moyens d’une même recherche – d’une même recherche – sont pour ainsi dire passés de son côté. Je l’ai doté de ces deux passions souvent opposées, à tort ou à raison, l’imagination et la réflexion. Les origines de mes parents, mes parentés culturelles, ma bibliothèque, diverses périodes de mon existence sont devenues les siennes, avec leurs contrastes les plus invraisemblables. Je me serais entièrement confondu avec lui, s’il ne s’était détaché de moi lorsqu’il a été question de mariage et de carrière universitaire, deux engagements qu’il ne pouvait prendre ni tenir. À ce moment, il est redevenu le personnage solitaire et secret que je voyais en lui avant de le rendre public et nous nous sommes distingués l’un de l’autre. Dans le même mouvement est apparu Prager, Stefan Prager, figure de l’exégète que j’étais jusque-là. Stefan et Benjamin sont devenus dès lors les deux figures plus ou moins réversibles de l’auteur et du lecteur et je me suis enfin éloigné de leur couple pour m’occuper du mien.
Je dois cependant confesser ceci: Avoir recours à un auteur supposé détournait l’attention de ce qui m’importait vraiment, non pas Qui parle? mais Que dit-il? Si je voulais faire diversion, j’ai réussi! J’étais même agacé que les comptes rendus de mes livres s’attachent davantage à leurs jeux onomastiques, textuels, péritextuels et-ou paratextuels (je cite) qu’aux enjeux de leur contenu, ou si l’on préfère, mais c’est la même chose, à la signification de leur forme.
Je ne terminerai pas sans dire un mot de mes recherches universitaires sur «l’auteur comme œuvre», dont la thèse principale est qu’un auteur n’est pas antérieur ni extérieur à ses écrits, mais qu’il en est la création, comme il est aussi, voire surtout, la créature de médiateurs spécialisés, journalistes et reporters, témoins, biographes, etc. Le biographique, qui est la vie représentée du personnage plus que la vie réelle de la personne, ne se trouverait pas en amont mais en aval de l’œuvre. Eh bien Jordane vérifie l’hypothèse, puisqu’il prend sa source, si je puis dire, au flanc de ma première fiction et qu’il en découle naturellement.
J’avais été averti de ce phénomène à la fin de mon adolescence en apprenant dans le journal Tintin que Karl May, Grey Owl et Emilio Salgari s’étaient construit, au fil de leurs rencontres avec leurs petits lecteurs crédules, des vies légendaires inspirées de leurs propres récits d’aventures, de chasses ou de voyages, et non l’inverse.
J’ai réalisé autrefois, avec mon ami Claude, des photographies de «B. J.», de ses proches, de son théâtre Pollock’s en carton rapporté de Londres en 1967, des petits personnages et décors que Benjamin avait peints pour lui et quelques enfants de tous âges, ainsi que des lieux qui lui furent chers. C’était très amusant. À la même époque, je pensais à réunir divers documents: manuscrits, lettres (les brouillons des siennes, passionnants à comparer avec les lettres envoyées, et surtout évidemment celles de ses lecteurs), journaux, albums, dessins, collages, objets de prédilection souvent emblématiques. Je voulais m’attacher à l’évocation de ses collections de jouets anciens, de Dinky Toys et de soldats de plomb. Les soldats de plomb! Topos incontournable dans certains champs littéraires: Larbaud, Mac Orlan une fois de plus… Incontournable mais un peu ridicule, même chez de merveilleux «aventuriers passifs». Pourtant, je ne résiste pas à la tentation d’évoquer certaines pièces que le père de Jordane conservait religieusement pour les transmettre un jour à son fils préféré. Dès 1947, à Baden-Baden, par la voie des petites annonces du Badische Tagblatt, Henri avait été l’acquéreur de magnifiques séries allemandes, dont les fameuses figurines créées par Heyde, à Dresde, qui évoquent les indiens du Far West et les trafiquants du Moyen-Orient des romans de Karl May. Il affectionnait aussi tout particulièrement, bien sûr, les coffrets des maisons Lucotte et C.B.G. (Cuperly, Blondel, Gerbeau) qui lui permettaient de donner du relief et de nobles couleurs à ses leçons d’histoire. Le plaisir du pouvoir que les pauvres recherchent dans la carrière des arts, des armes ou des lois, Jordane l’a trouvé en sortant de leurs boîtes venues de Curzon Street ses Punjab Frontier Force 1880 et ses Bengal Lancers de 1901. Je ne résiste pas au plaisir de donner aussi les références d’un petit livre de H. G. Wells: Floor Games, with marginal drawings by J. M. Sinclair, qui intéressera certaines personnes singulières, obscures et passionnées. Dernière coquetterie: le «Stevenson at Play: War Games Correspondence» a été traduit en français dans le bel hommage de L’Herne à Stevenson, sous le titre de «Stevenson s’amuse». Je rêvais aussi de produire les juvenilia de Jordane, notamment le dossier des pays inventés dans son enfance: Nouvelle-Palombie, Margerie, Sylvanie, Réaltie, Volkhanie, et celui des pièces écrites pour son petit théâtre, toutes inspirées de ses premières lectures: Le Ravissant Ravisseur, Le Maître de Moonfleet, Le Prince de cire, Le Mariage d’Alice et de Peter Pan.
J’imagine la vente de ces reliques d’un autre âge dans une salle peu fréquentée de Drouot, ou plutôt en province, dans un vieil hôtel d’Orléans ou de Blois, de Tours ou de Chinon… J’imagine de même un catalogue, ses énumérations et ses descriptions. Le voici! Un amateur vient voir l’exposition présentée dans de vieilles vitrines bien encaustiquées. Il fait des efforts pour ne pas manifester son émotion et sa convoitise. Mais le lendemain, pendant la vacation, un inconnu lui souffle par téléphone les lots qu’il désirait. À la fin notre ami va voir Maître Mignot. Le commissaire-priseur lui murmure le nom de l’invisible interlocuteur. Stupéfaction. Je est un autre. Il est le même. Une histoire de fantôme commence ou recommence. Je l’ai déjà racontée.
Maintenant, je ne sais si c’est provisoirement ou définitivement que je renonce à mon projet, Présence de Jordane. En tout cas je renonce. Je ne tiens plus à développer la construction de l’auteur supposé dont je me suis un peu détaché, même si je suis toujours ému lorsque nous remontons d’Aurillac vers Saint-Simon, Agnès et moi. Je me console en pensant que la réalisation d’un tel projet m’obligerait de décider si Jordane est encore en vie, ou s’il est mort et enterré; tandis qu’en laissant tout en plan, surtout sa biographie, je n’ai pas à trancher.
Restent quelques nouvelles que je lui avais attribuées et que je tiens toujours à publier. Je les livre en l’état dans les pages qui suivent. L’ensemble n’a pas plus d’unité qu’un recueil de posthumes dans un Tombeau trop indulgent. Cela m’est égal. La nuit est venue. C’est l’heure du thé. Agnès va rentrer. Demain je reviendrai sur ces pages écrites en prenant le parti un peu artificiel de l’improvisation. Je reviendrai sur la présentation de mon personnage et peut-être même sur tout ce qui concerne la journée d’aujourd’hui.
Jean-Benoît Puech
28 janvier 2001