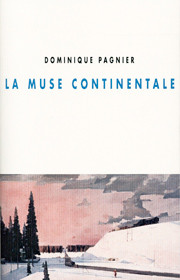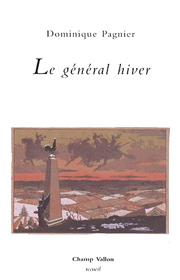La diane prussienne (roman)
Extrait
(pp. 7-18)
I
L’Allemagne dormait depuis si longtemps qu’elle avait oublié son nom pour devenir son propre rêve. Un rêve d’or où parfois jouait une lumière diaprée comme celle d’un jour hésitant sous les paupières d’un enfant qui a de la peine à se réveiller à cause de la douceur et la beauté de son sommeil. C’est au milieu de ce rêve que Christiane Räntz naquît le 21 décembre 1778 à Limbourg-sur-la-Lahn, duché de Nassau, alors que le petit matin avait des lueurs bleuâtres. Son père Karl Theodor Räntz, ancien intendant des spectacles d’un prince de Solms-Braunfels, était penché au-dessus d’elle dans la chambre maternelle d’une grosse maison historiée et sise sur le Pfarrweg, au pied d’une cathédrale rouge et blanche à sept tours habituellement visible par la fenêtre. Mais à cette heure les carreaux embués de la chambre ne laissaient passer qu’une lumière vacillante qui s’accordait bien à l’apparition de cette enfant. Une chandelle était posée sur un guéridon près du berceau à baldaquin entre les voiles duquel le père découvrait son enfant, et il s’enchantait de cet art lumineux qu’il avait déjà recherché sur bien des théâtres d’Europe. Le bébé Christiane avait un côté de son visage doré par la clarté de la flamme et l’autre bleui par la clarté du matin. Déjà le jour augmentait; pour prolonger cet effet particulier, Karl Theodor rapprocha la chandelle du berceau. Le baldaquin prit feu et, avant que l’imprudent eût pu se saisir de son enfant, un lambeau d’étoffe enflammée se détacha sur elle. Occupée à quelques pas de là aux soins de l’accouchée, la sage-femme se précipita sur le berceau, en arracha le nouveau-né et le plongea dans un baquet réservé à la toilette pour l’en ressortir heureusement indemne.
De tels événements, on serait enclin à tirer quelque signification à la fois symbolique et merveilleuse. Dans la Vie légendaire de Christiane Räntz dite la Diane prussienne, livre qu’il composa presque cent ans plus tard pour honorer la mémoire de la secrète enchanteresse de son enfance, et dont est en grande part inspiré tout ce qui va suivre, Wendelin Hohl, fils de l’imprimeur Wilhelm Hohl de Francfort-sur-le-Main, n’hésita pas à interpréter les circonstances de cette naissance comme les signes d’une élection divine. Mais c’est bien toute la vie de Christiane que, par cet ouvrage, il s’efforça d’envelopper d’une atmosphère merveilleuse, ce dont on ne saurait vraiment lui faire grief tant il y mit de cœur et parce que son héroïne l’a bien mérité aux yeux de la postérité.
*
L’Allemagne dormait. Comme un haut vieux meuble d’enfance. À la naissance de Christiane, ce n’était plus que le bahut vermoulu du Saint Empire, branlant de tous ses ais et chevilles, 1225 territoires allant du simple domaine d’une abbaye jusqu’au royaume, en passant par les villes libres, évêchés, landgraviats, prévôtés, bailliages, margraviats, duchés, principautés médiates et immédiates. Peu de temps avant cette naissance, Karl Theodor Räntz, qui, en rêveur maladroit, ne manquait pas de fantaisie, avait représenté ce phénomène politique dans une comédie pour son prince. À cet effet, il avait fabriqué une machine théâtrale composée d’un carrosse attelé de chevaux jupons et d’une toile de fond peinte d’un paysage et défilant horizontalement au moyen d’un mécanisme de son invention. Derrière l’attelage agité des soubresauts du voyage, le paysage se mouvait, mais c’étaient toujours les mêmes éléments qui revenaient: un poteau-frontière armorié, une campagne idyllique plantée de tilleuls, une ville bastionnée, une abbaye au clair de lune dans la verdure, un donjon piqué sur une colline, un palais inachevé de style composite. Le prince de Solms-Braunfels y vit qu’on se moquait de l’exiguïté de son domaine et de son Versailles inachevé depuis trois générations, dont la dépense grevait sa liste civile, l’endettait et faisait de lui la risée de la noblesse locale. Considérant cette facétie scénographique comme une irrévérence à l’égard de Son Excellence et de ses ancêtres, il licencia son intendant, l’épouse de celui-ci, la comédienne Sarah Atkinson, ainsi que le reste de sa troupe, et se félicita secrètement d’avoir trouvé là une raison de mettre un terme à l’une de ses entreprises les plus ruineuses. Les acteurs mâles n’eurent guère d’autre recours que de s’engager dans son beau régiment qu’il faisait manœuvrer tous les matins sur le boulingrin de sa résidence en attente d’un toit depuis plus de cinquante ans. Räntz, désormais sans revenu, s’établit avec sa femme enceinte à Limbourg, chez un de ses frères en maçonnerie, le pasteur Friedrich La Tierce, huguenot hospitalier et affable qui vit moins dans cette affaire un arrêt du Ciel condamnant la frivolité des spectacles qu’un effet de l’arbitraire des princes.
*
Christiane fut baptisée dans les heures qui suivirent sa naissance, non que l’on craignît pour ses jours – le pasteur était un homme éclairé qui ne croyait pas plus à la faute originelle qu’aux limbes et à l’enfer – mais parce que les parents devaient partir rapidement pour Hambourg. Ayant procédé aux rites, le bon La Tierce inscrivit donc sur le registre paroissial le prénom de Christiane, que Räntz avait donné à la petite pour honorer Christian Körner de Dresde, maçon lui aussi et un de ses plus fidèles protecteurs, puis ceux de Charlotte et Augusta portés par des princesses de Hesse. Le baptême était à peine célébré que, sans attendre le terme des relevailles, le couple Räntz fila par la première poste à Hambourg dans l’espoir d’un engagement au Théâtre national dont la réputation était immense.
*
Christiane ne connut pas sa mère. Trois mois après son départ de Limbourg, celle-ci mourut accidentellement au cours d’une représentation d’Iphigénie en Aulide de Gluck au théâtre de Wolfenbüttel où elle venait d’être engagée. Descendant des cintres, le char nuageux dans lequel elle apparaissait sous la figure d’Artémis se rompit et la déesse chut d’une hauteur de dix-huit pieds devant un public saisi de terreur. Dans la lettre que Karl Theodor adressa au pasteur La Tierce pour lui narrer cet événement, il lui manda également qu’il était sur le point de s’embarquer sur un brick de la Compagnie hollandaise des Indes occidentales à destination de Halifax où il comptait rejoindre un entrepreneur de théâtre.
Il n’est resté qu’un seul portrait de Sarah Atkinson; il est conservé avec les journaux, papiers et menus objets de Christiane dans un musée privé que, reprenant le culte de Wendelin Hohl, l’un de ses descendants a consacré à l’héroïne de son aïeul. C’est un médaillon où la comédienne se montre justement sous les traits d’Artémis dont elle avait joué le rôle dans plusieurs théâtres d’Allemagne. Christiane, qui n’apprit le détail de cette mort que quatorze ans plus tard, n’eut pas d’autre image de celle qui lui donna le jour ce 21 décembre où elle se révéla au monde comme un blason mi-parti d’or et d’azur.
*
Le même musée présente, suspendue juste au-dessus d’un groupe de bronze pour lequel Christiane posa elle-même en Artémis à l’âge de seize ans, une silhouette découpée et insérée dans un médaillon d’ébène montrant le pasteur La Tierce. Il porte catogan, veste à basques, culotte et bas et tient l’index levé d’un geste doctoral. Le profil est d’une majesté jupitérienne, marqué cependant d’une vague rusticité. Il convient d’insister sur sa personne; Hohl doit quelques relations de l’enfance de Christiane à ses lettres rédigées dans ce français qu’il tenait de ses aïeux et qui perdura longtemps du côté de Bad Karlshafen où le prince Charles de Hesse les avait reçus avec beaucoup d’autres bannis. Les écrits du pasteur ne laissent d’indiquer un homme doux et bénin. Hohl le présente comme un être possédant le génie du cœur. De fait le pasteur fut connu à Limbourg pour des prédications capables de révéler à l’entendement le plus obtus les lumières du Ciel et au cœur le plus endurci les douceurs de la Charité. Incarnation parfaite de ces ministres qui ne voulaient plus reconnaître Dieu qu’en un Grand Être figuré sur des lambris par un œil au centre d’un triangle dispensant par ses rayons amour et raison, le pasteur La Tierce compta parmi ces hommes inspirés qui furent à cette époque, en Europe, les hérauts d’une nouvelle espérance pour l’humanité. Comme bien d’autres de cette fin de siècle partagée entre mysticisme et positivisme, il trouvait autant d’intérêt aux élucubrations filandreuses de Swedenborg qu’aux arides spéculations de Kant, et rêvait qu’on pût concilier la Raison et les mystères des religions.
Il entretenait aussi des correspondances avec diverses sociétés savantes d’Europe, notamment une de Königsberg dont le secrétaire, le recteur Fürchtegott Jakob Fleming, personnage amène lié à Kant, lui vouait des sentiments fraternels et lui envoyait toutes sortes de curiosités locales: des fleurs comme le gaillet boréal, des substances merveilleuses telles que l’ambre, des insectes comme des essaims d’abeilles pourpres prétendus sauvés des glaces. Il faut également s’arrêter un instant sur la figure du recteur car ce célibataire ingénu, qui consultait La Tierce sur des sujets de botanique et, depuis des années, sillonnait l’Allemagne à la recherche de Malva sanguinea hybernica, fleur mythique réputée ne pousser que sous les dragons terrassés, serait un jour le dernier recours de Christiane dans un monde en catastrophe.
Pour revenir au pasteur, notons encore, car Hohl insiste sur ces traits, qu’il se consacrait à diverses sciences dans son cabinet de physique, y passant des heures à rectifier des corps chimiques aux odeurs âcres, à soumettre des lapins innocents aux effets du vide sous une cloche pneumatique, à apprendre le grec à un mainate ou encore à composer un herbier auquel il allait bientôt employer le zèle de Christiane. Deux fois par mois, il se rendait aussi en loge «à la Sagesse triomphante» dont il était surveillant. Aux trémolos d’un positif à pied, on y faisait la chaîne fraternelle pour chanter la gloire du Grand Architecte de l’Univers, en attendant l’avènement d’un nouvel âge d’or.
*
La venue de Christiane bouleversa La Tierce. Dans la façon qu’elle avait eue dès sa naissance de passer par l’eau et le feu, il reconnut une destinée remarquable; il se prit d’une affection infinie pour elle. Dès lors il se préoccupa de systèmes d’éducation et on le vit étudier l’émile de Rousseau, consulter Lavater et Pestalozzi, ces Suisses hygiénistes au beau teint hâlé qui pensaient que toute enfance est une question d’atmosphère. Il n’eut d’autre souci que de faire s’épanouir en Christiane des fleurs de vertu et de science. «Affranchis-toi des liens terrestres, petite étincelle divine!» s’exclama-t-il en arrachant les langes dans lesquels la nourrice avait emmailloté Christiane âgée de six mois. Plus tard, dès qu’elle sut parler, il la mit à genoux au pied du triangle frappé du tétragramme divin dont était orné le fronton de sa bibliothèque, et lui dit: «Honore le Grand Être dans le sein duquel l’âme de ta chère mère s’en est retournée!»
«Tout est bien sortant des mains de l’Auteur des choses, tout dégénère entre les mains de l’homme.» Cette assertion de Rousseau que le pasteur, pourtant bien disposé envers ses semblables, ne manquait pas de se répéter intérieurement à propos de sa pupille, l’amena à tenir celle-ci à l’écart du monde jusqu’à l’âge de raison, âge auquel elle, qui pratiquait assez bien le français et le latin, commença seulement à apprendre l’allemand, ou plutôt le dialecte hessois qu’elle utiliserait parfois pour tenir ses journaux et écrire des poèmes. Assez longtemps, les gens de Limbourg n’eurent qu’une vague idée de l’existence d’un enfant chez le couple La Tierce. Ainsi Christiane grandit-elle à l’abri du voisinage comme ces fleurs sans humus que celui qu’elle appelait «mon oncle» faisait croître des seuls aliments subtils de l’air sous une cloche de verre de son cabinet. C’est justement en cet endroit de la maison que, à l’occasion d’une lettre au recteur Fleming, le pasteur en donne l’un des premiers portraits repris dans la Vie légendaire. Elle vient d’avoir quatre ans et il fait tourner devant elle la machine de Wimshurst, mécanique à roues dont le mouvement provoqué par une manivelle dégage une énergie qui se matérialise sous la forme d’un arc électrique passant entre deux sphères. «J’ai pu considérer, note-t-il, la double image des éclairs dans les yeux candides de Christiane et mon cœur a été rempli d’une exaltation profonde en voyant une si belle innocence s’offrir au principe le plus noble du monde physique. Lorsque j’ai demandé à la chère enfant quelle pensée ce phénomène éveillait en elle, celle-ci m’a répondu: «Suum cuique! Je pense qu’à cette heure ma bonne tante Adélaïde, votre épouse, est à filer la laine près du poêle et que du même mouvement dont elle démêle l’écheveau vous tirez, vous mon oncle, un fil merveilleux dont j’aimerais qu’un jour l’une de mes toilettes fût tissue.»
Une autre lettre relate une expérience dont La Tierce avait trouvé la procédure dans les Mémoires de la Société royale de Berlin et qu’il exécuta sous les yeux de Christiane âgée de cinq ans: «Un peu de mercure jeté dans une solution d’argent par l’esprit de sel ammoniac a procuré une végétation en attirant l’argent et en le divisant en très peu de temps dans des rameaux et des feuillages qui représentent un arbre chimique. La chère petite a observé ce phénomène avec le plus grand intérêt, un sérieux que je n’ai pas trouvé chez les Frères de «La Sagesse Triomphante» lorsque, le même soir, j’ai renouvelé l’expérience devant eux et que le trésorier Kern a déclaré qu’on pourrait en tirer pour notre caisse un argent plus pur que celui de la minette. Christiane donc observait la croissance de l’arbre avec émerveillement et sérieux et elle m’a dit: «Mon oncle je m’y retrouve comme dans le grand miroir au-dessus de la console du vestibule!» Il est vrai qu’il y avait dans l’éclat lunaire et la fragilité de cette végétation quelque chose de la pâleur de la frêle enfant. «Cela s’appelle l’arbre de Diane!» ai-je expliqué, sur quoi le mainate a répété ces noms très mystérieusement associés: «Christ-Diane.»
*
À l’âge de sept ans, Christiane entra à la manécanterie de Kaspar Finck, régent de chœur à la cathédrale Saint-Georges de Limbourg. Quelle raison put amener La Tierce, si soucieux de l’éducation de sa protégée, à la confier à cet ancien militaire ayant perdu une jambe à la bataille de Leuthen et dont la réputation d’ivrogne et les extravagances défrayaient les conversations de la ville? À la lumière d’événements ultérieurs, on peut penser que Karl Theodor Räntz avait laissé des consignes visant à faire apprendre le chant à Christiane pour qu’elle suivît l’exemple de sa mère. La Tierce, de son côté, ne devait pas ignorer que le talent du régent, formé auprès d’un maître napolitain, était sans égal à Limbourg; quant à ce qu’on disait de la conduite du personnage, il l’ignora, convaincu qu’au génie musical faisait pendant une âme irréprochable.
Conformément à l’usage du temps, Finck n’avait pour élèves que des garçons. Il fallut travestir Christiane pour qu’il l’acceptât; on lui coupa ses beaux cheveux qu’elle avait blond fumé, elle passa un petit habit de ratine noire à basques, une culotte de drap et des bas blancs. Elle fut inscrite sous le nom de Christian Räntz (en allemand la prononciation du prénom ne change guère). Une telle circonstance peut de nos jours paraître pour le moins romanesque; elle n’était pas si rare à cette époque. Encore quelques années et l’on verra Christiane entrer dans une sorte d’ordre secret, mystérieux d’anges ambigus dont l’Allemagne en ce tournant de siècle était le territoire d’élection. Maintenant il faut se représenter le régent, un colosse qui n’avait pas son pareil pour faire courir sa jambe de bois sur les pédales de l’orgue, filer prestement avec une seule béquille à un estaminet voisin pour s’y imprégner de schnaps et reprendre incontinent le clavier, fondre comme un châtiment divin sur tel dissipé de sa classe et lui assener de la même béquille des coups dignes de la Dressur prussienne, verser une larme aux accents séraphiques des garçons et enfin clamer sous le coup de l’exaltation et de la boisson: «Lève-moi! Lève moi!» à l’hilarité de ses élèves. Parfois un peu gris, il lui arrivait de faire des chutes dans l’escalier de la tribune en lançant des imprécations qui faisaient trembler les saints des vitraux dans leur sertissage de plomb. Il arrivait aussi qu’on le retrouvât ronflant et cuvant dans un recoin sombre de l’église. Mais il suffisait qu’on l’entendît au clavier pour qu’on oubliât ces travers.
C’est en lui faisant solfier le choral Nun danket alle Gott sous une lumière oblique d’après–midi filant entre deux acanthes de bois doré de l’orgue de Saint-Georges que Finck jugea des dispositions musicales de Christiane. Elle avait sur la tempe une couleur rouge posée par un vitrail. Le régent devait lui confesser plus tard qu’elle ressemblait ainsi à un jeune tambour du régiment de Winterfeldt qu’il avait vu couché dans les labours enneigés de Leuthen, sous un ciel blême à corbeaux et que c’est en raison de ce trait aussi bien que de sa voix bien timbrée qu’il l’avait acceptée à ses leçons de chant.
*
Dès son entrée au cours du régent, Christiane ne manqua pas de se gagner l’intérêt des autres. C’était le nouveau; sa fragilité diaphane semblait attirer la protection des grands; de plus il s’exprimait étrangement avec un accent et des mots velsches. On aurait voulu la tourmenter un peu, mais ce fut l’occasion pour elle de montrer une âme d’acier qui fit l’admiration générale. Au fond, les années de solitude chez le pasteur ne l’avaient pas rendue vulnérable. Elle savait qu’en elle prospérait l’arbre de Diane et que, semés par la machine de Wimshurst, des foudres se concentraient dans le milieu de son cœur. Un grand osseux, sur le point de quitter la chorale parce qu’il muait, et deux autres gredins vinrent la trouver alors qu’elle était sur le paradis de sa marelle et lui demandèrent si elle voulait être leur petit dieu dans un fourré de buis. Elle répondit simplement par un commandement de la Bible: «Dieu seul tu honoreras!»