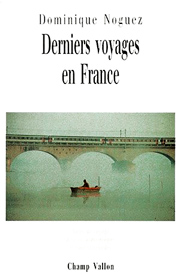Dans ce livre, fruit de nombreuses déambulations dans les villes françaises, Dominique Noguez se livre au plaisir du croquis de voyages entrecoupé d’interludes vengeurs ou laudatifs sur l’évolution actuelle de la société.
Lire l'avant propos
Derniers voyages en France
L’avant-propos
(p. 7-11)
Avant-propos
Il m’arrive encore souvent de faire quelque chose qui ne se fait pas, ou ne se fait plus: je voyage en France. Nos compatriotes, en effet, ne traversent plus la France, en tgv ou de bouchon en bouchon, qu’à moments fixes et pour gagner le chalet-hlm ou le coquet camping de leurs vacances: ils laissent les voyages aux étrangers cultivés, à tous ces coureurs de châteaux, d’églises romanes ou de restaurants trois étoiles qui consentent encore à faire des haltes dans un pays qui n’est déjà plus, souvent, qu’une étape unique dans les circuits européens ou les tours du monde en quatre-vingts heures des voyagistes japonais.
Les avantages sont qu’on n’a pas à changer de langue, ni de monnaie, ni de timbres d’un lieu à l’autre — toutes choses qui constituent, il faut bien l’avouer, l’un des désagréments des voyages internationaux. Les timbres, précisément, on sait où les trouver — à la poste, dans les tabacs —, alors que, chez nos voisins même les plus proches, les usages, sur ce point, se mettent à flotter considérablement.
Mais voyager en France, pour un Français, n’est pas seulement un délicieux archaïsme: ce sera bientôt une chose impossible. Déjà reliée à ses voisines par les mille veines du capital et des intérêts économiques, des montants compensatoires et des programmes Eurêka, des chaînes Sofitel ou des réseaux McDonald’s, fondue dans la graisse commune en attendant de l’être dans une confédération plus ou moins élastique, la France, qu’on s’en réjouisse ou non, n’existera bientôt plus.
D’ailleurs, existe-t-elle encore? Quelle impression laisse-t-elle aujourd’hui? L’impression, confuse avant 1989 et maintenant très claire, malgré les sursauts du bicentenaire, d’un pays rapetissé et inférieur. Pas médiocre, mais résigné. Effet enfin évident de la colonisation culturelle — ou plutôt de l’autocolonisation culturelle, car il s’agit d’un cas assez rare de décervelage d’un peuple par ses propres «élites». Peuple, donc, à qui on a tellement seriné qu’il n’était plus rien tout seul auprès des Américains ou des Allemands ou des Japonais — ou de qui encore? des Martiens? — qu’il est devenu de second rang psychologiquement.
La «grandeur» est bien morte.
Avant, il y avait parfois ce côté réac, ou cocardier, qui sentait le vieux. Maintenant, c’est bien pire: il y a ce côté allègre et avili, allègrement avili, qui sent le jeune. Cette façon soumise d’être jeune, cette façon jeune d’être soumis. Lisez certains journaux, leur façon, dès que pointe une raison de ne pas être trop mécontent de ce pays, de crier «franchouillard!» (mot retrouvé dans le vieux lexique du masochisme national, qu’ils ont repris, astiqué, grossi amoureusement pour en faire le seul synonyme possible de «français»). Colonisés jusqu’au trognon, américains «dans leur tête», n’ayant que cette échelle de valeur et cette raison de vivre-là: être conforme au sublime modèle rock-Coca-Dallas-Hollywood. C’est au point que les plus impatients sont déjà partis et nous abreuvent (notamment un certain Philippe Garnier dans Libération) d’interminables articles où ils jouissent à longueur de pages du plaisir de pouvoir se sentir de là-bas. Au moins, cela fait un beau surmoi. Mais pour ce qui est du moi — du moi collectif des Français —, il aura bientôt, il a probablement déjà, la consistance de la peau de chagrin ou du petit bout de sucre qui vient de tomber dans le grand bol de laitage au pop corn. La France, comme paysage, culture, histoire, manières originales de vivre — tout ce qu’on cherche à découvrir ou retrouver quand on visite un pays — n’existera bientôt probablement plus, ou n’existera, avec toute la finesse qu’on peut attendre de ces reconstitutions à l’usage des mongoliens, que dans quelques petits pavillons «exotiques» du Disneyland de Marne-la-Vallée (ou, comme on dit déjà dans les notices de la B.N.P., de «Marne Valley»).
Si donc, lecteur, exalté par les notules nostalgiques ou guillerettes qui suivent cet avant-propos, tu entreprends d’aventure de me rejoindre, ou de rejoindre les quelques pareils que j’ai peut-être encore, sur les départementales paisibles ou les petites lignes de chemin de fer pas encore supprimées par les vaillants technocrates de la S.N.C.F., sache qu’il te reste peu de temps et que, multiplierais-tu subito presto les déplacements comme un frénétique, ils ne sauraient faire partie, comme les miens, désormais et dans les siècles des siècles, que de la catégorie des derniers voyages en France.
Je dis bien «voyages». Ce mot désigne une réalité presque aussi cocasse et vouée à une prompte disparition que celui de «France». C’est mon deuxième archaïsme. Quand je pars, même pour aller de Paris à Beauvais ou à Romorantin, je me sens «voyageur», jamais «touriste». Il y a entre le voyageur et le touriste la même différence qu’entre le tournedos Rossini et le hamburger, ou qu’entre un cheval de course et un mouton handicapé. (Pourquoi mouton? et pourquoi handicapé? Allez savoir!) Le voyageur n’aspire qu’à une chose: passer inaperçu, disparaître dans le paysage, devenir une sorte de double discret et attentif, fervent, des habitants d’un lieu — un cousin, en quelque sorte. Le touriste, en troupeau frileux, arrive au contraire partout comme le cheveu sur la soupe, ne renonçant à rien de son indiscrète et bruyante identité, estimant normal et même impérieux de retrouver partout, hors de chez lui, ses petites ou ses grosses habitudes — sa bière ou son Coca-cola, ses ice creams ou son café, sa langue, sa télévision, ses pin up, ses horaires de repas. Pareil à ces armées modernes qui se déplacent avec toute leur «logistique», ils sont les petits soldats, adipeux et vulgaires, des nouvelles armées d’occupation du capitalisme. Jouant d’une vague ressemblance véhiculaire, feignant l’incompréhension linguistique, ils obstruent les couloirs réservés aux autobus de la ville avec leurs cars immenses à air climatisé et verres fumés, garés l’un derrière l’autre en longues files lugubres comme, en d’autres temps, les chars d’assaut ou les cars de C.R.S. Ils voient d’ailleurs les «indigènes» du même point de vue: d’en haut, comme des fourmis résignées et vaguement drôles à regarder… de loin.
Place, maintenant, de près, au point de vue de la fourmi.