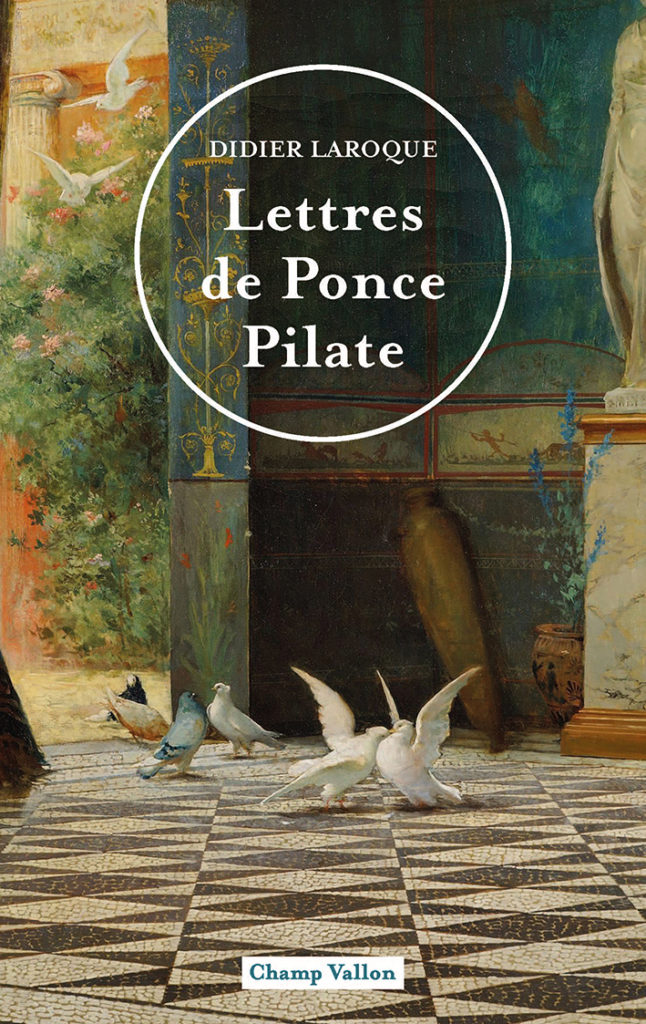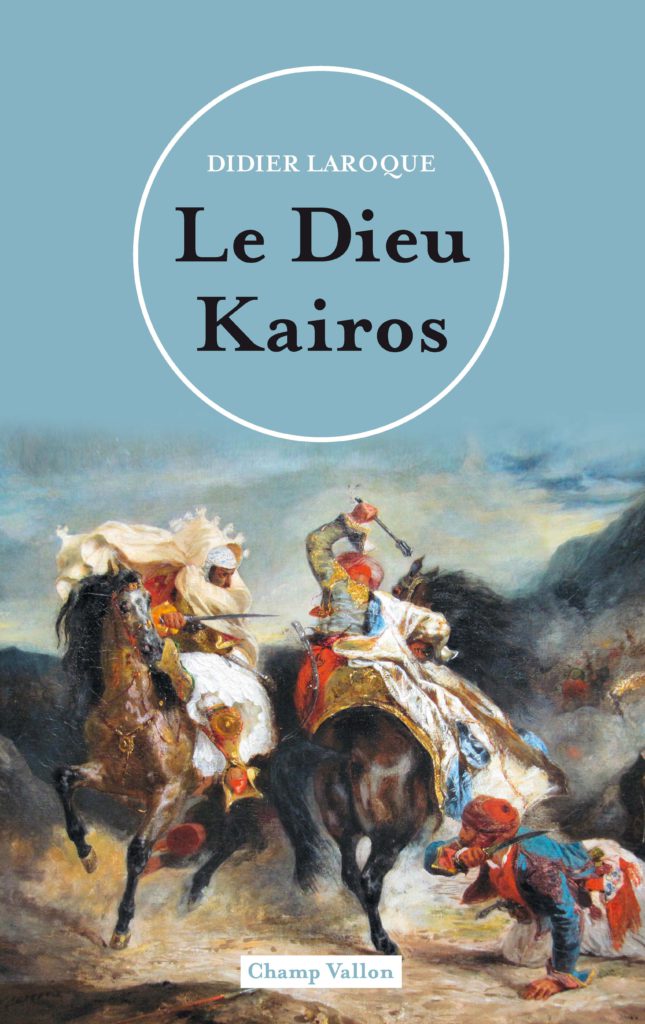La mort de Laclos
Extrait
Cette incertitude des courriers n’est pas une des moins tristes circonstances de notre situation.
Lettre de Laclos à son épouse.
Tarente, le 20 juillet 1803.
I.
En juillet 1803, j’étais un lieutenant de chevau-légers cantonné à Dijon. Certain jour que la canicule ardente faisait fort désirer une baignade dans l’Ouche ou la Saône, je fus demandé à l’état-major. Le colonel Lavelle m’ordonna de porter un message au général Laclos. Quatre cents lieues nous séparaient ! Tandis qu’il m’indiquait les étapes du voyage jusqu’aux États de Naples, je me souviens que le vieil officier — à mes yeux juvéniles —, brusque et chagrin, avait le souffle court, et que son haleine me soulevait le cœur ; je ne voulais en nul temps lui ressembler. Je pris l’objet qu’il me tendait, un portefeuille de toile cirée lié par des cordons goudronnés, cachetés à leurs nœuds. À pas sonores et martiaux, je quittai le cabinet, traversai un vestibule, rejoignis mes quartiers. Une lumière éblouissante enveloppait la caserne déserte ; les longues écuries et le manège, la grille portant une ombre singulière ne paraissaient point à ce moment satisfaire aux nécessités du service : elles suggéraient un monde hors du siècle.
Je déjeunai en ville d’un pesant plat de macaroni et, un rien après, j’avais rassemblé mes effets ; je longeais à cheval le parc d’un manoir des faubourgs. J’y aperçus une jeune femme qui se promenait avec grâce d’insouciance. Elle me sourit. Je reconnus Julie, la nièce du colonel. Ses yeux, à la franchise naturelle et rieuse, avaient du penchant pour moi ; puis ils eurent une gênante insistance. À cause de leur contention comme injectée, je crus y voir une lueur folle. Julie me plaisait, mais sans doute craignais-je une passion extrême. Emprunté, ridicule, je perdis contenance et me détournai. Furieux contre moi-même, je suivis une route forestière. « Le fond de mes difficultés », pensai-je bientôt, « est un refus d’être qui que ce soit. Présomptueuse et complaisante faiblesse. L’ardeur et la fermeté dont je suis capable ne servent qu’un piteux retrait. »
À la première croisée, je mis pied à terre, afin d’ajuster mieux les harnachements ; je souhaitais surtout vaincre un malaise. Connaissant ma mission, je m’étais senti délivré d’une pesante inertie et avais jugé que le voyage m’offrait un change, l’occasion de me reprendre à l’existence. Je ne savais, les dernières semaines, si je n’abandonnerais pas la carrière militaire ; je croyais pouvoir le décider pendant mon itinéraire. Cela n’allégeait point mon cœur à présent ; il était oppressé d’anxiété et les innombrables hauts arbres à l’entour semblaient augmenter le trouble. Une désolation m’emportait. — Était-ce que j’aimais Julie ? — Le destinataire de ma lettre m’avait-il causé un dégoût plus marqué que je ne l’avais conçu ? Vieilli, commandant à Tarente l’artillerie d’une armée d’observation, Laclos devait être différent de celui qu’on avait jadis nommé « l’homme noir ». Au reste, son ancienne et détestable réputation pouvait-elle agir sur mon humeur ? Le fameux roman qu’on lui prête me laissait un souvenir offensant ; à l’heure présente, je méprisais cette sorte de livre et n’estimais valeureux que le discours philosophique. Servir l’auteur des Liaisons ne suffisait pas à m’étouffer d’angoisse. N’était-ce point que j’éprouvais la simple appréhension d’un long et incertain voyage ? Je me sentais averti qu’il y avait quelque danger à craindre. Crainte de quoi ? Je restai un moment les yeux rivés au vide. Ma main flattait l’encolure de la jument, rouges-gorges et fauvettes saturaient l’air d’un incessant et entêtant gazouillis ; des lézards sortirent d’un buisson, les sapins balancèrent leurs branches — elles grinçaient et me glaçaient.