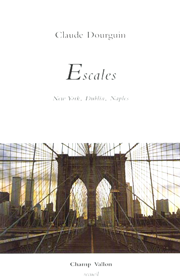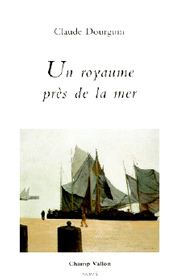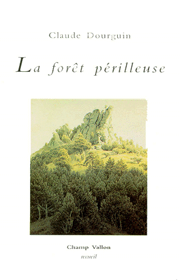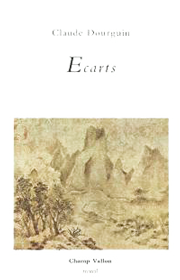(pp. 7-15)
Au promeneur moins soucieux de rejoindre une destination que d’aller, de se prêter, confiant, au hasard de peu coutumiers passages, les chemins écartés sont une tentation, un appel constant. Certes, détours et piste embroussaillée, il ne faut craindre de se perdre, croire plutôt que cet égarement est dispensateur d’autres découvertes, que le voyage n’en est pas un qui ignore la crainte légère de ce qui peut advenir et garantit l’arrivée.
Peut-être le familier, l’amateur de chemins écartés préfère-t-il plus que tout les moments de sa marche. Car allant où les autres ne conduisent ni ne passent, ces chemins traversent bois et prés, landes et pâtures, souvent mal tracés, peu empruntés sinon par qui, braconnier, forestier, berger ou rêveur a spécialement affaire ici. Donc parcours réservés, confidentiels, se frayant passage dans le vif de la terre, où se dispense le plaisir de regarder, de découvrir — plantes, sites et paysages, ou, qui sait, ce passant que pour hanter les lieux l’on reconnaîtrait.
Franchissements inhabituels les sentiers écartés dédaignent le droit chemin. Ils accèdent ainsi où, à l’ordinaire, les voies convenues ne mènent pas. Ils ouvrent sur le secret sinon sur l’inconnu, débusquent les réalités modestes, les concrètes présences (les routes préfèrent l’abstrait). Voies dérobées de l’exploration du sensible, ils en établissent la géographie concrète.
En certaines contrées on a la surprise de trouver au bout ou sur le parcours de chemins perdus dont on ne voyait pas qu’ils puissent avoir une destination, des maisons, des fermes comme l’on dit coupées de tout: ce sont des écarts. On peut penser que ceux qui s’établirent dans ces lieux séparés, parfois bien étrangement situés, au mépris des commodités, eurent d’autres soucis, plus convaincants, obéirent à de plus singulières déterminations.
Ainsi des passages et des lieux, les uns menant aux autres parfois, promenades et séjours, ce sont deux versants du même bonheur que découvrent au gré de la fantaisie les chemins écartés. Bien sûr qui aime les chemins écartés, partout les emprunte d’instinct: voici donc, par bribes, la topographie d’un imaginaire.
L’OEIL DE FEDERICO
Quelques portraits, l’un de main illustre, inoubliables. Le paysage allusif des Marches et la cité d’Urbino ne se séparent plus du profil médaillé de Federico da Montefeltre, du prince-condottiere qui choisit de les aimer.
L’une près de l’autre les vallées se resserrent, bousculent les collines qu’elles font plus rêches qu’ailleurs, dans la hâte d’arriver à la mer. Pays d’au-delà — l’Ombrie, la Toscane —, pays de limites, de terre rétive, où parfois s’embroussaillent les bois.
Mais à l’écart des gorges entaillées, loin des sites escarpés où guettent de rudes forteresses, un semis de collines pourvoyeuses: aux approches du soir les courbes s’y étirent, graves dans la lumière safranée. Sur une hauteur, épanouie et tranquillement posée, une cité «d’apparence délectable» comme l’on disait alors, qui sans bruit acclame son palais.
Le demi-visage jamais ne nous fait face. Un œil, un seul, le gauche — ainsi en a décidé le duc, il a perdu l’autre au combat — dont suffit le mince regard ordonnateur. Profil singulier, sans beauté. La concentration, l’énergie posée le dignifie. Les lignes brisées se succèdent durement — violente cassure du nez qui dégage l’œil, crochet des narines, saillant du menton —, et point de grâce à trouver dans les lèvres minces, étroites. Le cou est épais, le cheveu court et dru, rapidement coupé. Mais une toque rouge élève le front, achève le visage en noblesse. Federico porte une simple robe, de même couleur que sa coiffure, carmin, la robe des humanistes. Le portrait scelle les deux versants, la froide, imperturbable volonté de l’homme d’armes, et l’aspiration intellectuelle, la noblesse de l’esprit. Il les scelle dans un visage où le sentir, l’attention au concret, a laissé ses traces furtives. Federico da Montefeltre, laid et admirable — obsédante effigie.
De la forteresse qui lui fait face de l’autre côté d’un vallon, on voit la ville-palais, terre de sienne rosée ou ocre pincé d’or selon l’heure, la journée, qui sans désaccord revêt de briques la colline jusqu’à son sommet. Là-haut clochers et tours pour que soit prolongé l’élan vers le ciel, mais le palais court en frise. Maisons, cathédrale s’emboîtent, se tiennent l’une l’autre jusqu’à lui, de même matière. Pacifique, heureuse respiration, pas d’emphase nulle part, l’accord sonne clair avec le pays, ses habitudes: placidité très sûre de Federico, le regard se tient hors de l’excès — ni superbe, ni violence. Lui, le vainqueur du Colleoni, c’est une ville franciscaine qu’il construit où se promener sans armes et sans escortes.
Petites ruelles aux sobres façades, fraîchies d’ombre dense, où s’ouvrent, bordés de murs, des jardins potagers accueillants aux fleurs et pleins d’odeurs — lys, jasmin, chèvrefeuille, géraniums. D’autres vont en raidillons de pierre, dégringolades de petites marches verdies par les mousses, lissées par les pas.
Au palais aussi on écoute l’instant, on n’a pas sacrifié les possibilités de sentir au décorum et au faste. Est-ce la guerre qui a instruit Federico des moments? Qui les lui a fait reconnaître chacun particulier et d’importance? Est-ce d’avoir chevauché par tous les temps, d’avoir dressé sa tente au milieu des bois ou sur des buttes écrasées de chaleur, d’avoir dormi joue contre le sol? Des salles s’ouvrent, claires au beau plafond voûté, longues, vastes, mais à mesure humaine, où se rencontrer, parler, deviser à l’écart, se laisser prendre par la rêverie, assis sur le banc de pierre d’encoignure des fenêtres, les yeux sur la place ou sur la campagne. Des pièces plus étroites, plus basses — la lumière s’y amortit vite — où recevoir des compagnons, peintres de peu de mots, lecteurs de Pindare, architectes éperdus de géométrie. Peu d’effets, congé donné aux agitations du grandiose — en surimpression la robe à plis droits du penseur: la paix suffit à nous combler. Des vestibules à la taille d’une maison particulière, où l’intimité se resserre, on approche des appartements privés de Federico. A l’autre bout du palais, côté campagne, il a installé non pas un bureau régalien — la pompe abstraite où donner à voir la puissance —, mais un «studiolo», petit cabinet de travail. A lui seul destinée une pièce fermée, de recueillement savant, de méditation. Non pas une cellule dépouillée — ce serait cadre d’ascète, de philosophe. La beauté s’éprouve, plénitude sensuelle. Pour nourrir les yeux de celui qui «aurait rougi de posséder un livre imprimé» tant lui semblait nécessaire la graphie de main d’homme — qualité et émotion confondues —, les boiseries lambrissent les murs, le fin travail de marquetterie des ébénistes gratifie les sens. La maîtrise rayonne à son sommet, hors les facilités du décoratif, toujours bien gouvernée. Le portrait du duc, encore, tel qu’il se veut, a trouvé ici à se réfléchir.
Le cabinet s’ouvre sur une petite terrasse — suffisante jouissance. Les fûts cannelés des colonnes soutiennent le ciel, font jaillir un bois touffu. Au-dessus du balcon à balustres de pierre, bas du cadre, les collines dorment dans l’amitié nourricière de la ville, cultures en terrasse, oliviers et cyprès, arbres fruitiers. Plus loin d’autres aux crêtes boisées se succèdent, où les champs de céréales emboîtent les ocres. Puis une autre chaîne encore, bleuie de ciel, entre terre et horizon, qui promet les lointains. Le visage très immobile de Federico, lèvres serrées, face à cela: qui a su exiger ce bonheur. L’œil de Federico, celui d’un homme sans lassitude. Et la vue d’Urbino miraculeusement nous rend tels.
Les armures ne sont pas que de trompe-l’œil — non sans raisons en sa studieuse retraite le duc en savoure les images —, quelque part dans les magasins du palais les voici rangées, astiquées, lustrées, toujours prêtes à être revêtues. Juste, rigoureuse mesure, méprisante du mythe: l’indépendance s’acquiert au prix le plus fort, les combats sont à notre porte, jamais dédaignés. Pour maintenir l’harmonie de ce site, le gantelet de fer reste — qu’on le voit bien — suspendu dans l’armoire. Federico, combattant efficace, exact guerrier — vigilant. Le portrait du prince-savant ne déguisait rien.
La ville veille, sévère et chaleureuse. En son centre se tait la longue façade un peu militaire du palais — appareil à bossages, stricte succession de fenêtres. Pas d’extravagances inutiles, pas d’ostentation, l’œil de stratège est judicieux, ni l’efficacité ni l’équilibre n’ont à cajoler l’épanchement. L’harmonie est intérieure: il faut entrer, ne pas se tenir à la publique apparence. La cour d’honneur dément la façade ou plutôt approfondit en abîme les secrets de la sévérité, de l’ennui — nécessaires pudeurs peut-être? La galerie à arcades rose et blanche, les courbes pures, les mathématiques à l’usage de la volupté: une sagesse offerte, simple geste de l’hôte en robe rouge. (Pas de rodomontade en effet.)
Urbino où le pouvoir n’était pas gueux. La ville nomme Federico, sans cesse le fait voir — son dur profil de perspicacité et de maîtrise, son visage d’homme de terrain. Avec lui l’exil apprivoisé, un instant l’harmonie ici-bas — pour cette cité la terre et les collines conseillères —, et les Dieux nous envient nos livres. Urbino où l’œil de Federico a fait le monde vivable.