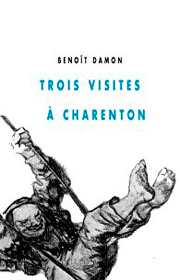Peu de temps avant sa mort, Théodore Géricault exécute dix portraits d’aliénés. Pensionnaire à l’hospice de Charenton, l’un d’entre eux, appelons-le « Monomane de la guillotine », s’adresse au jeune peintre durant trois séances de pose. Il raconte la Révolution, évoque le marquis de Sade, Marie-Antoinette, Louis XVI et leur exécution. Tissant des liens entre les évènements historiques et son destin individuel, cet « Enfant de la Patrie » convoque les figures parentales, sans doute jamais connues. Mais l’enquête est insoluble : bien que dévoilé, le mystère de la naissance demeure entier… « Je suis en ces lieux, comme je l’étais le jour de mon arrestation par trois hommes de main, – je suis, j’étais, je demeure qui je suis : le fils de la guillotine. »
Benoit | DAMON
- Paru en Paru le 16 août 2012
- 12 x 19 cm, 256 pages
- ISBN 978 2 87673 609 2
- 18.50 €
« Et l’enfance morne, coite, animalière, s’en allait en marge du temps: elle coulait, se précipitait, cristallisait déjà dans l’obscure profondeur de ce que nous allions devenir: gesticulants pantins de chair et de sang, fils de la Chute — singes d’hommes tombés de la vulve des mères ».
Ce bref récit, qui renoue avec l’écriture de soi, réunit les séquences d’un journal accompagnant au jour le jour la déchéance du père, aux pages d’un bestiaire poétique dont les figures animalières font surgir les souvenirs d’enfance.
Lire un extrait
Le coeur pincé
L’extrait
(p. 7-11)
L’âne
Verrouillé comme une porte de cachot, je ne voulais plus rien savoir de personne. C’était un effondrement permanent, central, qui me paraissait définitif, sans appel. Bras croisés, poings serrés, traits affaissés, je quittais souvent l’absurde pâté d’immeubles où nous habitions pour errer sur les hauteurs campagnardes du vieux village ou recenser tous les passages, toutes les voies privées et les impasses des lotissements voisins.
Ainsi, après avoir longé la grand-route, je tournais à l’angle d’un chemin communal, entre la masse surélevée de l’étrange Villa Rose et celle de la Villa Léonie qui, partiellement dissimulée par les arbres d’un jardin, ramassée sur elle-même, tapie dans l’obscurité, avait l’aspect d’un gros chat prêt à bondir. Puis je dépassais une ferme précédée d’un hangar où stationnaient des machines agricoles. À cette hauteur, une friche ingrate bordait la route et, derrière sa clôture, un âne solitaire broutait la mauvaise herbe. Toujours seul, cet âne. Du printemps aux derniers jours de l’automne, il dormait à la belle étoile et s’abritait des intempéries en se réfugiant sous un toit grossier, ouvert aux quatre vents. Confiant et court sur pattes, il avait une longue, grande tête qui me semblait disproportionnée, et que j’imaginais lourde, beaucoup trop lourde à porter. Je n’allais le voir qu’une fois la nuit tombée. Il m’arrivait de lui offrir un chardon arraché au bord du fossé; lorsqu’il venait se gratter les flancs contre la barrière, je tapotais son encolure et brossais sa crinière empoussiérée du bout des doigts.
Un peu plus loin, je m’arrêtais devant le pensionnat de la mission catholique tenu par des sœurs à cornettes blanches. Avec ses murs crépis de brun, sa grille d’entrée sévère et ses hautes fenêtres qui me regardaient comme des yeux morts, ce bâtiment réactivait mes craintes d’écolier. Il dégageait une sourde, palpable méchanceté: plus je m’en approchais, plus la résistance de l’air augmentait.
J’avais douze ans; poussé hors de l’enfance, mal engagé, j’étais coincé dans un goulet d’étranglement et me sentais mourir.
*
C’est par une nuit d’épais brouillard que je lui rendis ma dernière visite. En chemin, j’avais ramassé un gros bâton avec lequel je matraquais les poteaux des lampadaires ou battais les haies.
J’espérais ne pas le trouver, mais il était bien là, et tout près de la route. À portée de main. Alors j’ai fait ce que j’avais décidé de faire: me suis approché de lui et l’ai frappé méchamment, de toutes mes forces, d’un seul et unique coup assené entre ses grandes oreilles velues d’innocent. Étourdi, il recula en secouant la tête, ne comprenant pas ce qui venait de lui arriver.
Je lâchai mon bâton et m’enfuis à toutes jambes, terrorisé.
Dans les années à venir, la dépression pubertaire se creusa vertigineusement: tout alla de mal en pis. Minés, les jours s’effritaient, me croulaient dessus. Aussi libre de corps et d’esprit qu’un pantin privé de langue et de cervelle, j’étais, comme beaucoup d’autres, tout prêt à jouer mon rôle de triste guignol. Il ne restait qu’à monter sur scène: au point où nous en étions, ce fut l’affaire d’un instant. Dans l’ombre, les ficelles s’agitaient. – Et la virulence de nos détresses fut telle que d’aucuns disparurent à jamais, subitement avalés par le trou du souffleur – absent – où ne murmurait que le vent du néant.
- Paru en Paru en 1997
- 14 x 22 cm, 156 pages
- ISBN 2.87673.243.2
- 14 €
Les figures souvent grotesques créées par James Ensor s’animent. Elles évoquent la mer du Nord, Ostende la ville balnéaire et ses habitants évanouis, le retour du carnaval ou le célèbre Bal du Rat mort. Libérées des tableaux où leur apparition continue à nous surprendre, elles haussent parfois le ton entre les murs d’une baraque abandonnée, se répondent et s’affrontent. Elles aimeraient régler de vieux comptes. Elles interpellent un visiteur à la nature incertaine. Tout à la fois ancrées dans leur époque et hors du temps, les voix interrogent, avec une ironie d’outre-tombe, la disparition des corps qui un jour les habillèrent. Avoir connu semblable mascarade est-il possible ailleurs qu’en un rêve où l’on croisera les ombres de Proust, Rilke, Roth, Celan ou Perec bien vivant, installé à la terrasse d’un café ?
- Paru en Paru en septembre 2016
- 12 x 19 cm, 208 pages
- ISBN 979 10 267 0429 4
- 17 €