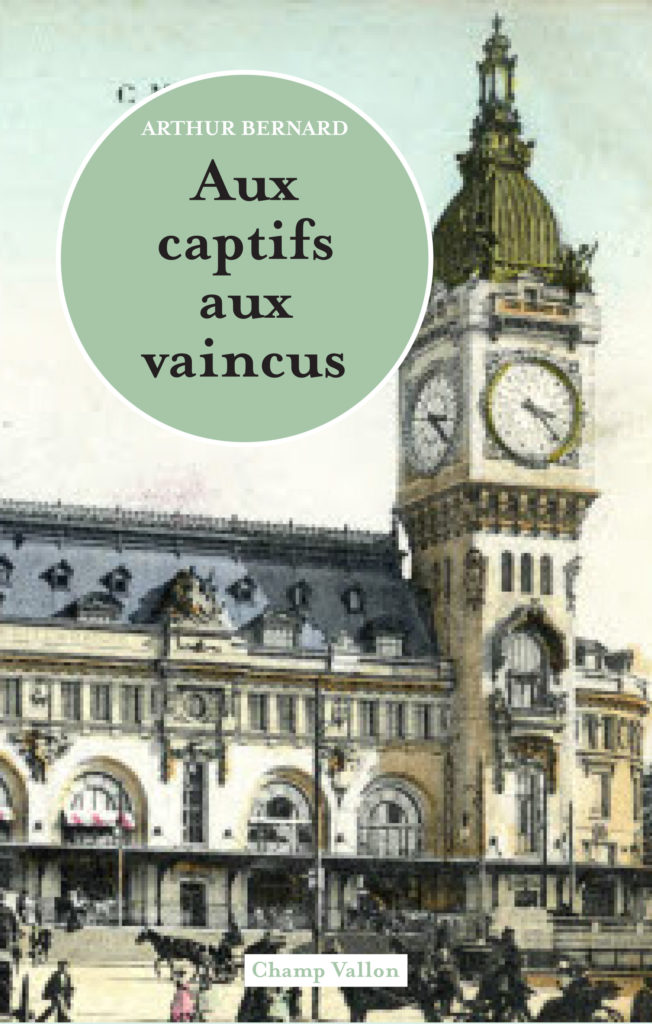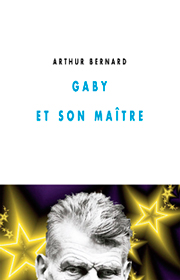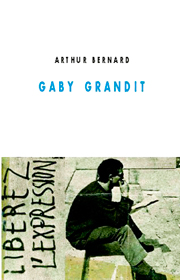Gaby grandit
Le début
Comment je m’appelle ? C’est une question qu’en principe on ne se pose jamais, sauf à se trouver dans un état de commotion cérébrale, de confusion mentale, d’ivresse prononcée et pourtant, il me semble qu’elle m’a toujours travaillé. Parce qu’un jour, celui de ma naissance, mon zéroïème anniversaire en somme et de la bouche même de ma mère l’accouchée, sans que j’y sois pour rien sinon de me trouver là avec elle et de commencer par une coupure, un nom m’était tombé sur la tête, le cigare, que je l’avais ramassé et allumé pour la vie. Avec tous les avantages, les inconvénients, le reste et réchauffé par une température de 37° C., la température stable du nouveau-né. Ça changerait. Je veux dire qu’il y aurait des fièvres, au pluriel et au singulier.
On est tout entier et seulement à moitié dans sa date de naissance. Mais ça y était et, baigné d’amour et de lait, j’étais nommé. J’étais identifié et la vie entière pour en faire, défaire, avec mon identité. Un jour, j’aurai une carte et l’envie d’en changer, la perdre pour mieux me retrouver. Bon.
N’étant plus personne j’étais devenu quelqu’un, c’est dit et ce sera redit, une ligne imprimée, bave et trace de limace sur nombre de paperasses, sauf qu’en permanence me suis appliqué à ruser, tricher, rompre avec la fatalité de cet esclavage par le nom, hérité, transmis, me faisant une morale, une esthétique voire, plutôt un sport en fait, de pratiquer l’acrobatie des doubles, des triples, des alias, des pseudos, et gymnaste, acrobate, contorsionniste, fildefériste de l’identité, je le fus pas si mal, pas toujours pourtant, parfois pas si bien, il m’arrive de penser contre moi-même, à mon détriment d’ailleurs plus souvent qu’à mon avantage. Être pris pour un autre en restant je, ça qui me plaisait c’est sûr, entre autres, dans mon passage par terre. De cela suis certain à mon endroit autant qu’à mon envers : je ne peux vivre sans noms pluriels, empruntés, volés, à moi par moi donnés, par d’autres pour un oui ou un non, un nom, par exemple abandonnant le nom du père pour, dans certaines occasions, adopter celui de la mother, chic il commençait par un A et je le trouvais plus chouette !, moins commun, ainsi devenais-je Arthur Antérion, A. A pour initiales, redoublant la première lettre de l’alphabet. Aussi échanger avec des amis, des très chers, des alter ego, inventer des tours de passe-passe, acquérant grâce à cette manœuvre toute une garde-robe d’appellations, kyrielle de noms à tiroirs, à double fond. J’ai toujours éprouvé de l’admiration, peut-être même de l’envie envers les usagers, que dis-je les artistes du pseudo, tels qu’on en voit battre, couper, cacher, escamoter et retourner les cartes dans les cercles, les arcanes de la truanderie, celles de la littérature, celles de la Révolution aussi, quand pour elle le temps sonne l’heure. Avoir un nom de guerre, surtout quand on ne fait pas la guerre. Moi, je courais et de bien plus modeste façon après des noms qui fuyaient devant moi, semelles de vent, derrière et devant ! En posséder plusieurs, usant ainsi de plusieurs vies, enfin l’illusion d’user : un nom par vie, une vie par nom, comme c’était grisant ! Et même, à l’occasion, allez, osons !, bandant.
Quant à l’alter égotisme, son comble, son fin fond, son absence d’égoïsme et d’envie, il me plaît de l’évoquer à propos du plus cher, du plus intime des intimes de toute mon existence, on n’a pas idée de notre intimité, rien d’ailleurs de vraiment inavouable même dans le jamais avoué, concernant la littérature, les femmes et surtout nous-mêmes, lui et moi, moi et lui, c’était tout comme, et ne nous prends en aucune façon pour des illustres, illustrations de l’amitié virile, celles qu’on trouve dans les livres de classe, les chansons, Montaigne et La Boétie. Pourtant, nous nous étions connus au lycée, le Raoul-Marquis, en quatrième, la classique, la 4e AB comme aussi on pouvait dire. Il en avait treize et douze moi. Nos noms de baptême n’étaient guère éloignés mais identiques, non. Un jour, j’ai oublié lequel de notre histoire, voilà qu’il me fit de but en blanc, au détour d’une conversation banale, changeant de ton, un je-ne-sais-quoi de solennité Désormais, je t’appellerai Babet, je te prie de le noter. N’a rien ajouté, rien expliqué, pour lui (où était-il allé dénicher ce sobriquet ?, ne l’ai jamais su vraiment, il s’est toujours dérobé devant l’éclaircissement et avec lui est mort le secret, décédée l’énigme) ça coulait de source. Alors, ai répliqué au rebond, comme au ping-pong où on était bons, enfin pas mauvais et surtout en double D’accord, mais dans ce cas, de mon côté t’appellerai aussi Babet, note-le toi de même, s’il te plaît. Et personne d’autre ne nommera jamais ainsi ni l’un ni l’autre de nous deux. Aussitôt dit, aussitôt fait, c’est très vite devenu d’un naturel confondant pour tous les deux, qui des fois confondait ceux qui ne nous confondaient pas et avaient de nous ni pratique ni intelligence suffisantes.
Et ça a duré toute notre vie, enfin la sienne, puisqu’il est mort de mon vivant, je suis un soliloque, je suis un survivant, à soixante et un, j’en avais soixante, l’été de l’année où l’on changea de siècle et peut-être, tant qu’on y est allons-y, soyons fou, de millénaire. Cela s’est passé à la suite d’une manœuvre malheureuse au volant, demi-tour sur un terrain en pente et de surcroît boueux, au terme duquel il s’est noyé, prisonnier de son automobile, s’abîmant après une glissade en marche arrière au fond, en fait pas très profond de l’étang où il pêchait la carpe à la pomme de terre. « Dans vos viviers dans vos étangs / Carpes que vous vivez longtemps / Est-ce que la mort vous oublie / Poissons de la mélancolie », écrit de cette poiscaille qui devient centenaire le poète Apollinaire dans son « Bestiaire ».
Et moi Babet restant, ou moitié de, j’en aime encore moins les étangs (et la carpe idem), leur vert stagnant, la crème sale des bords qui crève en bulles, bruits de succions obscènes, les abcès autour des herbes, insectes y pullulant, éternels moucherons, immortels éphémères, les bois pourris flottants. Pour tout le monde, un tas de gens, en un unique nom comme en cent, Toulemonde pour résumer, c’était un accident. Je ne sais rien de plus et pas plus de moins. Donc ne dirai rien. Ni à Toulemonde ni à Personne. Parce qu’il était Babet et que j’étais Babet. Mais ce que pouvait signifier un tel nom obscur, je n’ai jamais réussi à le découvrir, sinon notre confusion en un, autant que notre division en deux. Et ce qui est plus confondant, c’est que j’appelle ses deux fils Babet et qu’ils me rendent la pareille, c’est allé de soi, c’était de plein droit. Et ce qui est encore plus fort, c’est qu’il y a assez peu de temps, Babet le cadet, le petit Babet comme il se désigne volontiers lui-même, m’a annoncé la naissance d’un fils baptisé James, mais pour nous autres tout naturellement Babet, à l’exemple de son père, son oncle et ses deux frères aînés. Drôle de continuation, prolongation, pour moi qui en ai nulle, sinon par le faux nom, que ces trois générations de Babet, qui devant moi, avancent à reculons. Comme le Babet dans son auto vers son étang et ses carpes, lui qui avait d’abord dû s’enfoncer sous l’eau avant de monter comme chez les Grecs antiques dans la barque, la périssoire. Mais cet été-là et depuis déjà un bout de temps, Charon le nautaunier, passeur éternel des âmes mortes, était mort lui-même, c’est-à-dire oublié. Sauf par les livres anciens. Et, plus récemment, renaissant dans les étoiles. J’ai appris il y a peu, c’en était une nouvelle !, qu’une exploration astronomique considérable avait permis d’établir qu’autour de la planète Pluton gravitaient la lune Charon et quatre petits satellites, baptisés Nix, Hydra, Kerbéros et Styx. Voilà donc que la science du siècle 21 expédiait les Enfers jadis souterrains dans le cosmos ! Et que Charon le nocher était devenu une lune tournant autour de son maître Hadès, alias Pluton.