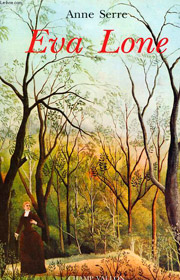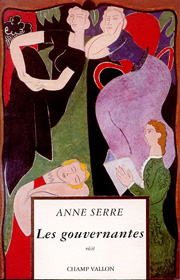D’heureux amants qui perdent leur amour, des personnages qui se préparent pour une ascension dans le ciel, trois sœurs sorcières qui tournent autour de leur chaudron avant d’être propulsées chacune sur une route différente, des enfants qui s’égarent dans un bois munis de sombres pressentiments: telle est la teneur de quelques-unes de ces nouvelles dont les personnages ne prétendent pas au vraisemblable mais, pareils à des mimes, jouent la joie, le désir, la terreur ou la mort.
Lire un extrait
Un voyage en ballon
L’extrait
(p.9-21)
Le dernier jour de leur amour
Le dernier jour de leur amour, Clara et Pierre Glendinning se promenèrent dans la campagne.
Naturellement ils ne savaient pas mot pour mot que c’était le dernier jour de leur amour, même si Clara s’en doutait, et Pierre, à travers les yeux de Clara, voyait se refermer les merveilleux pétales veloutés et gonflés de vie de leur amour.
Ils formaient des projets comme quand on va mourir. «Quand je viendrai…, disait Pierre. La prochaine fois que nous nous verrons…», disait Clara…
Elle portait un drôle de petit sous-vêtement qu’il appela un «pousse au crime» et qui le poussa à lui faire l’amour. Elle eut du plaisir avec lui, mais comme avec un étranger.
Ils se promenèrent en se tenant par la main. Se tinrent-ils par la main?… Non, … à bien y réfléchir, non.
Il crut avoir perdu ses lunettes au cours de la promenade, en passant sous un fil de fer barbelé. Il disait: «Chaque fois que je suis avec toi, je perds mes lunettes», parce qu’une fois, à l’époque où ils s’aimaient, il les avait perdues dans les feuilles d’un petit bois. Il les portait parce qu’elle lui avait dit qu’elle le trouvait érotique avec. Elle le trouvait érotique parce qu’avec ces lunettes il ressemblait à l’amant qu’elle avait eu avant lui.
Ils se promenèrent comme s’ils étaient des amoureux mais ils n’étaient plus des amoureux. Tout en bavardant gaiement, chacun d’eux, inquiet, tâtait la forme de l’amour de l’autre. Clara de ses doigts froids, Pierre Glendinning de ses doigts aveugles. À plusieurs reprises Clara tenta d’aller droit au but. À chaque fois, Pierre feignait de ne pas comprendre et clouait la conversation sur une anecdote, une plaisanterie. En cela aussi il lui rappela son ancien amant qui savait comme personne verrouiller la vie.
Sur le chemin ils trouvèrent une carte à jouer. Clara se pencha pour la ramasser: c’était un roi de cœur. Elle fit semblant de le prendre pour un signe favorable du destin. Elle savait que c’était un geste ironique du destin, qui longtemps les avait couvés et maintenant les laissait choir et déchoir en se régalant de leur chute.
En allant rejoindre Pierre, Clara se doutait que c’était pour la dernière fois. Mais comme elle l’aimait encore, comme elle voulait l’aimer encore — l’amour avec lui était si doux —, elle passait du désir de rupture au désir d’amour éternel, du désir de rupture au désir d’amour éternel… à peu près au rythme du train. À Vierzon elle voulait se donner pour la vie, à Meillac un homme entra dans le compartiment qui ressemblait à Pierre et elle se dit qu’il y avait des milliers d’amants possibles par le monde, à Verrandes elle sentait les mains chaudes de Pierre sur ses seins et ardait d’amour, à Saint-Rollin elle se demanda si elle n’allait pas passer la nuit dans un autre hôtel que celui du rendez-vous.
Quand Pierre Glendinning entra dans le salon où elle l’attendait, ce fut une sorte de soulagement de le trouver moins beau qu’elle ne l’avait cru. Puis tout à coup, de profil, il eut ces yeux clairs qu’elle lui connaissait et elle souffrit.
Elle n’eut pas de plaisir. Ce n’était plus son Pierre. De sa douceur elle se méfia, de ses paroles elle se méfia. Quand il fut tendre, elle le jugea comédien, quand il fut gai, elle le crut indifférent, quand il fut ardent, elle pensa coucher avec un étranger.
Pierre avait adoré Clara. Mais elle s’était faite si petite devant lui, avec le temps, pour ne pas l’effrayer, pour qu’il cesse de l’adorer et l’aime comme une femme, que maintenant il avait des armes contre elle.
Pierre ne savait rien de tout cela. Il avait ses seins à embrasser, l’ouverture de ses cuisses où se nicher; il était content. Il disait qu’il adorait l’âme de Clara, il s’enfonçait en elle comme dans un pays de mystères où il aurait voulu s’endormir à jamais.
Pierre Glendinning ne souhaitait pas vivre avec Clara. Il souhaitait reposer en elle. C’était Clara son pays.
Clara désirait vivre avec Pierre Glendinning. Elle voulait acheter ses chemises, faire le compte de ses chaussures, lui dire: «Tu devrais mettre ton costume bleu aujourd’hui.» Elle désirait passionnément cesser d’être elle-même, cesser d’être Clara, pour être la femme de Pierre Glendinning et ne vivre plus que pour lui.
On était début mars et le soleil ce jour-là était chaud. Devant leur chambre poussait un pin. On se serait cru dans le midi de la France. «Nous n’irons jamais plus dans le midi de la France», pensait Clara. Elle ne souffrait pas, parce qu’il était là, mais prononçait froidement en elle tous ces «jamais plus».
Une fois, ils y étaient allés, dans le midi de la France. Ils avaient dormi à Millau; il y avait de la neige sur les sommets des montagnes. Il voulait lui acheter un sac à main. Il y avait énormément de magasins de sacs à Millau. Le soir, ils avaient cherché un restaurant dans les rues emplies de brume.
Le premier coup de gong marquant la fin de leur amour retentit sourdement dans la chambre de leur hôtel sur la côte, face à la mer. Clara s’était inquiétée de quelque chose et Pierre Glendinning ne l’avait pas senti. C’est la première fois qu’ils furent séparés. Au petit matin ils en rirent. Ce léger nuage avait si peu d’importance en regard de leur éblouissant amour. Cependant le germe du chaos venait de tomber dans leur amour. Il croîtrait, gonflerait, rendrait un jour l’amour douloureux, puis l’envahirait, le pourrirait, le détruirait. Mais cela arriverait dans si longtemps…
Pierre admira les bateaux et joua au marin. Elle le trouvait si désirable. Tout avait été un peu raté: l’hôtel, les promenades, même l’amour dans un clocher. Mais ce qui est un peu raté est si réussi quand l’amour vous empoigne chacun d’une main et vous presse si fort l’un contre l’autre, qu’on brûle à seulement être ensemble.
Au tout début, avec Pierre, ayant l’habitude d’amants cruels et habiles, Clara, lorsqu’elle le sentit inoffensif, s’émerveilla. La douceur de Pierre, la douceur des plaintes de Pierre Glendinning lorsqu’elle le blessait pour vérifier jusqu’à quel point il était vraiment inoffensif, l’émerveillait. Son naturel gai, sa constance, l’aveu qu’il lui faisait de ses craintes, de son amour, insufflaient en Clara un sang léger, comme si on l’eût débarrassée de l’air vicié qui emplissait ses poumons, pour le renouveler par un air tendre et doux de printemps. Aussi Clara se sentit-elle bientôt légère, vive, gaie, apte au bonheur, semblable aux femmes heureuses, comblée qu’elle était par l’amour aérien et vivant de Pierre.
Quand ils se retrouvaient, leurs sens clamaient leur bonheur avec une force étonnante. Dix fois le jour, dix fois la nuit Pierre Glendinning et Clara faisaient l’amour. Jamais ils n’étaient épuisés. Rassasiés l’un de l’autre, jamais. Et quand ils marchaient ensemble dans les rues, main dans la main, c’était comme s’ils faisaient encore l’amour. Et quand ils dînaient face à face dans un restaurant, c’était comme s’ils faisaient encore l’amour. Lorsqu’ils rentraient, l’amour qu’ils faisaient contenait celui de la rue, celui du dîner, et d’autres encore.
Pierre faisait envoyer des roses à Clara. Clara les recevait comme une femme amoureuse, feignant d’en avoir toujours reçu par brassées. Quand Pierre devait partir, il prenait l’air soucieux et triste. Clara le consolait de la quitter.
Pierre Glendinning avait sûrement déjà prononcé les mots «mon amour», «ma chérie». Clara, jamais. De Limoges, une fois, elle lui écrivit: «mon amour». Puis au téléphone elle lui dit: «mon amour». Puis lorsqu’il fut avec elle, elle l’appela: «mon amour». Et le mot glissait entre ses lèvres comme si elle l’eût toujours prononcé, comme si ce mot était le plus familier de sa bouche, comme une amoureuse, comme une femme, elle disait mon amour, et quand elle était un peu intimidée elle le répétait trois fois très vite et Pierre Glendinning disait que c’était comme trois petites flèches qui volaient vers lui par-dessus les villes, par-dessus les champs, par-dessus les bois, pour venir s’enfoncer doucement dans son cœur là-bas dans sa maison.
Car Clara et Pierre ne vivaient pas ensemble. L’un vivait à la ville et l’autre à la campagne. Clara rêvait des bois où vivait Pierre. Pierre Glendinning, de la ville où vivait Clara. Il voulait devenir libraire dans cette ville; elle voulait avoir un jardin, des sentiers, des bois et des prés, planter des arbres, manger du fromage et boire du vin les coudes sur la table de la maison qu’elle partagerait avec Pierre.
Rien ne pressait. On avait tout le temps devant soi pour rêver. On pourrait même peut-être rêver toute une vie. Tant que rien ne s’y opposerait. Mais quelque chose s’y opposa. C’est alors qu’ils cessèrent de rêver et que leur amour se mit à décliner. Il eut naturellement cette flambée qui précède le déclin. Pierre et Clara se jurèrent un amour éternel.
Avant Clara, Pierre Glendinning disait n’avoir jamais aimé. Il avait été amoureux, mais pas comme cela. Il disait qu’en rencontrant Clara il avait trouvé ce qu’il avait toujours cherché, obscurément, à tâtons, tout au long de sa vie.
Avant Pierre, Clara avait aimé. Elle avait brûlé jusqu’à la moelle pour un homme cruel, et quand elle était sortie de cet amour, elle s’était retrouvée retournée comme un gant, toute changée. C’était elle qui était allée à la rencontre de Pierre. La nuit suivant le soir où elle l’avait rencontré, elle avait rêvé qu’elle faisait l’amour avec lui, et cet amour était si exactement fait pour elle, il avait déversé en elle de tels flots de lumière et de chaleur, qu’au matin, résolue, elle était allée droit à Pierre Glendinning pour lui demander son amour. Pierre l’attendait.
C’était une matinée d’été. Sourde et aveugle à tout, sinon à la chair solide, miroitante, qui là-bas battait pour elle, Clara s’était engagée dans les rues, happée par l’ouverture lumineuse de la porte de Pierre.
Son cœur battait de l’audace de sa démarche. Si elle se trompait? Si Pierre Glendinning allait tout à coup se lever, la chasser avec indignation? Mais le corps de Clara avançait, soutenu par mille anges rieurs soufflant dans de petites trompettes d’or.
L’escorte qu’on lui faisait la protégeait des regards. Sur le seuil des boutiques, les marchands la voyaient passer, seule et soulevée d’amour en plein midi: «Tiens, pensaient-ils, voilà Clara qui passe.»
Quand elle se retrouva face à Pierre Glendinning, elle tremblait, mais tout était bien puisqu’il était là. À leur insu, la magie de leurs corps jouait doucement. Ils se touchèrent, rêveurs, comme s’ils ne se touchaient pas. Les doigts de Clara étaient froids d’émotion. Ceux de Pierre, plus chauds et familiers encore que dans le rêve. Puis ils se retrouvèrent après des mois de silence car rien n’avait été dit formellement, et quand Pierre lui fit l’amour et que Clara se donna, il lui dit «je t’aime».
Clara avait eu des amants. Avec chacun des hommes qu’elle avait connus, elle avait laissé tomber une nouvelle mue pour apparaître devant Pierre exactement telle qu’il la désirerait. Aucun de ses autres amours n’avait été heureux. Chacun d’eux avait consisté en une sorte d’opération alchimique. Clara avait eu beaucoup à faire avant de pouvoir rencontrer Pierre Glendinning et lui offrir son véritable corps débarrassé de sa dernière mue. Elle entra dans la vie de Pierre Glendinning exactement au moment désigné. À la seconde près. C’est pourquoi leurs corps et leurs âmes furent envahis aussitôt par l’immédiate et pleine connaissance l’un de l’autre. Il n’y avait aucune distance entre eux. Pas une once de leur chair, pas une once de leur âme qui ne fût en contact avec la chair et l’âme de l’autre. Rien ne les séparait.
Ils s’émerveillaient de cette extraordinaire union. En une seconde ils avaient versé de l’ignorance l’un de l’autre dans la connaissance parfaite l’un de l’autre. Et quand ils se touchaient, quand ils se caressaient, quand ils se serraient l’un contre l’autre, ils s’émerveillaient encore de ne trouver nul obstacle.
Le jour où Pierre Glendinning rencontra Clara, il se fit une sorte de vide. C’était comme si les parois du ciel s’étaient dilatées et sous ce dôme soyeux il n’y avait plus rien, sinon Clara, au centre, rieuse, frappant la terre de ses pieds.
Des boucles s’échappaient de sa chevelure et elle regardait Pierre gentiment, la tête un peu de côté, avec dans les yeux un appel joyeux, impérieux et joyeux.
Cette femme lui apparut comme une espèce de fée, courant dans les hautes herbes, l’appelant, se cachant, réapparaissant, puis fuyant pour jouer, de telle sorte qu’il restait au milieu du champ, tout seul, avec dans les mains l’impression d’avoir touché sa forme mais se demandant s’il n’avait pas rêvé.
Derrière elle il galopait. Quand il la saisissait, ses mains s’emparaient de ses seins, de son ventre, de ses fesses bondissantes. Il forçait toutes les ouvertures, et quand les cuisses à nouveau glissaient sous son corps et que Clara, nue comme un poulain, détalait, alors il repartait à sa poursuite.
Clara adorait ce jeu. Son cœur battait lorsqu’elle entendait le souffle de Pierre derrière elle, et lorsqu’il s’emparait d’elle, elle se laissait tomber, prendre et dévorer.
Leur amour érotique fut d’une force merveilleuse. La bouche de Pierre Glendinning se collait à toutes les fentes, dans tous les creux. Ses mains obstinées visitaient le corps de Clara et Clara s’ouvrait. C’était comme si Pierre était muet et Clara, son langage. Parfois il leur arrivait de ne pouvoir se déprendre l’un de l’autre. L’heure était passée, qu’ils étaient encore à lécher leur pelage.
Lorsque Pierre reposait, Clara humait l’odeur de pain frais qui émanait de sa chair, douce, élastique. Quand Clara dormait, Pierre tenait dans ses mains deux seins ronds aux pointes rouges et sa verge dormait contre les fesses joueuses.
Ils eurent du plaisir à ne savoir qu’en faire. Leur amour sursautait de joie lorsqu’ils étaient nus. Les mains chaudes de Pierre parcouraient les épaules et les reins de Clara, faisant frémir son bonheur qui s’échappait alors en trilles et cris.
Pour ces cris, Pierre Glendinning aurait fait bien des voyages. Loin de Clara, il les entendait comme dans une chambre d’écho, répercutés de tous côtés. Au centre, sa verge se dressait, attentive, inquiète. Alors il n’avait plus souci de rien: Clara l’appelait, il lui fallait aller. Et la course recommençait tandis que de loin elle lui lançait les longs signaux de son amour.
Ils s’aimaient. Leurs visages parlaient pour eux. Lorsque d’aventure on les réunissait en présence d’autres personnes, leurs yeux qui ne se cherchaient pas avaient le même éclat. Entre eux un fleuve lancinant coulait, et qui traversait ce fleuve par inadvertance se sentait soudain pris dans un flux et reflux qui rejetait son corps.
Au milieu des autres visages, leurs doigts se nouaient, leurs bouches se collaient l’une à l’autre, ils respiraient leurs souffles, entrelaçaient leurs jambes, se prenaient, s’accueillaient et restaient ainsi immobiles, fichés l’un dans l’autre.
Le dernier jour de leur amour ils s’embrassèrent à bouche que veux-tu, mais on aurait pu traverser le fleuve qui coulait entre eux. Le lit s’en était élargi, les eaux tumultueuses s’étaient apaisées, le courant, figé. Tout au fond de ce fleuve devenu lac, il y avait les cadeaux et les bijoux que Pierre avait offerts à Clara: un bracelet d’or, un petit poignard au manche d’ivoire.