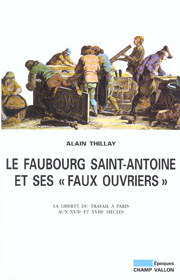« Tout Paris sera le faubourg Saint-Antoine : point de talent, point de solidité, beaucoup d’intrigues, nulle réalité dans les fortunes, point de confiance qui n’est attachée qu’à un établissement solide ». Alors que Turgot propose d’abolir les corporations de métiers en février 1776, les maîtres boutonniers parisiens stigmatisent le faubourg Saint-Antoine et ses artisans. Dans cet espace périphérique constitué au xviie siècle, la monarchie a en effet privilégié l’installation d’artisans de tous horizons en dérogeant à l’organisation des communautés de métiers, laissant les coudées franches aux « faux ouvriers » et y autorisant la liberté du travail dès 1657.
écrire l’histoire d’un espace devenu symbolique ne relève donc pas d’une simple histoire locale. En se posant d’emblée sur les marges, c’est proposer une histoire sociale et économique du monde des métiers parisiens qui tienne davantage compte des lieux de travail privilégiés, des tensions et des complémentarités qu’ils suscitent dans la ville. En choisissant le faubourg Saint-Antoine, c’est chercher à comprendre les dynamiques qui animent les gens de métier et donner une image à la fois plus complexe et plus relative d’un monde du travail trop souvent présenté comme homogène et pacifié à travers la trilogie «apprenti-compagnon-maître». Cela permet aussi de mesurer l’écart entre la liberté théorique et les pratiques des acteurs que tout oppose si l’on s’arrête aux procédures judiciaires ou aux écrits des mémorialistes. Qui sont les artisans du faubourg Saint-Antoine ? Leur liberté consiste-t-elle à innover et à travailler honnêtement ou « à mal faire » ? Lorsque de vrais apprentis se dessinent dans l’ombre des alloués, de vrais maîtres et des jurés des communautés parisiennes dans celle des « faux ouvriers », la diversité des parcours et le choix des possibles interpellent le lecteur. Les affrontements ou les accords avec les maîtres parisiens prennent un autre relief, en particulier les saisies de marchandises. Les trajectoires d’artisans soulignent l’imbrication des espaces, les mêmes tensions et les mêmes solidarités qu’en ville. Tout Paris n’est peut-être pas le faubourg Saint-Antoine, mais le faubourg Saint-Antoine et ses « faux ouvriers » reflètent une grande partie du monde artisanal parisien.
Revue de presse
et ses «faux-ouvriers»
la liberté du travail à Paris aux XVIIe et XVIIIe siècles
La Quinzaine Littéraire du 16 décembre 2002 (par Jean Nicolas)
Le » souverain Faubourg « , une » poudrière de souffrance et d’idées » selon Victor Hugo, le » bélier des révolutions » nous dit Jules Vallès… Par-delà les mythes et le grand folklore des foules enfiévrées, des barricades et des fusillades, Alain Thillay ressuscite au quotidien l’ancien quartier Saint-Antoine, dans sa genèse et sa diversité.
L’auteur a retrouvé les traces surabondantes de cette invention urbaine dans les actes des notaires, les procès verbaux de police, les dossiers de faillite, les correspondances ministérielles ou les papiers des corporations. Avec la passion d’un papyrologue, il éclaire l’émergence d’un espace historique qui prend son envol au temps de Henri IV sur le territoire champêtre qui s’étale côté rive droite de la Seine. Des chemins mal tracés, quelques masures au milieu des champs et des vignes, un très ancien monastère et sa toute-puissante abbesse, la Dame-de Saint-Antoine-des-Champs. Le bâti se densifie sous Louis XIII, deux ou trois nouveaux couvents féminins s’installent, les miséreux affluent, souvent venus de loin à la veille et au lendemain de la Fronde, fuyant les campagnes épuisées par le fisc et ravagées par les guerres civiles ou étrangères. L’une après l’autre les baraques se transforment en maisons, d’abord étroites et basses, puis un peu plus hautes, peuplées de jardiniers, de boutiquiers et surtout d’artisans qui travaillent le bois, l’argile et le métal pour fournir une clientèle parisienne de jour en jour plus nombreuse et plus fortunée. Depuis la porte Saint-Antoine et la Bastille les rues s’allongent en éventail vers l’est et le nord-est, en direction de la Roquette, Charonne, Vincennes, Charenton et Montreuil.
Voici que le mouvement s’accélère quand les lettres patentes de 1657 accordent à tout le Faubourg un privilège inouï pour l’époque, l’entière liberté de travail. Ouvriers et boutiquiers s’établiront donc ici à leur guise, sans chef-d’œuvre ni lettres de maîttrise ; les nouveaux venus engageront tous ceux qu’ils voudront, ouvriers et apprentis ; ils inventeront, fabriqueront et vendront sans tenir compte des règles et interdits édictés par les puissants corps de métiers parisiens qui pratiquent alors un malthusianisme professionnel hyper-tracassier. Acte souverain, étonnant par son libéralisme en un temps colbertien où le roi prétendait tout contrôler. Hésitations du pouvoir, respect archaïque des puissances cléricales maîtresses des lieux, encouragement accordé aux institutions religieuses dans leur patronage des pauvres, alors que la misère aboie de tous côtés ? Alain Thillay propose la gamme des motifs, mais il suggère aussi qu’il s’agit peut-être d’un choix délibéré, une sorte de ballon d’essai, comme une amorce volontariste de libre concurrence dans un dispositif par ailleurs verrouillé – en somme une saine manifestation de pragmatisme étatique.
Les maîtres parisiens, on devait s’y attendre, ne décolèrent pas contre un privilège aussi exorbitant dont vont jouir des gens de rien, sortis du néant, des inconnus, des protestants venus se réfugier ici, concurrents détestables, » faux maîtres » et » faux ouvriers « . Ils vont donc tout faire avec leurs jurés – dénonciations, visites, saisies en plein cœur de l’enclave privilégiée – pour étouffer ces germes de libre entreprise. Du moins telle était la doctrine, mais c’était compter sans les urgences du quotidien. Entre le in de Paris, et le off du Faubourg, comme le montre l’auteur, s’élabore un monde d’accommodements. La coupure n’est pas absolue, on peut tout contourner. Des ouvriers du Faubourg accèdent de temps à autre à la maîtrise et sont reconnus comme tels par les jurés des vieux métiers. A l’inverse, des maîtres parisiens n’hésitent pas à faire travailler en sous-traitance » sur le privilège « , et ils y ouvrent même des ateliers. La production du quartier pénètre dans la ville en dépit des interdits : vaisselle de faïence ou de métal, articles de mode et de sellerie, papiers peints, étoffes de prix, habits au nouveau goût, voitures et équipages, miroirs de la manufacture de Reuilly, meubles ordinaires ou ébénisteries raffinées. Les acteurs de ce miracle économique sont venus d’un peu partout, ils vivent en chambrées ou en boutique, regroupés selon l’origine ou la spécialité – qui souvent se recoupent. Les chaudronniers auvergnats tiennent la ruede Lappe, les ébénistes venus de Flandre règnent dans la Grande rue du Faubourg, ceux d’outre-Rhin sont rue deCharonne et de Charenton, jusqu’à la rue Saint-Nicolas réputée rue allemande et luthérienne à la fin de l’Ancien Régime.
Tout cela se mélange et se parisianise à grand renfort d’alliances matrimoniales avec les filles des artisans traditionnels le plus solidement installés. De fructueuses entreprises voient le jour, telle la manufacture du Sieur Réveillon, rue de Montreuil. L’auteur dessine nombre de parcours réussis, balisés de dots et contrats. La saga familiale des ébénistes Migeon est exemplaire à cet égard. Du talent, de l’énergie, des mariages heureux, quelques avatars surmontés – plusieurs mois de Bastille en 1703 pour Pierre Migeon, dénoncé pour huguenoterie – et de nouveau le succès. Pierre Il le fils fait travailler une centaine de compagnons dispersés dans les rues voisines et jusque dans la ville, Pierre III épouse en 1762 la fille d’un maître menuisier, juré en charge, qui à sa mort laissera une fortune de plus de 200 000 livres. Belle ascension aussi pour les Gervais, qui passent en deux générations du maraîchage à la tapisserie en meubles; ils traitent avec une clientèle fortunée, placent leur argent, achètent des maisons et s’orientent vers les emplois royaux à travers les offices. Tous ceux-là visent la respectabilité parisienne et bourgeoise en combinant le double avantage du libéralisme propre au quartier et du système corporatif qu’ils parviennent à intégrer.
Les analyses entraînantes d’Alain Thillay amènent donc à nuancer l’image d’un Faubourg » contre modèle « , opposé à l’organisation rigide des communautés de métier. L’étude le fait plutôt apparaître au XVIIIe siècle comme un laboratoire de pratiques et un mixte social. Pourtant c’est la mythologie héroïque du XIXe qui prévaudra dans la conscience ouvrière et l’imaginaire collectif. La fringue et la bouffe, qui de nos jours investissent les anciens ateliers, feront-ils oublier l’air de fronde libertaire qui a si longtemps soufflé dans cette enclave denonconformisme.
Jean NICOLAS