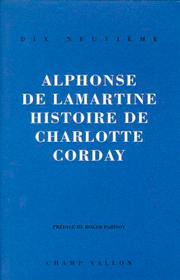Charlotte Corday d’Armont, petite-nièce du grand Corneille, guillotinée le 17 juillet 1793, à l’âge de vingt-cinq ans, était belle comme une vivante allégorie. Lamartine fut séduit par son courage, sa fierté, sa grâce. Elle lui apparut comme un ange, chargé de rendre la justice de Dieu. Mais cet ange avait du sang sur les ailes: le sang noir de Marat. Le poète fit d’elle l’héroïne du Livre 44 de son Histoire des Girondins, où il la salua comme la « Jeanne d’Arc de la Liberté » et l’ »Ange de l’Assassinat ».
Extrait de la préface de Roger Parisot
I
De l’Histoire des Girondins, dont Lamartine entendait tirer «une haute leçon de morale révolutionnaire» pour le peuple, et, pour lui-même, les enseignements de cette «politique expérimentale» qu’est l’histoire, se détache un livre qui a son unité et forme à lui seul un tout. C’est le Livre 44e, qui raconte la vie de Charlotte Corday, récit d’une destinée tout entière soumise à une logique de sacrifice et de mort, qui tient à l’histoire de la Révolution, dont elle concentre, en un pathétique épisode toute la terrible grandeur, et qui tranche sur elle à la fois par sa vertu exemplaire et sa singulière beauté, comme le ferait la pure fiction d’un poète. Lamartine en a fait une œuvre parfaite en son genre, vivante comme un roman, émouvante comme un drame, fatale comme une tragédie, comparable chez lui, à divers titres, à ce qu’est la Vie de Rancé chez Chateaubriand. Il est vrai que l’histoire de Charlotte de Corday avait de quoi retenir l’attention de l’historien, frapper l’imagination du poète, et toucher le cœur de l’homme. D’abord parce que, dans cette période tumultueuse et bruyante, où des partis, des factions et des comités s’affrontent dans des débats houleux et des conflits virulents, Charlotte Corday se distingue en agissant dans la solitude, le silence et le secret. Son geste est celui d’une inconnue qui n’a aucun complice, ne représente aucun groupe, n’est l’agent d’aucune conjuration. Ensuite parce qu’elle est jeune, belle, courageuse, et qu’elle va faire preuve d’autant de détermination dans l’action que de sérénité en face de ses juges et d’héroïsme devant la mort. Lamartine sera sensible à tant de mérite; il étudiera l’histoire de Charlotte Corday avec une attention émue, et restera longtemps attaché à son image. Sans doute l’avait-il encore dans l’esprit quand il écrivait, dans Graziella: «Nous nous plaisions à combiner ces grandes circonstances, ces merveilleux hasards des temps de révolution, où les hommes les plus obscurs sont révélés à la foule par le génie, et appelés comme par leurs noms à combattre la tyrannie et à sauver les nations; puis, victimes de l’instabilité et de l’ingratitude des peuples, condamnés à mourir sur l’échafaud, en face du temps qui les méconnaît et de la postérité qui les venge.» Charlotte Corday était bien à l’image de ces héros qu’il rêvait d’être.
Mais l’intérêt de Lamartine avait encore d’autres motifs. Le geste fatal de la jeune meurtrière soulevait des problèmes religieux, moraux et politiques, qui l’«interpellaient», comme on dit aujourd’hui. Pour le croyant qu’il était, la Providence était à l’œuvre dans l’Histoire. Or, à ses yeux les signes d’une intervention divine étaient encore plus visibles dans l’histoire de Charlotte Corday que dans tout le cours des événements de la Révolution. Il les évoque dans le prélude au récit qu’il va faire: «Pendant que Paris, la France, les chefs, et les armées des factions se préparaient ainsi à déchirer la République, l’ombre d’une grande pensée traversait l’âme d’une jeune fille, et allait déconcerter les événements et les hommes, en jetant le bras et la vie d’une femme à travers les destinées de la Révolution. On eut dit que la Providence voulait se jouer de la grandeur de l’œuvre par la faiblesse de la main.»l Tant de force donnée à la fragilité, tant d’audace à la timidité, tant de portée historique à un acte isolé, laissent deviner un accord venu d’en haut.
Il n’est jusqu’à la puissance du coup de couteau qui frappa Marat en plein cœur, évitant les côtes, tranchant l’aorte et provoquant la mort instantanée, qui ne manifeste une occurrence «surnaturelle». La pauvre Cécile Renault, qui manqua tuer Robespierre, n’eut pas pour elle toutes ces circonstances complices, car elle n’avait pas reçu le «mandat du Ciel». Aussi échoua-t-elle, et l’Histoire l’a oubliée. Au contraire, Charlotte Corday, par le succès de son acte, qui évoque l’ombre de Judith et les mânes de Brutus, rejoint les grandes figures prédestinées, dont le temps garde le souvenir. Lamartine verra même en elle, dans son sacrifice patriotique et dans sa mort héroïque, l’image à la fois d’une «Jeanne d’Arc de la liberté», et celle de l’«antique Némésis», qui frappe inexorablement en retour, ceux que l’«hybris» a emportés. Reste que le geste de Charlotte est criminel, et qu’il pose de douloureux problèmes. Le Ciel put-il permettre un tel homicide, et faut-il admettre que le crime entre dans les plans de la Providence? Certes, les Révolutions, qui sont nécessaires au Progrès, à l’établissement des Républiques et à l’émancipation des Peuples, sont tout entières entre les mains de Dieu. Lamartine les a chantées, en 1831, après les «Trois Glorieuses», dans une fameuse Ode sur les Révolutions. Il y célébrait comme providentielle cette loi du devenir humain, qui veut que l’avenir se bâtisse sur les ruines du passé, qui sont «la poussière du chemin» sur les «pas des générations». Et l’Ode concluait, lyrique:
Qu’importent bruit et vent, poussière et décadence,
Pourvu qu’au-dessus d’eux la haute Providence
Déroule l’éternelle loi!
De même, dans Jocelyn (1836), il montrait, dans la marche de la «Caravane humaine», et dans les grands mouvements socio-historiques qui révolutionnent le monde, l’action de Dieu, qui fait d’un peuple:
L’outil mystérieux de quelque grand mystère1
et des nations guidées par Lui «les instruments d’idées». De même encore, dans La Chute d’un Ange (1838), il célébrera les révoltes et les révolutions qui, affranchissant les peuples du joug de la tyrannie, sont un devoir pour eux, et servent la cause de Dieu. Ainsi l’ange Cédar, au nom de l’esprit divin, exhorte-t-il les esclaves à se soulever contre les géants qui les oppriment:
Venger l’homme avili, c’est venger Dieu lui-même!
Abandonner ses dons, c’est le déshonorer;
Reconquérir ses droits, c’est encor l’adorer!2
Mais cela entraîne-t-il que dans les Révolutions, tout soit voulu par la Providence et conforme à ses décrets? Et qu’il faille tout lui attribuer, jusqu’aux crimes et aux assassinats? Jocelyn et l’ange Cédar ont rencontré ces questions, que Lamartine n’a pas véritablement tranchées.
A côté de ce problème de morale religieuse, et presque d’herméneutique sacrée, le geste de Charlotte Corday pose un problème de morale politique, que Lamartine a personnellement affronté. Celui de la violence dans l’histoire, de sa fatalité et de sa légitimité, qui se pose ainsi: est-il inévitable d’y avoir recours, et en a-t-on le droit? Assurément, le passé donne d’innombrables exemples de massacres, de tueries et de crimes politiques, et l’Histoire montre que les révolutions, les insurrections populaires et les bouleversement sociaux s’accompagnent toujours de débordements déplorables. Ces faits peuvent-ils avoir leur justification? Faut-il admettre cette formule de Saint-Just, que «Ce qui produit le bien général est toujours terrible»? Et que les sociétés sont, comme les femmes, condamnées à n’accoucher que dans la douleur les mondes nouveaux qu’elles portent dans leurs flancs?
Cœur sensible et âme chrétienne, homme de devoir, idéaliste et mystique, mais aussi acteur politique et conscience engagée, Lamartine est tourmenté par ces interrogations. Il sait quels douloureux dilemmes et quelles déroutantes apories soulève l’éternel débat de la fin et des moyens. Car c’est bien de cela qu’il s’agit. Or, la sagesse des nations a beau dire que «Qui veut la fin veut les moyens»; et que «la fin justifie les moyens», en politique surtout où, paraît-il, il ne faut pas hésiter à se salir les mains, le cœur sent, et la raison sait, que cela n’est pas vrai. Saint Augustin l’a dit une fois pour toutes: «Ferons-nous le mal pour qu’un plus grand bien en vienne? Nullement!» Ni en politique, ni ailleurs. Et Lamartine, qui aura la fierté de faire proclamer la République1, «sans victimes, proscriptions, ni vengeance», le sait mieux que tout autre. Une juste fin, loin de justifier d’injustes moyens, se corrompt, au contraire, si elle y a recours. En politique pas moins qu’ailleurs. La faute morale, estime-t-il, fait l’échec politique2. Il le dit en toutes lettres: «La vertu la plus pure» se trompe, «si elle emprunte l’arme du crime». Il avait bien dit, en 1827, dans une lettre à Aymon de Virieu, qu’«ainsi est fait le monde politique: la crise est un mal affreux, mais ce mal enfante un bien»; cela n’entraînait nullement, dans sa pensée, qu’on eût le droit de faire le mal délibérément, en vue d’un bien futur. Une chose est de tirer un bien du mal, une autre de commettre le mal, fût-ce dans une louable intention. Et le «Tu ne tueras point!» reste un commandement absolu. Voilà pourquoi l’histoire de Charlotte Corday occupe tant sa pensée, parce qu’elle pose de la manière la plus saisissante qui soit le douloureux cas de conscience qu’engendre tout combat contre le mal qui emploie les armes du mal.
Le dilemme est de «méconnaître la vertu» en ne «glorifiant pas l’héroïsme», ou de «louer l’assassinat» en ne «flétrissant pas le crime», à quoi la conscience, dans le déchirement, se refuse également. La fin du récit dit toute l’hésitation de Lamartine, et combien il balance entre l’admiration qu’il éprouve pour l’héroïne, et la répulsion que lui inspire le crime. Le mieux, alors, est de ne pas juger, comme le demande l’Evangile (Luc VI; 37). Et comme fait Lamartine, qui renonce à trancher, et s’en remet à Dieu. Toutefois, avant de la quitter, et pour la célébrer dans sa grâce, son charme et sa vertu, sans pour autant effacer la part d’ombre de son être et son ambiguïté, il fera d’elle, dans une parlante alliance de mot, «l’ange de l’assassinat».