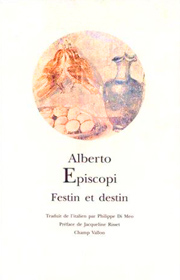Seul ouvrage publié du vivant d’un des prosateurs italiens les plus originaux, Festin et destin est un voyage à travers des espaces illimités. Accomplissant la reconnaissance de sa propre intériorité, le protagoniste réalise aussi un périple qui explore l’Histoire et le Mythe. Une cosmogonie indifférente, cruelle, tautologique d’où n’est pas exclu un certain sentiment religieux et qu’exprime admirablement une syntaxe déhanchée.
Lire la préface de Jacqueline Risset
Festin et destin
Préface de Jacqueline Risset
Il existe une certaine espèce d’écrivains qui, très jeunes, se mettent à leur table et écrivent, écrivent avec fougue, avec rage et d’une façon rebelle… sans repos, et comme si leur geste devait trouer la page, casser la machine sur laquelle ils tapent, pareils à des sourds, et casser aussi leur lecteur, lecteur inconnu vers lequel ils se tournent en écrivant, lecteur hypocrite, frère, et quelque chose de plus — ou de moins peut-être — : «c’est ce qu’on va voir».
Ainsi parlent-ils, sans parler, en proie à cette activité unique, qui engage leur existence chaque jour et chaque nuit, jour après jour, nuit après nuit, jusqu’au jour où cette existence est elle-même cassée, ininterrompue, d’un coup, par la mort.
Alors nous nous retrouvons, nous, lecteurs posthumes, avec sur les bras une œuvre — mais ce mot les aurait fait rire — ; ils auraient eu raison, sans doute, mais comment l’appeler? Une œuvre énigmatique, qui se désigne elle-même, et se détruit en se faisant, en se regardant…
Alberto Episcopi appartient à cette lignée sans descendants. Et son livre principal est celui-ci, Festin et Destin, dont le titre se trouve éclairé par l’image qui orne la couverture de l’édition italienne: détail d’une peinture française du xviie siècle, «Le dessert de gaufrettes», de Baugin (vers 1630). Dans un grand plat noir quelques légers gâteaux en forme de cylindre de pâte fine et dorée; tout auprès, la lumière rosit doucement le vin à l’intérieur du verre de cristal, auprès d’une fiasque en paille minutieusement représentée; on ne voit pas le reste du tableau, mais on peut imaginer le crâne posé sur la table, dans ce type de tableaux qu’on appelle à l’époque baroque «Vanités». Le Destin regarde le Festin, et en révèle d’un coup l’illusion; mais le Festin, de son côté, brave le Destin, le défie et le provoque. La littérature d’Episcopi vit dans cette aura dédoublée, s’en nourrit…
La première partie du livre, de loin la plus longue, répond au titre collectif de «Fragments d’inspiration», qui présente deux interprétations possibles: on peut choisir de relever la contradiction destructrice entre les deux termes: l’«inspiration» impliquant traditionnellement un flux, une sorte de fleuve vaste et continu, l’image du fragment venant du même coup ruiner, ironiquement, dérisoirement, cette prétention à la «Poésie» rejointe et réalisée; ou, à l’opposé, les fragments vus non comme «déchets», au sens mallarméen, c’est-à-dire comme manifestations de l’impossibilité, de l’impuissance créatrice, ou encore comme «chute d’une matière sur laquelle on travaille» dans le vocabulaire de l’orfèvrerie, mais comme «plus petite cellule possible» de l’inspiration même, instant suscitateur, source la plus active de la création même, son aspect perpétuellement «naissant»…
La deuxième partie a pour titre «Ironie sans sort»: le «destin» baroque écarté par la victoire définitive de l’ironie, la mort de Dieu ayant laissé la pure possibilité du rire et du négatif…
Deux thèmes, et deux instruments, glissant sans encombre du rôle de thème à celui d’instrument, et vice-versa: le corps, et le langage. Le corps segmenté, «Eros excentrique», pervers polymorphe. C’est le corps, avec ses désirs immédiats, simplistes, immaîtrisables, qui démythifie constamment les autres contenus, les pensées, la «culture». C’est ainsi que le mythe littéraire qu’est la Religieuse Portugaise, Marianne Alcoforado, se transforme sous nos yeux en premier plan hard-core:
En faisant glisser le long de ses jambes, de ses chevilles jusqu’aux tout premiers poils de l’aine, avec des mains adhérant parfaitement à la chair tiède, la lourde bure blanche et noire de Marianna Vincenza, rose vif, sinueuse, une muqueuse capture l’œil un bref instant durant et il se pose ensuite sur les vastes espaces courbes du ventre pour se concentrer soudainement sur le bouton nodal de l’ombilic tandis que, glissant, les doigts d’abord sur le bassin, étreignent désormais puissamment ses hanches.
Le langage est agressé comme langue maternelle — majesté de la face maternelle chez Lautréamont —, ou démonté dans ses plus petites parties, pour être déchiffré dans son sens le plus profond, le plus lointain, dans son sens enfantin, comme chez Michel Leiris — opération qui inclut une sorte de «parti pris des mots», des mots comme choses, à la Ponge:
Et puis, les berlues.
Les berlues sont les ’rlues qui bastonnent et terrassent un homme au beau milieu d’une rue, ’rlues de lassitude et d’atroce épuisement, bâtons osseux entre les roues de la tête, et le ber ne fait que tordre les axes des roues et briser.
Ou encore: Le u de Paola.
Paola est un nom gonflé, plus que gonflé, enflé, avec ce o central qui jaillit d’un fond d’indéfini écho, pour s’insérer trop vocaliquement dans le ligneux pala
Mais une sorte de ciel étoilé, une constellation, tout à la fois gazeuse et cristalline, sont tout à coup évoqués et se découpent dans la pureté de la nuit, si pa et la se rassemblent autour de la symétrie nette et ouverte sur l’infini d’un u.
Lautréamont, qui n’est jamais nommé dans Festin et Destin, est certainement le plus proche. Par l’évocation d’un auteur-Maldoror:
Je suis un vampire: je m’enivre de très jeune sang ; il est humide de rosée, il est frugal. Les épaules de mes enfants, qu’avec astuce je couve dans les prés, sont blanchissimes et tendres, elles possèdent la saveur du miel; et j’en aime tout particulièrement deux; elle, violente et acerbe; lui, docte et cruel, qui, dépourvus de sensualité vivent chaque jour des journées cristallines.
Ou encore par le rapport violent, fantasmatique et phatique à la fois, au lecteur:
Sclarel est une image de dureté, un obscur noyau de bestiale puissance, mécanique, pas même mitigée par des flots de crétinismes méchants dont sa bouche regorge comme de crapauds visqueux contre ton visage, lecteur.
Et enfin par l’énoncé (qui englobe Les Chants de Maldoror et les Poésies) d’un rapport privilégié — par le moyen du négatif — au langage:
je suis corrompu par les mots et par la structuration des phrases.
Il s’agit en ce cas d’un rapport d’agression qui devient agression réciproque — de qui écrit contre la langue, mais aussi de la langue contre qui écrit. Le fragmentaire ici s’étend jusqu’aux éléments minimaux du langage, jusqu’aux lettres:
rugir et rouille sortent leurs griffes, u féroces qui éraflent un tissu de satin, se brisent, s’ébrèchent dans un écaillement ou un grognement.
Corps et langage se rejoignent enfin dans un spasme exaspéré, qui est l’écriture «spermatique» — le sperme comme «encre sympathique», écriture blanche. Les métaphores freudiennes (et avec elles l’énoncé de l’équivalence entre les sécrétions corporelles) sont prises à la lettre. L’écriture est — se doit d’être — «pornographie» (p. 96).
Pornographie, mais aussi écoute des valences symboliques, qui multiplient le sens des notions dans la rhétorique poétique:
le sang est toujours quelque chose de plus que le sang, phagocité qu’il est par sa métaphore.
Comme chez Gadda, dont Episcopi rappelle le «traumatisme noétique», le rôle de l’écrivain est essentiellement celui de signaler le chaos caché derrière le cosmos, de démasquer, par le moyen de la rhétorique même qui a servi à l’instituer, l’opération d’«illusion» générale effectuée par l’humanité sur le monde qui l’entoure:
Si l’univers est le plus beau faux que l’homme ait inventé, qui l’a situé au-dessus de lui en guise de ciel étoilé, d’infini (obéissant par conséquent à une double et, apparemment, antithétique fonction), si écrire sur l’univers est le merveilleux faux des faux, il n’est pas dit que l’homme n’ait pas également créé des faux mesquins, injustes, telle l’histoire.
L’écrivain véritable est celui qui se rebelle contre cette falsification générale, celui qui pose la question de la «pulsation du chaos»:
Que savons-nous du sang de l’univers, dont, pourtant, nous comprenons que jamais il ne coagule?
Par là, il se détourne, violemment, souverainement, du «genre humain»:
Peut-être que le genre humain m’intéresse très peu, peut-être que les forces naturelles (donc magiques, donc la puissance dissoute dans l’air) me dominent à tel point, me secouent tellement et s’infiltrent dans toutes mes lézardes, que rien ne pourrait désormais me distraire de ma sinueuse résolution d’assortir ces signaux de l’univers de mots le plus seyants possible .
Travail mythique et démystifiant, travail nocturne et solitaire, celui d’une sorte de gardien de phare cosmique, qui de temps en temps ferait sauter le phare, pour nous faire parvenir, à nous qui ne voulons pas les entendre, des «signaux de l’univers» — énergie en mouvement, qui ne demande pas à être thésaurisée (par l’institution du religieux, ou par l’accumulation de l’occulte), mais qu’il s’agit de scruter dans le déchiffrement du sacré, qui est contradiction, éclat, ironie…
Jacqueline risset