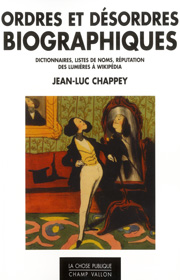De la fin du XVIIe au début du XIXe siècle s’étend l’âge des dictionnaires marqué par le succès éditorial de genres particuliers et la formalisation d’une pensée classificatoire qui tend à prendre pour objets tous les éléments du réel. Les dictionnaires et les listes s’imposent dès lors comme de nouveaux supports de lecture du monde politique, social ou culturel, un phénomène auquel semble faire écho aujourd’hui le succès de Wikipédia. Or, sous des formes les plus diverses, la mise en liste des hommes, au même titre que celle des plantes ou des animaux, a constitué un événement majeur entre le XVIIIe et le XIXe siècle, soulevant des questions qui résonnent encore aujourd’hui. Des dictionnaires historiques aux nombreuses listes de noms qui envahissent l’espace public, il s’agit toujours d’opérations de qualification et de disqualification, de réputation ou de stigmatisation. La période révolutionnaire offre un laboratoire d’observation privilégié pour saisir les effets de ces listes qui servent autant à inclure les citoyens qu’à exclure les ennemis, en un monde où les repères traditionnels liés à la naissance et aux privilèges naturels ont volé en éclats. L’analyse des conditions de la prise de contrôle de ces listes, l’étude des modalités à partir desquelles se construit l’autorité sur l’écriture des notices biographiques, proposent ainsi des clés qui rendent possible l’étude des dynamiques politiques, sociales et intellectuelles qui se jouent dans et par le biais de véritables guerres de dictionnaires et batailles de noms.
Du Grand dictionnaire de Moréri où s’établit la réputation nobiliaire à la fin du XVIIe siècle à l’entreprise de remise en ordre menée par les rédacteurs de la Biographie universelle ancienne et moderne au début du XIXe siècle où se fonde l’ordre bourgeois , cet ouvrage se propose d’interroger les effets de ces productions, trop souvent canonisées, en les replaçant dans leur contexte de production tout en mettant au jour les intérêts de leurs auteurs. Souvent méconnus, ces « faiseurs » de dictionnaires ou de listes constituent les objets centraux de cette analyse. Ces ouvrages tentent en effet d’imposer un ordre biographique à partir duquel se fixent les positions, les statuts et les réputations. On comprend dès lors que créer du désordre en falsifiant, travestissant ou en jouant sur son nom, peut constituer, avec l’avènement de l’individu-citoyen, à l’heure de la genèse et de l’extension de la sphère publique, un moyen de défendre l’intégrité, de plus en plus menacée par l’émergence d’une véritable biocratie, de son propre récit biographique. À l’heure de Wikipédia, cette archéologie du Who’s Who de la société révolutionnée s’impose comme une réflexion politique et critique sur les systèmes de reconnaissance des individus en profondes mutations.
Lire le sommaire
dictionnaires, listes de noms et réputation des lumières à Wikipédia
Le sommaire
INTRODUCTION
Approches d’un corpus invisible
Remerciements
Chapitre 1.
Une invention du XIXe siècle:
la Biographie universelle des frères Michaud
I. Contours et organisation d’une entreprise éditoriale
Les Michaud : des éditeurs royalistes… soucieux de leurs intérêts
Des collaborateurs choisis parmi les « meilleurs »
Un modèle de salon mondain
La biographie universelle et la presse
ii
II. Entre collectes et écritures :
Les modalités du travail biographique
Les forçats de l’écriture biographique
Biographie et bibliographie
Une sociabilité par la Biographie universelle
Georges Weiss et la Biographie universelle
III. Oppositions et résistances
Madame de Genlis et le refus de conciliation
Prudhomme contre Michaud. Le xviiie contre le xixe siècle ?
Les dictionnaires à la barre
La contre-offensive des Michaud
IV. La Biographie universelle et les enjeux
De l’écriture de l’histoire
Normalisation
Canonisation et disqualification
La Biographie et la civilisation française
Chapitre 2.
Dictionnaires au temps des Lumières.
Critique et opinion publique
I. Au temps des hommes illustres
Un dépôt de la gloire
Dictionnaires historiques et académisation
De la réputation à la considération
Le Moréri et l’identité nobiliaire
II. Dictionnaires et république des lettres
Ladvocat et la figure du critique
La promotion de l’auteur
Dictionnaires et correspondances savantes
III. Dictionnaires et conflits religieux
Dictionnaires et jansénismes
Concurrences et interrogations autour du Grand homme
Chapitre 3.
Désordres biographiques et crise politique
I. Une entreprise des lumières :
Le dictionnaire de Chaudon
Chaudon et la conquête d’un nouveau marché
Chaudon et le monde des académies
Des intérêts contradictoires
Le combat de l’abbé Feller contre les « chaudonistes »
II. Décadence littéraire et crise politique
La question de l’invasion de la piétaille littéraire
Les appels à une nécessaire remise en ordre
Les dictionnaires et les batailles littéraires
III. la revanche des pygmées
Le mécénat contre le marché ?
Rivarol et l’anatomiste des réputations
Chapitre 4.
Jeux de noms en Révolution (1789-1794)
I. Le temps des listes
Citoyenneté et publicité du nom
Les noms, rouages du politique
Personnalisation
L’impossible compromis par les noms
II. Une violence par les listes ?
Stigmatisation
Dénonciation et mort civile
III. Héroïsmes en concurrence
Panthéon et dictionnaires : fixer la Révolution
Citoyenneté et distinctions
Héros et martyrs
Les impulsions politiques de la biographie
Chapitre 5 :
L’émergence d’une biocratie (1795-1810)
I. Inventer les terreurs et construire la république
Portraits de buveurs de sang
Martyrologes et mémoire contre-révolutionnaire
II. Savants et brigands. l’impossible stabilisation
De la république directoriale
Panthéons républicains
Les listes contre la République
L’appel au Grand homme
III. Une réorganisation de l’ordre politique et social
Les retours politiques par le dictionnaire
Le Consulat et la pulsion de bilan
La mise en ordre impériale
Chapitre 6.
Batailles de dictionnaires sous l’Empire
et la Restauration
I. Le marché des contemporains
Le succès des girouettes
Biographie et biographés face au régime médiatique
Ménégault ou Maugenet… jeu sur le je ou l’usage de la falsification
II. Dictionnaires et espace politique
Sous la restauration (1820-1829)
Dictionnaire et nébuleuse libérale
Un ultra dans la mêlée biographique
La tentation de l’érudition
III. Les effets sociaux du régime des dictionnaires
Dictionnaire et mythologie impériales
Construire la mémoire
Dictionnaires et « manie correctrice »
Une resaisie de soi par l’écriture biographique
Chapitre 7.
Dicomania et Wikipédia
I. Les dictionnaires et l’écriture
De l’histoire contemporaine
Mutations et retours des dictionnaires historiques entre xixe et xxe siècle
Les dictionnaires historiques et l’historiographie de la Révolution française
II. Les nouveaux supports de publication
Des notices biographiques
Les biographies nationales en concurrence
Un nouveau laboratoire biographique : Wikipédia
III. La révolution française dans wikipédia
Des historiens mobilisés, des universitaires absents
Luttes historiennes dans Wikipédia
CONCLUSION
Sources et bibliographie
Index